
En restant debout, je fais face calmement à ce que je ne connais pas, je me prépare à affronter cet inconnu… Mais pour pouvoir le faire, il faut de la force ; et cette force, l’individu ne l’a qu’aussi longtemps qu’il ne sépare pas son destin de celui des autres (…), qu’il a la conscience profonde d’appartenir à une communauté (…) La solitude est peut-être la plus grande malédiction qui existe sur terre (…), écrivait Milena.

Et puis vint ce que Kafka, qui avait toujours été seul et debout, ne vit pas. On était en 1938, il était mort quatorze ans plus tôt, et Milena, faisant face au pire, comme toujours, écrivait dans le journal pragois Pritomnost : (…) nous sommes seuls. Le gouvernement a décidé de céder les Sudètes (…) Tout au début de la matinée, ce n’était que nouvelles brèves, d’un téléphone à l’autre, d’un Pragois à un autre. Les gens s’immobilisaient dans la rue, au travail, chez eux, le cœur serré, stupéfaits, frappés dans leur foi la plus profonde. Seuls ? C’était si incroyable que nous n’y croyions tout simplement pas.
C’en était donc fini de la république fondée par Masaryk sur le principe de l’émancipation des peuples slaves de l’ancien empire austro-hongrois, fini de l’État né en novembre 1918 et réunissant près de dix millions de Tchèques et Slovaques, mais aussi plus de trois millions d’Allemands, sept cent mille Magyars, et des minorités ruthène et polonaise. Finie l’unité tchécoslovaque, pourtant garantie depuis 1924 par le traité d’alliance défensive qui engageait la France à intervenir immédiatement en cas d’agression allemande, et par le pacte de 1935 qui prévoyait aussi le secours de l’URSS, subordonné à l’intervention préalable de la France.
La France de Daladier, appuyée par l’Angleterre de Chamberlain (avec le soutien enthousiaste de leurs peuples respectifs), venait de prévenir la Tchécoslovaquie qu’elle renoncerait à s’opposer de fait à l’annexion des Sudètes par l’Allemagne de Hitler – lequel allait aussitôt passer à l’acte. Cette morsure au cœur de l’Europe se révélerait fatale.
*
Franz ne le savait pas lui-même, mais son corps le savait : la chair humaine n’aurait désormais plus la moindre valeur.
Le monde traversait le corps de Kafka qui ne faisait que le retranscrire, tel un médium. C’est pourquoi sa vision restait pour beaucoup insupportable, incompréhensible. Il fallait, pour en pénétrer le sens profond, des esprits élevés et lucides : tels Tucholsky, ce brillant critique berlinois qui prouva sa clairvoyance en devenant, dès les années 20, un militant antinazi, et finit par se suicider en 1935 – voyant la partie perdue.
Un jour de cet été 1920 où Milena lui faisait remarquer, heureuse, la parution d’une excellente critique sur sa nouvelle La Colonie pénitentiaire, Franz avait répondu simplement : « Tucholsly… Il est le seul à avoir compris ce texte. Sais-tu que, lors de sa publication, tous les autres critiques y ont été hostiles ? Trop de cruauté, trop de froideur dans cette histoire de machine à torturer, de mécanique élaborée visant à éliminer les hommes après avoir exécuté sur eux une sentence qu’ils ignorent. Il serait inutile de la lui faire savoir, puisqu’il va l’apprendre sur son corps. La plupart de mes rares et aimables lecteurs s’en sont montrés dignement dégoûtés, quand ils n’ont pas préféré, pour toute sauvegarde, l’indifférence. Ne rien voir, ne rien entendre… En découvrant cette histoire, même mon éditeur, Kurt Wolff, m’a reproché son caractère pénible. Je lui ai répondu que notre temps en général et le mien en particulier étaient fort pénibles également.
– S’ils te connaissaient, tes lecteurs ne trouveraient pas tes livres si terrifiants. S’ils savaient la sérénité, la douceur qui se dégagent de toi… S’ils savaient comme tu es bienveillant, attentif, généreux… S’ils savaient comme, malgré ta grande réserve naturelle, tous les hommes intelligents, toutes les femmes sont attirés par toi et reconnaissent ta valeur… Et cela depuis bien avant que quiconque se doutât que tu écrivais. Ne nie pas, c’est Max qui me l’a raconté : il jouissait d’une haute considération dans la société qui se réunissait chez l’hospitalière Mme Bertha Fanta pour s’occuper de philosophie. J’aimerais que tous tes lecteurs soient assez attentifs pour te connaître comme s’ils t’avaient rencontré. Alors ils comprendraient. Ils sentiraient ta tendresse, ta justesse, ta sensibilité hors du commun… Et peut-être alors seraient-ils encore plus terrifiés.
– Il ne faut pas avoir peur des livres, dit lentement Kafka. Tu le sais bien, Milena, toi qui n’as peur de rien. Les livres sont là pour nous aider à nous sauver. Comment pourrais-je survivre à la peur, sans littérature ? Le livre dit une vérité, rares sont les personnes qui comme toi comprennent qu’en dépit des apparences la vérité est moins redoutable que le mensonge. En novembre 1916, j’ai fait une lecture de cette nouvelle, La Colonie pénitentiaire, à la librairie Goltz de Munich. D’un ton sombre, comme il convenait de le faire…
– La mode, dans ce genre d’exercice, est pourtant plutôt à l’emphase… Ah !, les tournures recherchées de Werfel et ses drames expressionnistes jusqu’à la caricature… ! Meyrink et son Golem…! Et je ne parle que des meilleurs de nos auteurs… Même Rilke, parfois… Sans doute ont-ils d’autres qualités pour compenser certaine lourdeur de leur style. Mais reconnaissons que notre littérature contemporaine, avec son cortège baroque de monstres et d’obsédés en tous genres, est souvent aussi ampoulée que la tienne est directe et précise. Véhiculée par une langue simple, cet allemand qui, à force d’être minoritaire en Bohême, a fini par s’appauvrir, et que tu utilises tel quel, sans artifices. C’est ce qui m’a fascinée dans ton écriture, et c’est pourquoi j’ai voulu te traduire. Je pense que les gens ont dû apprécier ce parti pris si tranchant sur ce qui leur est ordinairement donné à entendre.
– Au contraire, cette lecture fut un désastre. Juste avant cette soirée, je m’étais disputé avec Felice, qui était venue jusqu’à Munich pour me voir. Elle est repartie aussitôt – mais elle n’a jamais vraiment compris mon travail… Au début le public était attentif, intéressé. Puis il me sembla lentement se pétrifier, moins sous l’effet de l’horreur froide du texte que d’une gêne grandissante. Ils étaient gênés parce qu’ils ne comprenaient pas, ou bien parce qu’ils savaient déjà et ne voulaient pas savoir. Et de temps en temps des terroristes de mon genre, au regard candide et aux manières douces, placent dans les librairies des livres plus inquiétants que des bombes… Un écrivain est une sorte d’assassin, car un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous…
– Briser la mer gelée… Est-ce pour cela que toi et tes amis riiez si fort quand tu leur lus le premier chapitre du Procès ? C’était à peu près à la même époque, non ?
– Exactement. Nous avons beaucoup ri, et je t’aime, Milena. »
Ils étaient à Vienne, paisiblement assis à la table d’un café, devant une tasse de chocolat et une pâtisserie. Franz souriait. Il avait toujours ce visage d’adolescent timide et ouvert aux autres. Et puis quelque chose de plus dans le regard, une connaissance supérieure qu’il ne cherchait pas à montrer, au contraire, mais qui perçait d’elle-même – Max avait raison -, qui perçait de tout son corps. Malgré cela, Milena avait soupçonné que loin, très loin derrière cette gentillesse et cette bonté, étaient tapies violence et colère, et peut-être même de la haine.
Oui, ce jour-là, il était passé fugacement sur le visage de Kafka quelque chose qui ne tenait pas seulement de la souffrance ordinaire, personnelle, mais aussi d’un désespoir universel et sans appel, dépourvu de tout pathos et plein d’une horrible prescience.
*
à suivre (le principe est expliqué dans la première note de cette catégorie)


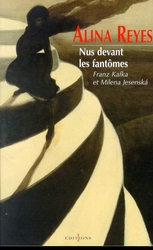 Ce livre est paru en 2000 aux Éditions 1, dans une collection dirigée par Stéphanie Chevrier. Il est toujours disponible en édition de poche
Ce livre est paru en 2000 aux Éditions 1, dans une collection dirigée par Stéphanie Chevrier. Il est toujours disponible en édition de poche