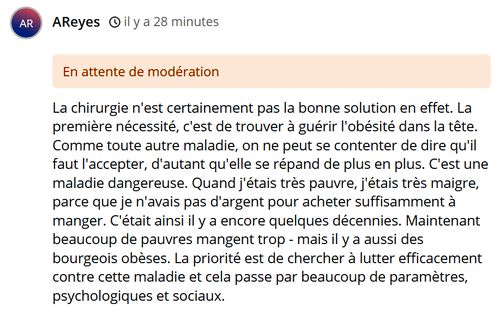Après le prologue, nous entrons maintenant dans le journal en lui-même. 1979, j’ai vingt-trois ans en février. Désir ardent d’écrire, bonheur ardent de voyager (là un récit d’une partie d’un voyage au Maroc), regards ardents sur les jeunes hommes et les jeunes femmes de mon âge, dont je tombe amoureuse à toute occasion, ardents questionnements spirituels… Je brûle de partout et tout est là pour l’écrivaine que je ne suis pas encore – quoique…
Je ne sais plus pourquoi je n’ai pas mis les dates de chacune de mes entrées dans le journal (dont je n’ai plus le manuscrit), mais on suit à peu près l’affaire, entre janvier et juillet de cette année 1979. (J’ajoute un passage sur mon fils « Arno » qui figurait par erreur dans l’édition papier à l’année 1984, alors qu’il est né en 1976 et avait donc « pas encore quatre ans » en 1979).
*
Soulac-sur-mer, 1979
C’est le matin, j’écoute Le Sacre du Printemps.
Le printemps s’annonce à Soulac avec beaucoup moins de violence que chez Stravinsky. Ici, tout se fait en douceur. C’est d’abord, dès la fin janvier, les mimosas qui fleurissent ; ces abondantes grappes jaunes, cette odeur forte et envahissante… Malgré les gelées matinales dès l’après-midi le soleil fait sortir les premières chenilles processionnaires de leur nid, là-haut dans les pins toujours verts.
Dans moi aussi, au moindre rayon de soleil, le printemps se réveille, et même l’été. Il me prend des envies de mouvement, j’écoute Théodorakis ou Zambetas et je me mets à danser, je pense à la Grèce, et mon ventre et ma poitrine se soulèvent comme si j’étais fraîche amoureuse, et j’ai envie de rire et de pleurer. J’ai des fourmis dans les jambes, je rêve de voyages. Tous mes problèmes intellectuels, métaphysiques, mes constantes et épuisantes remises en cause de moi-même, tout cela s’échappe insensiblement et je commence à pousser un long « ouf », à me sentir vivre. Tout m’apparaît plus simple, il suffit de laisser s’écouler la vie sur moi, et elle m’appartient, et elle est douce, tellement… Comme celle d’un lézard goûtant le soleil sur une grosse pierre blanche.
Voilà l’état d’âme dans lequel je commence à me retrouver de plus en plus souvent. Mais j’ai encore de durs moments d’angoisse, de tristesse, de désillusion. Finalement, ma plus grande souffrance est de rester stérile devant une feuille blanche. Après un poème je me sens bien, soulagée, comme après un cauchemar angoissant et pénible, qui m’a servi d’exutoire. Je rêve qu’on m’enlève Arno, qu’on le torture abominablement, qu’on le tue, ou bien que Yannick me trompe, et je me réveille encore émue, mais détendue et souriante, car toutes mes angoisses se sont déchargées dans le rêve. C’est la même chose quand j’écris un poème.
Mais j’ai à peine le temps de savourer cet instant privilégié qu’il devient aussitôt un nouveau sujet de tourment car je m’aperçois avec dépit de sa rareté et de ses limites. Je veux de toutes mes forces devenir écrivain, mais quand je constate la nullité de ma puissance créatrice et la triste mine de mes quelques écrits, viennent de longs moments de découragement, et même de dépression.
Il m’arrive aussi, souvent, de me demander pourquoi je tiens absolument à devenir écrivain, alors que je suis persuadée que l’écriture, sous n’importe quelle forme, ne peut conduire à la sagesse. Mon idéal, c’est de me faire ermite. Peut-être, un jour… Quoi qu’il en soit, malgré mes découragements, mes insomnies et mon manque de motivation, je persiste dans mon rêve d’écriture, et je crois, que, sans cela, ma vie m’apparaîtrait tellement vide que je courrais au suicide.
J’ai acheté ce cahier après avoir entendu à la télévision, l’autre soir, Henri Thomas dire qu’il tenait des carnets. Quand j’étais lycéenne, j’ai tenu mon journal pendant des années, et puis, à dix-sept ans, j’ai brûlé tous mes gros cahiers. C’était comme si, implicitement, je m’étais promis de ne jamais plus tenir un journal. Aujourd’hui je recommence, car :
– c’est le seul moyen d’écrire sans devoir attendre l’inspiration ;
– cela peut la provoquer ;
– il est possible que quelques passages de ce cahier me soient utiles plus tard ;
– au moins, écrire sans souci d’intelligence ou d’esthétique me soulage.
Cet après-midi, j’ai vu chez le marchand de journaux le deuxième numéro de Où Magazine. Mon article sur la Crète n’était pas au sommaire. Pas davantage que celui que j’avais écrit sur notre voyage en Grèce, l’année dernière, n’était paru dans Partir.
Je n’ose pas aller me coucher, j’ai peur de l’insomnie, comme hier et avant-hier. Des heures à tourner dans le lit, à tourner dans ma tête des phrases et des phrases.
Après avoir écouté Alberto Moravia et Günter Grass, je ne me fais plus aucune illusion sur mon avenir d’écrivain… Vraiment pas à la hauteur ! Je suis comme un des personnages de ce film que j’ai vu hier soir, après Apostrophes. Il vit à Sète, commence des romans, ne les finit jamais, et ne les finira jamais. Après le film j’ai terminé Les Immortels d’Agapia, de Virgil Gheorgiu. Il dit qu’on ne fait jamais rien de grand dans les petites villes, que toutes les grandes pensées, toutes les grandes œuvres sont toujours réalisées dans les grandes villes. Peut-être prend-on trop le temps de vivre, autant à Sète qu’ici, à Soulac. Mais comment s’en plaindre ?
J’aime descendre au fond des rêves, au fond des nuits sans fond… où explosent des milliers de réalités… Longs délires… Comme la nuit est riche, comme elle est saugrenue…
Est-ce le printemps qui me rend si amoureuse ? Depuis plusieurs jours, je suis amoureuse de plusieurs hommes, j’en rêve toutes les nuits, et même toute la journée.
Je n’ai même plus envie de lire pour tromper la longueur des nuits.
Cet après-midi, balade à Saint-Émilion. Nous pensions à notre départ pour le Maroc, dans moins d’un mois. Là-bas il y aura le soleil, et au retour en France, il y aura le soleil aussi.
Pauvres tourterelles ! Elles me tournent le dos, je les gêne avec ma lampe. Mais je n’ai pas envie de bouger, ni de lire, ni de faire l’amour. J’ai envie de dévaliser une boutique, et de passer ma nuit à essayer des dizaines de vêtements.
En ce moment, Arno, c’est l’imagination au pouvoir, il faut vivre dangereusement, c’est le poète et l’anarchiste. Il chantonne, il chantonne interminablement, en s’inventant des dizaines d’histoires, et puis il se met à crier, à cracher sur tout, et à en rire très fort.
Arno n’a pas encore quatre ans, mais en ce moment il est en plein délire métaphysique. Jour après jour, il me raconte sa vision du monde, voilà ce que cela donne : au début des temps, il n’y avait sur terre ni hommes ni animaux ni camions, ni même arbres, simplement des fleurs et des plantes. Ce qui était beau, mais bien triste. Il n’y avait pas d’océan, mais d’immenses rivières qui faisaient des raz de marée. Ensuite, il y eut des hommes qui étaient des géants. Quand il étaient morts, ils s’enterraient très profondément sous la terre, sans tombeau, à l’endroit où il y a du feu, et on ne retrouvait ainsi jamais leurs squelettes.
Un jour, un volcan décida de recracher le corps d’un enfant mort, et celui-ci ressuscita. Tout le monde était content, mais ensuite il n’y eut plus de géants, simplement des gens comme nous.
J’ai oublié de dire que parfois, avec le corps des morts, les géants construisaient leur maison, c’est pourquoi on peut aujourd’hui remarquer que les maisons ont une bouche (la porte) et des yeux (les fenêtres).
Quand on a inventé l’écriture, on n’a pas su tout de suite former des lettres avec des boucles. On a donc commencé par faire des petits dessins – une minuscule maison pour dire « maison », un minuscule camion pour dire « camion », etc.
Un jour, il n’y aura plus du tout d’hommes sur la terre, et ça ne reviendra jamais. C’est comme les dinosaures, il y en a eu, il n’y en a plus eu, il n’y en aura plus.
Arno me raconte aussi ses dialogues avec « Petit Lapin », son alter ego coquin. Petit Lapin lui demande : Ça t’énerve d’exister ? – Oh non, ça va, répond Arno. Mais ça m’énerverait pas de pas exister, parce que quand on n’existe pas, on peut pas s’énerver.
Voilà le genre de questions qui lui viennent naturellement chaque jour, sur la mort, l’espace, le temps, et bien qu’il déploie toute son imagination (vaste) pour y répondre, on sent qu’il n’est pas satisfait, puisque, de nouveau, le lendemain, il interroge, il cherche. Il en rêve aussi beaucoup la nuit, ce qui gâche parfois son sommeil, et le nôtre. Mais au moins, que son paysage mental est riche !
Nous sommes en Andalousie. Yannick conduit, et les routes sont bien difficiles, très encombrées de camions. Je me régale à regarder les champs couverts de coquelicots, boutons d’or, pâquerettes, chicorées sauvages, lavande, genêts, oliviers… Il fait beau.
Maroc
La voiture est bloquée dans un garage quelque part entre Fès et Marrakech, j’en profite pour écrire. Hier arrivés à Fès, impossible de trouver la plus petite chambre ni même de visiter, toutes les plus belles parties de la ville étant fermées pour recevoir le roi. Partout des gendarmes, une foule de gens attendant son arrivée au bord des routes banderolées. Il doit y rester vingt jours. Nous avons finalement dormi à Imouzzer.
Quelques jours plus tard
Quatre-vingt kilomètres encore jusqu’à Marrakech, et le soir tombe. Un peu après El Kelâa, nous nous arrêtons sur le côté de la route pour nous désaltérer. Deux Arabes nous observent depuis un moment. L’un d’eux vient nous demander une cigarette, et aussi notre adresse. Yannick lui donne l’une et l’autre de bonne grâce. El Arâbi nous fait alors comprendre qu’il veut nous inviter chez lui ce soir. Surprise agréable ! C’est parti : nous suivons sa motocyclette.
Nous avons vite quitté la route, pour rouler sur la terre argileuse. On devine à peine le chemin, plein de trous. Où sommes-nous ? Longtemps nous cahotons, mal éclairés dans cette nuit noire par les phares de la voiture. Enfin, nous apercevons les premières maisons de terre rouge du village.
Nous sommes à peine arrivés qu’une multitude de voix féminines nous accueille, avec de grands bonjour ! bonjour ! Je descends, je serre des mains, je suis conduite dans une salle éclairée à la bougie. On me fait déchausser, asseoir sur des nattes et des tapis, on me met des coussins derrière le dos, sous les bras… On parle, on rit beaucoup. Chacune de nous ne connaît qu’une seule langue : la sienne.
Yannick et El Arâbi reviennent du « garage » (une grange) où ils sont allés ranger la voiture, à grand-peine. D’autres hommes arrivent, serrent nos mains, et s’assoient sur les nattes, pieds nus. Les femmes et les enfants sont agglutinés, debout, à l’entrée de la pièce. Les présentations se font dans la bonne humeur. On est bien. Les femmes posent sur la table basse un plateau d’amandes, de noisettes salées, une profusion d’œufs durs tout chauds, du Coca et du Fanta orange. Mohammed, patiemment, moud son kif à l’aide d’un couteau. Il fume beaucoup pour supporter le travail, qui est très dur.
Nous avons maintenant un interprète, Moisli, un étudiant du village qui s’est joint à nous, et nous permet d’avoir des conversations plus suivies. Il semble déjà que nous nous connaissions tous depuis toujours.
Un peu plus tard, nous dégustons un tajine au poulet, avec un pain rond et plat tout tiède encore, le kessara. Délicieux. On pioche dans le plat avec les doigts. À la fin du repas, l’une des femmes propose à chacun l’eau pour se laver les mains. Un peu plus tard encore, on nous laisse cette pièce pour la nuit, où nous dormons sur les tapis. Toute la nuit, je tiens enlacés, d’un bras Moïra (la chienne, berger briard), de l’autre Arno, car j’entends tout près de nous des souris, peut-être même des rats, mener grand train. C’est la première fois que je dors accrochée à la fourrure d’un chien.
C’est le chant du coq qui nous réveille. Nous sortons dans la cour intérieure, que les femmes sont déjà affairées à nettoyer. Nous découvrons ce que nous n’avions qu’entrevu la veille au soir : dans cette cour plutôt réduite, il y a un poulailler et des lapins en liberté, une vache et son veau attachés, des moutons retenus derrière une haie piquante, et deux ânes à l’abri. On trait la vache, on en laisse un peu pour le veau.
Puis nous prenons le petit-déjeuner, riz au lait et thé à la menthe. Les tout-petits, dans le dos de leur mère ou de leur sœur, sont calmes, gentils.
Toute la matinée, nous nous promenons avec El Arâbi, Mohammed, Moisli, Mustapha. Nous sortons du village, qui nous paraît un vrai labyrinthe. Toutes les maisons se ressemblent, même couleur rouge de la terre dont elles sont faites, mêmes cubes opaques (une seule porte, pas de fenêtre sur l’extérieur), posés les uns à côté des autres. Les chiens aboient sur notre passage, nous suivent à distance, et finissent par se battre entre eux. Les enfants aussi se rassemblent pour nous observer. On ne voit pas souvent des étrangers, ici.
Nous visitons la grande propriété qui s’étend autour du village, et où tous travaillent. On nous explique qu’elle appartient au frère d’Hassan II. Plusieurs cultures donnent du travail toute l’année. En ce moment, de janvier à fin mars, c’est la cueillette des oranges. Bientôt ce sera le blé. Toutes les familles du village possèdent une basse-cour et un troupeau de moutons plus ou moins important (de cinq à deux cents moutons). Mais presque tous, hommes et femmes, doivent aussi travailler à la propriété, où ils touchent la somme dérisoire de dix dirhams par jour, pour dix heures de travail – alors qu’un kilo de viande dix-sept dirhams. Aussi, plusieurs de ces ouvriers agricoles souhaitent venir travailler en France, pour aider leur famille. Nous sommes tristes et honteux de penser à la façon dont nous accueillons chez nous les Arabes, alors qu’eux nous reçoivent avec tant de gentillesse.
Dans la journée nous découvrons les puits d’irrigation, les champs de blé, de fourrage, les orangeraies pleines d’hommes et de femmes au travail – bien que nous soyons dimanche. Nous allons voir paître les moutons. Nous roulons, nous marchons, nous suons, nous avalons des tonnes d’oranges, nous sourions, surtout. Et avec cela, nous avons pris le temps de faire la sieste sur les banquettes, dans la maison de Moisli. Nous avons pris le petit-déjeuner chez El Arâbi, le déjeuner chez Mohammed, le thé et les œufs durs chez Mustapha, le dîner chez Moisli… Nous avons été comblés de cadeaux, fleurs, fèves, oranges, sac doré, chapeau et chasse-mouches tressés pour Arno, bonbons, panier… Sans oublier l’adresse d’un cousin qui nous recevra à Marrakech.
Nous sommes partis avec l’impression de quitter les meilleurs amis du monde, la paix et la gentillesse. Désormais, pour nous, les oranges du Maroc auront une saveur toute particulière, et une couleur bien lumineuse pour les jours pluvieux de France.
Soulac
Il y a bien longtemps que je t’ai abandonné, cahier, et j’ai négligé de te raconter bien des choses.
… Mon amour pour Abdeljaghni, qui m’a fait tout remettre en question. Cette grande blessure de le quitter si tôt, sans avoir eu le temps de le connaître, de me baigner avec délices dans sa vie, à peine entrevue, mais avec quel émerveillement. Quelle aventure de l’esprit ce fut pour moi, comme du cœur et du corps !
Le mur était bleu à mi-hauteur,
et blanc jusqu’au plafond,
et moi je contemplais sans me lasser,
comme un horizon serein,
cet attouchement sans larmes
d’une bande de mur bleue
et d’une bande mur blanche
C’était l’heure de la sieste, un chaud dimanche,
dans une longue salle marocaine,
tranquillité des corps étendus
paroles rares
douceur aux cœurs,
lenteur de l’esprit qui s’en allait,
paisible,
comme une longue ligne droite,
bleue en bas et blanche en haut,
immobile, immuable,
qui s’en allait.
C’est le matin, il fait beau, je suis derrière mon comptoir, à attendre les mangeurs de glaces. C’est assez intéressant, de rester là plusieurs heures tous les jours, à regarder passer les gens. Il y en a vraiment de toutes sortes, de tous genres, et pour tous les goûts. Il y en a même, je crois, qui ne conviendraient à aucun goût.
Hier soir, j’ai regardé à la télé une émission sur la Grèce. Ce qui m’a le plus touchée, c’étaient les manifestations et les chants religieux. J’ai vraiment ressenti, dans ce christianisme orthodoxe, une vision pathétique du monde, et j’ai compris aussi pourquoi on cherche joie et paix dans la religion. Je suis vraiment attirée par les orthodoxes, j’ai l’impression de les comprendre bien mieux que les catholiques. Je me souviens du grand bonheur que j’avais éprouvé, dans cette cour d’un monastère des Météores.
J’ai envie de la Grèce tout entière, je n’y suis pas chez moi, mais j’en suis tellement amoureuse.
Il y a un vieux couple qui passe souvent (au moins quatre-vingts ans chacun), main dans la main, tout frêles et branlants. Lui porte un short, une chemise et un chapeau coloniaux, avec des lunettes de soleil et des nu-pieds en cuir. Elle, une jupe gitane noire à volants, avec des bandes multicolores, et un petit débardeur de coton moulant, rose vif, sur sa poitrine libre (d’ailleurs pas si vilaine). Cela fait plusieurs années que je les vois, lui toujours vêtu à l’identique, elle arborant de nombreuses toilettes, toujours à la pointe de la mode des teen-agers…
Pink Floyd, Money, à la « radio-vacances » de la rue de la Plage. J’ai tant écouté ce disque dans le minibus, sur les routes tortueuses de Grèce. J’en étais saoule, du vin bu au restaurant, de la musique plein les oreilles, et surtout de l’Aventure !
Tous ces gens qui passent, indifférents. Et puis un grand Arabe, des tapis sur les bras, avec un large sourire : « Adieu, ma sœur ! Ça va, là-dedans ? »
L’animateur d’Europe 1 aussi me salue, mais on dirait que c’est parce qu’il se sent obligé d’être toujours gai et gentil, jusqu’à la bêtise.
Passe aussi une fille, allemande, magnifique, minuscule short en jean, longue parure de très beaux cheveux blonds, visage adorable. La Lorelei…
Il y en a une autre, très jeune, très fine, et longue, brune, la peau mate, les cheveux tirés en arrière, dans une robe blanche légère, ample et transparente, gracieuse.
La belle Allemande, qui est française, est venue m’acheter une glace pour sa petite sœur. Quel choc ! Qu’elle est belle ! Voilà que je tombe amoureuse des filles, maintenant !
J’ai reçu une réponse de Marc Torralba en personne, des éditions du Castor Astral. Très gentille lettre, qui me fait nager dans la joie depuis deux jours. Il me propose de nous rencontrer à Soulac un de ces jours.
Pourtant je me sens bien loin d’égaler les auteurs qu’ils publient, comme Safran dont j’adore Le Chant de Talaïmannar :
Aujourd’hui je pense à toi
Aux biches de Neuchâtel
Aux lacs bleus de neige épaisse
Aux papillons bleus de Bâle
Aujourd’hui je pense à toi
La lourde chaîne au cœur
De pierre et de pavé de rue qui monte
Aux soleils des Pakistans…
Je vois passer A., son beau corps et son beau visage sont mangés par l’alcool, et cependant, et peut-être même à cause de cela, il m’attire.
Si je me décidais à aimer charnellement tous les hommes et toutes les femmes qui me font frémir, je crois que je mourrais de désespoir, car je n’y arriverais jamais.
*
à suivre


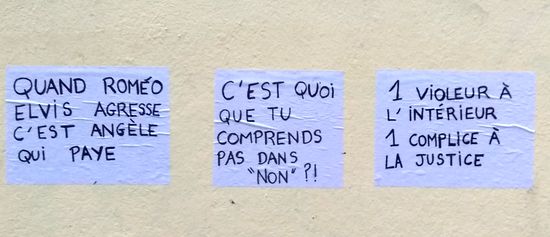

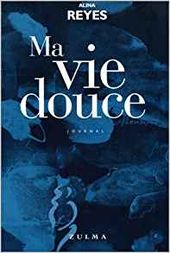


 J’ai regardé en trois jours les deux saisons de l’excellente série norvégienne Acquitted. Extrêmement attachée aux personnages des deux frères Aksel et Erik, et principalement du rejeté, Aksel, dans un phénomène d’identification plus puissant que je n’en ai jamais connu en regardant d’autres séries ni même en lisant des romans, il me semble. Et sans dévoiler la fin, je dois dire qu’elle m’a mise dans une grande colère contre les scénaristes qui ont fait commettre, dans les dernières minutes, une grave erreur à l’un des deux. Je n’arrêtais pas d’y penser, de penser à la responsabilité de l’auteur quand il conte une histoire.
J’ai regardé en trois jours les deux saisons de l’excellente série norvégienne Acquitted. Extrêmement attachée aux personnages des deux frères Aksel et Erik, et principalement du rejeté, Aksel, dans un phénomène d’identification plus puissant que je n’en ai jamais connu en regardant d’autres séries ni même en lisant des romans, il me semble. Et sans dévoiler la fin, je dois dire qu’elle m’a mise dans une grande colère contre les scénaristes qui ont fait commettre, dans les dernières minutes, une grave erreur à l’un des deux. Je n’arrêtais pas d’y penser, de penser à la responsabilité de l’auteur quand il conte une histoire.