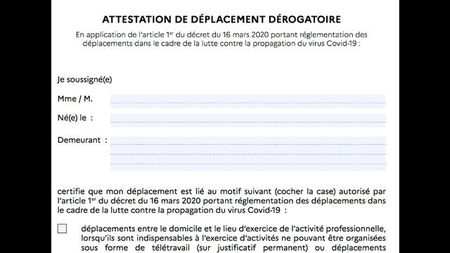Séance de yoga ce matin, séance de sport cet après-midi. Sans sortir, confinement oblige. Mais le corps veut sentir ses muscles, son sang. Il veut transpirer. Entre les deux, lecture du Moine de Lewis, dont voici des passages du chapitre II :
« « C’est là une étrange pensée, Rosario, » dit le prieur, en pénétrant dans la grotte.
« Vous ici, révérend père ! » s’écria le novice.
Aussitôt, se levant tout confus, il abaissa vite son capuchon sur sa figure. Ambrosio s’assit sur le banc et obligea le jeune homme de s’y placer près de lui.
« Il ne faut pas caresser cette disposition à la mélancolie, » dit-il. « D’où vient que vous envisagez sous un jour si favorable la misanthropie, de tous les sentiments le plus odieux ? »
(…)
Mon père ! » continua-t-il en se jetant aux pieds du moine, dont il pressait avec transport les mains sur ses lèvres, tandis que l’agitation pour un moment étouffait ses paroles, « mon père ! » continua-t-il d’une voix défaillante, « je suis une femme ! »
À cet aveu inattendu, le moine tressaillit. Le faux Rosario était prosterné à terre, comme attendant en silence la décision de son juge. D’une part, l’étonnement, de l’autre, l’appréhension, les enchaîna pour quelques minutes dans la même attitude, comme s’ils avaient été touchés par la baguette d’un magicien. Enfin, revenant de sa confusion, le moine quitta la grotte, et s’enfuit précipitamment vers le couvent.
(…)
« Peu m’importe, peu m’importe, » répliqua-t-elle avec véhémence ; « ou votre main me guidera au paradis, ou la mienne va me vouer à l’enfer. Parlez-moi, Ambrosio ! dites-moi que vous cacherez mon aventure, que je resterai votre ami et votre compagnon, ou ce poignard va boire mon sang. »
À ces mots, elle leva le bras et fit le geste de se frapper. Les yeux du moine suivaient avec terreur les mouvements de son arme. Son habit entr’ouvert laissait voir sa poitrine à demi-nue ; la pointe du fer posait sur son sein gauche, et Dieu ! quel sein ! Les rayons de la lune, qui l’éclairaient en plein, permettaient au prieur d’en observer la blancheur éblouissante ; son œil se promena avec une avidité insatiable sur le globe charmant ; une sensation jusqu’alors inconnue remplit son cœur d’un mélange d’anxiété et de volupté ; un feu dévorant courut dans tous ses membres ; le sang bouillait dans ses veines, et mille désirs effrénés emportaient son imagination.
« Arrêtez ! » cria-t-il d’une voix défaillante, « je ne résiste plus ! restez donc, enchanteresse ! restez pour ma destruction ! »
Il dit, et, quittant la place, il s’élança vers le monastère ; il regagna sa couche, la tête perdue, incapable d’agir et de penser.
(…)
Il se réveilla brûlant et fatigué. Durant son sommeil, son imagination enflammée ne lui avait présenté que les objets les plus voluptueux. Dans son rêve, Mathilde était devant lui, il revoyait encore sa gorge nue ; elle lui répétait ses protestations d’amour éternel ; elle lui entourait le cou de ses bras, et le couvrait de ses baisers ; il les rendait ; il la serrait passionnément sur sa poitrine, et — la vision s’évanouissait. Parfois son rêve lui offrait l’image de sa madone favorite, et il se figurait être à genoux devant elle ; il lui adressait des vœux, et les yeux du portrait semblaient luire sur lui avec une douceur inexprimable ; il pressait ses lèvres sur celles de la madone, et il les trouvait chaudes ; la figure s’animait, sortait de la toile, l’embrassait tendrement, et ses sens étaient incapables de supporter une volupté si exquise. Telles étaient les scènes qui occupèrent ses pensées pendant son sommeil ; ses désirs non satisfaits suscitaient devant lui les images les plus lascives et les plus excitantes, et il se ruait dans des joies qui jusqu’alors lui avaient été inconnues.
Il se jeta à bas de son lit, plein de confusion au souvenir de ses songes.
(…)
« Ce que je vous dis, j’avais résolu de ne vous le découvrir qu’au lit de mort ; le moment est arrivé. Vous ne pouvez avoir déjà oublié le jour où votre vie fut mise en danger par la morsure d’un mille-pieds. Le médecin vous abandonnait, déclarant ignorer le moyen d’extraire le venin ; j’en connaissais un, moi, et je n’ai pas hésité à l’employer. On m’avait laissée seule avec vous ; vous dormiez : j’ai défait l’appareil de votre main, j’ai baisé la plaie, et de mes lèvres sucé le poison. L’effet a été plus prompt que je n’avais cru. Je sens la mort dans mon cœur ; une heure encore, et je serai dans un meilleur monde. »
(…)
Il faisait nuit, tout était silence alentour ; la faible lueur d’une lampe solitaire tombait sur Mathilde, et répandait dans la chambre un jour sombre et mystérieux. Aucun œil indiscret, aucune oreille curieuse n’épiaient les amants ; rien ne s’entendait que les accents mélodieux de Mathilde. Ambrosio était dans la pleine vigueur de l’âge ; il voyait devant lui une femme jeune et belle, qui lui avait sauvé la vie, qui était amoureuse de lui, et que cet amour avait conduite aux portes du tombeau. Il s’assit sur le lit, sa main était toujours sur le sein de Mathilde, dont la tête reposait voluptueusement appuyée sur sa poitrine : qui peut s’étonner qu’il succombât à la tentation ? Ivre de désir, il pressa ses lèvres sur celles qui les cherchaient ; ses baisers rivalisèrent de chaleur et de passion avec ceux de Mathilde : il l’étreignit avec transport dans ses bras ; il oublia ses vœux, sa sainteté, et sa réputation ; il ne pensa qu’à jouir du plaisir et de l’occasion.
« Ambrosio ! oh ! mon Ambrosio ! » soupira-t-elle.
« À toi, à toi pour jamais ! » murmura le moine ; et il expira sur son sein. »
Matthew Gregory Lewis, Le Moine, trad. Léon de Wailly
Le livre est téléchargeable en plusieurs formats sur wikisource
*