
(auteur de l’image non identifié)
*
Pourquoi ai-je voulu voir mon rein ? Cette part encore vive et déjà morte de moi-même. Les mains du Dr Treite étaient pleines de sang. C’était à la fois sauvage et raffiné, beau, vrai. Presque bon. Si différent de la mort qui se distribue d’habitude ici, sans effusion de sang, la mort par simple anéantissement : gaz, faim, épuisement.
J’avais le projet d’écrire avec Grete, dès notre libération, un livre qui s’intitulerait « L’époque des camps de concentration ». L’écrirons-nous ? L’écrira-t-elle ? Je crois qu’elle survivra, et le fera. Évidemment il est hors de question d’écrire quoi que ce soit, ici. Nous avons juste droit à un courrier réglementé et limité. On nous fournit le papier à en-tête du camp – un papier pour chaque catégorie de prisonnières, où est imprimée, en différentes couleurs, la liste des instructions particulières à chacune. Les « anciennes » politiques (celles qui ont été internées avant la guerre) ont droit à seize lignes, deux fois par mois ; alors que les témoins de Jéhovah sont limitées à cinq lignes par mois (et le papier qu’on leur donne porte, imprimée en vert, l’inscription : Je continue à être témoin de Jéhovah ! – ce qui me rappelle encore une fois La Colonie pénitentiaire, et sa machine à imprimer les sentences dans le corps). Quant à moi, je fais partie de celles qui ont le droit d’envoyer et de recevoir seize lignes par mois.
Toute la vie au camp est méticuleusement structurée par un édifice de règlements qu’est chargée de faire appliquer une population diverse de kapos, chefs et sous-chefs. La vie s’organise entre les détenues, elles-mêmes soumises à différents statuts selon leur catégorie mais aussi selon leur influence personnelle au sein du groupe. À ce régime, beaucoup sombrent dans la résignation ou l’insensibilité, sinon dans la collaboration. Non contentes de baisser les bras, certaines s’insèrent avec un empressement servile ou opportuniste dans le nouvel ordre qui leur est imposé.
N’y trouvent-elles pas leur compte, elles qui, comme tant de nos semblables, n’ont au fond jamais rêvé de meilleur monde qu’un univers concentrationnaire, étroit, déshumanisé, où elles n’ont plus à se confronter ni à la liberté d’autrui, ni à leur propre liberté ?
Le camp est un résumé atroce des hiérarchies humaines et administratives. C’est un tableau vivant de toutes les abjections dans lesquelles nous plongent le fanatisme et la veulerie. Maintenant que je suis si proche de la mort, mon esprit a perdu de sa vivacité et de sa combativité. Mais aussi longtemps que mes forces me l’ont permis, j’ai essayé de rester lucide, de noter mentalement et d’analyser ce qui se passait ici, et de ne jamais me soumettre – puisque j’étais encore vivante -, ni à la loi qui oppresse et nous pousse à l’autocensure, ni aux discours tout prêts et aux espoirs faciles des détenues embrigadées sous une bannière politique ou religieuse.
Je ne me suis jamais résolue à écouter sans réagir les conclusions de leur pensée fabriquée, prosélytique et lâche. À maintes reprises, les unes et les autres ont tragiquement prouvé qu’elles étaient incapables de courage et de réelle fraternité, en dépit de leurs trop belles foi ou idéologie. Et comme je ne prenais pas de gants pour démonter leurs mensonges, cela m’a valu pas mal de haine – une haine bientôt partagée, car je n’ai pu empêcher que mon exécration de leurs théories meurtrières ne finît par s’attacher à ces marchandes d’illusion elles-mêmes.
En général toutes les femmes fortes, celles qui résistent à la loi du camp, finissent par être persécutées par la masse des faibles qui ne supportent pas le spectacle de leur courage et de leur intransigeance et, par contraste, celui de leur propre indignité. Malgré mon franc-parler, j’ai la chance d’être respectée par la majorité des détenues. Elles m’ont d’ailleurs donné des surnoms affectueux, comme 4711, du nom de l’eau de Cologne (parce que mon matricule est le 4714) ; ou bien « Zarewa », la souveraine. C’est peut-être l’effet de ce que j’ai appelé, il y a bien longtemps déjà, « l’art de rester debout »…
Comme je suis incapable d’obéir à la lettre au règlement, et comme je refuse d’adopter une attitude humble ou agressive, il m’arrive de provoquer la stupeur, ou la fureur, des SS. Un jour, devant les milliers de femmes réunies dans la cour pour l’appel, l’une des surveillantes était sur le point de me gifler. Je me suis contentée de la regarder dans les yeux ; et elle a laissé retomber son bras, et sa colère. Les sadiques qui ont tout pouvoir sur nous déchaînent volontiers leurs instincts pervers sur les plus affaiblies, mais reculent souvent devant le courage.
Je ne peux pas me souvenir de toutes les fois où je suis arrivée en retard à l’appel, où je ne suis pas correctement entrée dans le rang, où je me suis échappée mentalement en chantonnant, où j’ai salué Grete d’un geste de la main par-dessus les rangs, ou bien en traçant pour elle un signe dans la buée d’une vitre de mon baraquement… Toutes choses strictement interdites et qui passaient pour de dangereuses transgressions. J’aurais pu être mille fois battue ou jetée au cachot pour ces manquements à la discipline, qui faisaient frémir de frayeur ou d’indignation les autres prisonnières. Par miracle, j’ai échappé à toutes les représailles.
Peut-être les SS sentaient-elles qu’il n’y avait pas de provocation dans mon attitude, que je restais libre presque sans le faire exprès, que mon corps ne pouvait pas faire autrement que de garder une certaine indépendance. Punit-on un chat parce qu’il ne marche pas droit, ou parce qu’il nous regarde sans baisser les yeux ?
Un jour, je suis allée plaider la cause de Grete, qui depuis des semaines était enfermée au cachot, dans le noir et la solitude absolus. C’est Ramdor, le représentant de la Gestapo au camp, qui l’y avait fait jeter, la soupçonnant – à juste titre – d’avoir commis de multiples infractions à la règle pour aider les femmes les plus menacées (elle avait même réussi à sauver, avec le soutien de la surveillante en chef Langefeld, dix « Lapins »).
Folle d’inquiétude pour Grete, je parvins à obtenir une entrevue avec Ramdor – qui me l’accorda en croyant que j’avais quelque dénonciation à faire sur l’une ou l’autre de mes codétenues. Il me fallut beaucoup de diplomatie et d’assurance (qu’il ne manqua pas de juger outrée et déplacée, mais qu’il ne sanctionna pourtant pas) pour convaincre cette brute de m’écouter. Je lui arrachai la promesse de libérer Grete, en échange de révélations que je m’apprêtais à lui faire sur certaines irrégularités qui se produisaient à l’intérieur du camp.
Je lui racontai les assassinats perpétrés dans le secret du Revier, et comment les médecins qui s’y livraient récupéraient pour eux-mêmes les dents en or de leurs victimes. Évidement rien de tout cela ne pouvait le surprendre ni l’émouvoir, il devait même connaître ces pratiques banales. Mais comme ces criminels agissaient pour leur enrichissement personnel, ce qui était interdit, il dut les renvoyer et les remplacer. Ainsi fut libérée ma chère Grete.
Que serais-je devenue sans elle ? Morte, sans doute. Quelle chance j’ai eue de la rencontrer dès mon arrivée au camp, il y a quatre ans ! Les larmes me viennent quand je revois le moment où, dans la foule anonyme et misérable des détenues, nous qui étions des inconnues l’une pour l’autre, nous nous sommes reconnues au premier regard. Je pense à ces nuits où, au mépris du danger, nous fuyions nos baraquements pour nous retrouver, enfin seules, enfin libres, serrées l’une contre l’autre… Je pense encore au froid, aux mains gonflées, à la faim, aux maladies, à toutes les tortures physiques et mentales que nous avons dû endurer… Et l’instant où nous avons compris ce qui se tramait au Revier, et quelle était la destination finale des « transports noirs »… Comment aurions-nous pu survivre à tout cela, l’une sans l’autre ? Et pourtant, nous aurions pu.
*
Entre ces murs glacés, nous sommes toutes des « championnes de jeûne », et aucun public ne s’intéresse à ce spectacle.
Dans sa cage de cirque, le personnage de ta nouvelle avait fini, lui aussi, par mourir abandonné de tous. C’est alors qu’on l’avait remplacé par cette magnifique panthère qui, depuis, hante mes rêves, comme les rapaces.
*
Aujourd’hui il s’est passé quelque chose de merveilleux. J’ai reçu un colis de mon père. Tu aurais vu quelle fête ce fut dans la chambrée ! Nous avons, toutes les sept, trouvé la force de nous lever, ou de nous asseoir sur notre couchette. J’ai préparé des tartines, confiture sur tranches de gâteau. Elles étaient si heureuses, leurs yeux brillaient et elles m’appelaient maman Milena…
Nous sommes toutes mourantes ici, tu sais, mais là, nous étions prêtes à croquer de nouveau dans la vie, à pleines dents. Il y a une petite Française en face de moi, elle s’appelle Thérèse et elle est la plus malade. Elle est si maigre que je ne saurais te dire à quoi elle ressemble, seulement qu’elle est très jeune, presque une enfant, et que ses yeux paraissent immenses.
Au camp, les Françaises sont parmi les plus maltraitées, les plus méprisées par l’encadrement. Leur mortalité est particulièrement élevée, ce que nous avons trop souvent tendance à mettre sur le compte d’un manque de résistance, d’une déficience de leur race… C’est un des préjugés inscrits jusque dans certains esprits bienveillants, tant chacun de nos peuples a vécu ces dernières années refermé sur lui-même.
La vérité est qu’elles ne reçoivent presque jamais de colis : le gouvernement de Vichy se désintéresse depuis toujours de leur sort, et lors de leur arrestation les autorités françaises ne prennent même pas le soin de noter leur destination. Or, étant donné le régime de famine auquel nous sommes soumises (une louche de soupe claire aux rutabagas et 150 à 200 grammes de pain par jour pour douze heures de travail), un colis mensuel de deux kilos fait souvent la différence entre celle qui parvient à rester en vie et celle qui tombe vite d’épuisement. Et puis les Françaises sont moins disciplinées que d’autres, et donc moins « adaptables » aux contraintes du camp.
Il y avait si longtemps que cette malheureuse n’avait rien vu d’aussi bon ! De gourmandise, elle haletait. Elle a réussi à manger quelques bouchées, et ensuite, transportée de joie, elles s’est mise à chanter La Marseillaise… Nous avons toutes chanté avec elle.
Mais maintenant, la nuit revient. Elles dorment, ou essaient de dormir. Un instant j’ai pensé que tu étais le seul homme présent dans cette pièce, invisible, incognito. Aussitôt après, je me suis dit que chacune devait avoir avec elle son compagnon fantôme. En somme, notre chambre de femmes est peuplée d’hommes que nous regrettons et qui nous soutiennent, alors que nous avons eu souvent tant de mal à vivre avec eux, lorsque nous étions libres.
Que pouvons-nous savoir d’un être ? Que savons-nous de nous-même ? Que pouvons-nous mieux connaître que la chair, les mots du corps ? Mais le corps que nous voyons n’est lui-même que surface, masque. Révélateur et dissimulateur. Il est des assassins au visage d’ange. Comment savoir où se trouve la vérité ? J’ai passé ma vie à essayer d’être toujours plus lucide, et plus je devenais lucide, plus je voyais à quel point nous étions aveugles.
Viens, Franz, viens dormir près de moi.
*
à suivre – principe de la suite exposé en première note de sa catégorie

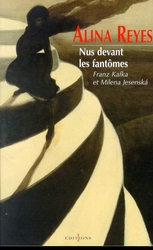 Ce livre est paru en 2000 aux Éditions 1, dans une collection dirigée par Stéphanie Chevrier. Il est toujours disponible en édition de poche
Ce livre est paru en 2000 aux Éditions 1, dans une collection dirigée par Stéphanie Chevrier. Il est toujours disponible en édition de poche