Lisant ici et là quelques-unes des dernières petites phrases de notre petite marionnette de la Phynance, je me suis exclamée :
Qu’il est con,
Ce Macron !
Que voulez-vous, on est poète ou on ne l’est pas. Ni lui ni ses conseillers ne le sont, qui régurgitent une langue de cochon, pleine de conservateurs, déchets et bas morceaux, exhausteurs de goût et autres saloperies. Les Académiciens, au lieu de se gratter la nouille sur l’écriture inclusive, feraient mieux de se soucier de cette nuisance, la langue des présidents depuis au moins Sarkozy, de plus en plus abêtie, nihiliste, mise en charpie, un crime contre l’humanité.
Hier soir dans le métro, assises en face de moi, deux vieilles bourges décolorées bavassaient logorrhéiquement en se montrant les photos de leurs petits-enfants et autres gendres sur leurs I-Phone. L’une qui manifestait une envie de déménager dit : « Tiens, je vais m’acheter quelque chose à Rambouillet ». L’autre lui fit remarquer que c’était très cher, Rambouillet. Oui, elle le savait, mais ça ne fait rien, elle avait envie de s’acheter un appartement à Rambouillet. L’autre se mit à lui conseiller d’acheter des appartements pour la défiscalisation, plutôt. Puis elles ont continué à parler des uns et des autres, untel alcoolo, tel autre escroc, ça avait l’air d’être leurs enfants ou en tout cas des proches, sans que ça émeuve plus que ça leur figure ravagée de fond de teint. Du fric partout, sur elles et dans leur conversation, de sales histoires, pour de bien misérables personnes : la France à Macron. Faut-il que l’ennui les plombe, pour que ces gens soient si tombe.
Pour moi, je travaille à rendre à la langue son sens et je me promène :




 aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes
aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes
*
 cet après-midi à Paris 5e, photo Alina Reyes
cet après-midi à Paris 5e, photo Alina Reyes







 aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes
aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes


 aujourd’hui en allant au lycée, et en en sortant, photos Alina Reyes
aujourd’hui en allant au lycée, et en en sortant, photos Alina Reyes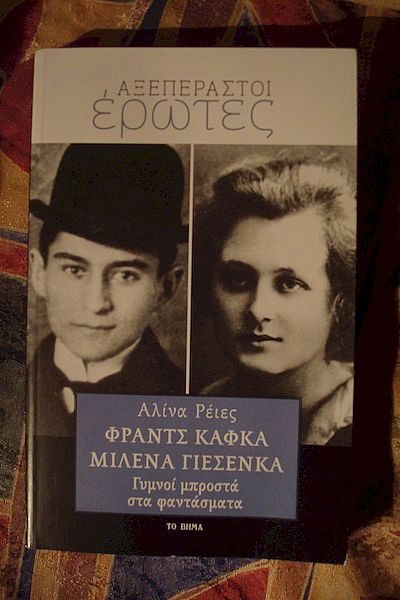
 vu du bus, à Paris, ce soir, photo Alina Reyes
vu du bus, à Paris, ce soir, photo Alina Reyes