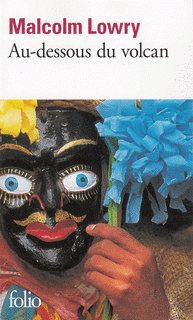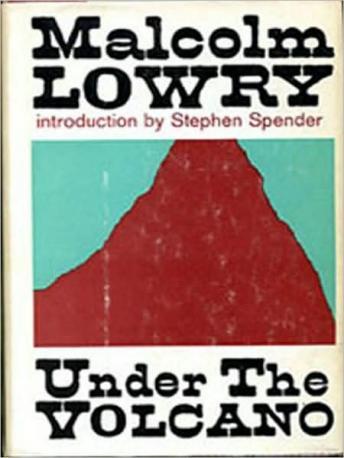Je termine cette note de lecture en différents temps sur ce livre prodigieux. À lire de bas en haut.
L’explosion du Popocatepetl, le volcan du roman, ces jours-ci
21-12-2012, 8h41
De même qu’Einstein demanda l’heure au consul du roman, dans une autre vie Arthur Cravan, qui lui aussi devait se perdre dans les eaux du Mexique, demanda un jour à André Gide : « Où en sommes-nous avec le temps ? » En attendant une tout autre réponse que celle, plate comme la terre avant la science, que lui fit l’écrivain : « il est trois heures moins le quart ». Pour sa part le consul, saisi, ne sut que désigner sans paroles au savant la pendule accrochée au mur.
L’heure tourne sur les pendules comme tout tourne dans Au-dessous du volcan, où les heures tournent, l’espace tourne dans l’ivresse perpétuelle du consul, les pensées tournent, le cosmos tourne, le texte tourne, charriant visions et réminiscences et cortèges de signes : tours, coursives, tour du monde, retour, tourner son alliance, tourbillons, escaliers en colimaçon, tournoyer, tourner en rond, carrousel, grande roue, planètes tourbillonnantes et ainsi de suite. Finalement, après la chute dans la prostitution, un calendrier en vient à désigner le futur, le mois suivant, et ce futur n’aura pas lieu pour le consul puisqu’il sera mort avant, puisque la mort est désormais fichée en lui qui n’a pas su s’empêcher de se retourner sur cette prostituée qu’il est allé chercher aux enfers, cette Yvonne égoïste repliée dans son confort, sa vie facile, ses séductions, ce mirage de si charmante apparence qui ne peut qu’entraîner dans la mort quiconque ne rejette pas la pomme qu’elle lui tend. « Votre cheval ne cherche pas à boire, Yvonne, rien qu’à se mirer dans l’eau », lui a dit et redit le demi-frère du consul, qui sans alcool, lui, a vu ce que l’ivresse s’est employée à cacher.
Je pourrais gloser encore longtemps sur ce livre aux reflets et aux terrains aussi mouvants que les représentations de l’espace-temps d’Einstein, mais je préfère me taire, ayant trouvé cela qui s’y dissimulait, cette descente d’Orphée aux enfers de l’autre, qu’il endosse. Orphée a Eurydice dans le dos, la voir là c’est voir qu’elle est perdue – c’est ainsi qu’il la perd. Le consul aussi va jusqu’au fond la voir dans sa prostitution mais au lieu d’en tirer la leçon et de poursuivre son chemin comme Orphée, il consomme lui-même la prostitution, il se perd à son tour.
« À tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront, il est l’heure de s’enivrer ; pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise », écrit Baudelaire, sous le spleen comme le consul est sous Saturne. Platon n’avait pas tort dans sa critique des poètes. La poésie sans la science a tôt fait de virer au mensonge, à la morbidité. Le consul de Lowry a échoué dans la science de la mystique. Poètes, si vous n’êtes pas prophètes, si vous n’êtes pas savants, vous courez à la mort. La réponse à la question « quelle heure est-il ? », la voici : il est l’heure.
*
20-12-2018, 13h13
« Le Trou du Golgotha… Golf = gouffre = golf »…. « Quant aux démons… ils le possédaient »… « La Machine infernale »… «Rue de la Terre-de-Feu. 666 »… Lowry injecte des signes dans son texte comme autant de loupiotes de bars, de cantinas, dans la nuit. Ou comme « le phare qui invite la tempête, et qui l’éclaire… Le Farolito ». Le Farolito étant une cantina composée « de nombreuses petites pièces, chacune plus petite et plus sombre que la précédente, s’ouvrant l’une dans l’autre, la dernière et la plus sombre de toutes pas plus grande qu’une cellule », « des antres où devaient se tramer des complots diaboliques, où se décidaient d’atroces meurtres » et où « là, comme lorsque Saturne est dans le Capricorne, la vie atteignait le fond », mais où « là aussi de grandes pensées tournoyantes flottaient dans le cerveau. »
Qu’est-ce à dire ? L’auteur n’est pas en enfer, il y va voir. Voir, comme Rimbaud voyant, voir en poète, en Orphée chargé d’en remonter Eurydice. Et Yvonne, son Eurydice, y restera. Voir cela, c’est soudain éclairer le texte d’un tout autre sens que celui qu’on lui donne habituellement. Ce n’est pas l’auteur plongé dans son ivresse qui est en enfer, c’est l’autre personnage, celui qui n’a pas l’air d’y être, cette Yvonne trompeuse à la vie apparemment si légère. Voilà : l’enfer est autre que ce qu’il a l’air d’être. Si le consul finit par y rester aussi, c’est parce que, dans son voyage, il a omis de ne pas se laisser posséder par les démons.
à suivre
*
19-12-2018, 9h
Qu’est-ce que l’enfer ? En paraphrasant Baudelaire selon qui la plus grande ruse du diable est de faire croire qu’il n’existe pas, on pourrait dire que la plus grande ruse de l’enfer est de faire croire qu’il est autre que ce qu’il est. En fait il y a au moins deux enfers : celui de la vie vécue dans la faute, et celui qu’incarnent pour d’autres ceux qui vivent dans l’enfer de la faute.
Je donne tout de suite un exemple vécu : un jour, apercevant Jean-Marie Le Pen dans un couloir de télévision, j’ai ressenti une nausée tenace. Cet homme, comme d’autres, incarnait l’enfer. L’enfer de la faute morale ne ressemble pas a priori à l’enfer qu’on se représente habituellement, lieu de souffrances et de tortures. Ceux qui vivent dans l’enfer de la faute morale ne semblent pas souffrants. La lâcheté, la duplicité, la méchanceté, la cruauté, la perversité, l’avidité, l’égoïsme, la vanité, tout ce qui entraîne la dissimulation, l’hypocrisie, la manipulation, tout ce qui fait commettre délibérément le mal, la trahison, le crime, la torture, la persécution, génère l’enfer de la souffrance pour autrui. Mais l’enfer de la souffrance n’exclut pas l’innocence, la droiture, l’amour, la grâce. Alors que l’enfer de la faute en est privé.
L’innocence, la droiture, l’amour, la grâce, sont les qualités que les fauteurs, s’en sachant privés par leur faute, veulent détruire chez autrui ; à défaut d’y parvenir, ils s’emploient à détruire autrui. Tel est l’enfer. Bien plus ordinaire et terrible que toutes les représentations picturales et poétiques, y comprises dantesques, qu’on a pu en donner. Les visions cauchemardesques de l’enfer ne sont pas l’enfer. Elles sont des cauchemars qui nous servent tout à la fois à évacuer un peu l’angoisse de l’enfer et à masquer le véritable enfer, dans son épouvantable et lamentable banalité.
Ainsi le personnage de Malcolm Lowry, qui a peut-être commis une faute dans son passé (le texte reste vague sur cette question), est-il peut-être quelqu’un qui croit devoir expier en se plongeant lui-même en enfer. Mais son enfer n’en est pas un. Seulement un cauchemar échappatoire qu’il se projette en s’injectant de l’alcool. Pourquoi ? Il se peut qu’il ait peur de retomber dans la faute, qu’il ait peur de lui-même – et qu’il compte sur l’ivresse pour se neutraliser. Il se peut aussi qu’il cherche à fuir un mal qui lui aurait été fait, un mal lointain, enraciné dans l’enfance de l’âme : un mal qui n’est pas dit, un mal trop infernal que le texte et l’ivresse veulent occulter.
à suivre
*
18-12-2018, 12h06
En douze chapitres, le roman suit les douze heures, dans cette grande fête des morts, d’un personnage entouré de trois autres et de leurs douze mois passés. Le personnage principal, consul ivrogne, a souvent été comparé à Faust. Mais s’il y a un diable dans cette histoire, c’est l’alcool. Et il n’y a pas de pacte. Lowry dans sa préface évoque l’ivresse mystique. En poète, il semble penser que ce qui compte, c’est l’ivresse. Or cela se passe très mal pour son alter ego dans le roman, et cela finit logiquement très mal, pour son personnage comme pour l’auteur quelques années plus tard. Pourquoi ? Parce que l’ivresse mystique demande une science. Or le consul visite les enfers en consul, en consultant. Il y est spectateur, au sens debordien du terme, et au sens platonicien, regardant défiler sous le volcan (dans la caverne) les images de son délire sans pouvoir les contrôler. Car s’il n’a pas passé de pacte avec le diable, il ne refuse pas non plus le pacte que le diable ne cesse de lui reproposer sans cesse, de verre en verre. Il n’y a pas dans ce qu’il vit de combat spirituel. Et en réalité il n’a pas plus de connaissance de l’enfer qu’il n’en a du paradis. Ce qu’il vit ne tient ni de l’un ni de l’autre, encore moins de quelque purgatoire. Ce qu’il vit, c’est une plongée sans connaissance dans l’illusion et l’impuissance. Dans un monde artificiel semblable à celui qui tente de régner sur l’humanité, en ce moment même.
à suivre
*
17-12-2018, 10 h 39
Que répondre à Einstein quand vous le croisez par hasard dans un couloir et qu’il vous demande l’heure ?
La scène est placée au milieu du livre, comme le récit de la mort d’un innocent est placé au milieu du Coran, livre tout aussi désordonné (en fait, d’un ordre particulier, parfait) que celui de Malcolm Lowry. Deux situations vertigineuses comme deux trous noirs au centre de chacun des textes, deux trous de volcans d’où jaillit le chaos des textes, roulements sans fin de deux ivresses mystiques (car l’ivresse alcoolique de Lowry est aussi explicitement mystique, celle d’un homme qui cherche à écrire un livre sur la Kabbale).
En fait il y a deux volcans dans le livre, bien qu’il n’en titre qu’un. Qu’importe le volcan, pourvu qu’on ait l’ivresse ? Non, nous le verrons. Pour l’instant, n’oublions pas d’où nous partons : le temps, la mort (le livre se déroule le jour des morts au Mexique).
à suivre
*
Extraits de l’introduction à ce chef-d’œuvre (traduit de l’anglais par Stephen Spriel avec la collaboration de Clarisse Francillon et de l’auteur) par Maurice Nadeau : ici