






aujourd’hui au Jardin des Plantes, photos Alina Reyes
*







aujourd’hui au Jardin des Plantes, photos Alina Reyes
*

écriture et dessins de Kafka
*
J’aime t’imaginer à cheval. J’aime t’imaginer en train de nager, ramer, marcher, faire de la gymnastique… Toutes ces activités physiques que tu pratiquais avec enthousiasme et bonheur.
Tu t’approches du cheval, flattes son encolure, prononces quelques mots. Le cheval te regarde de côté, fixement, perçoit ta douceur, ta bienveillance. Il tourne la tête, l’approche de toi. Il t’accepte.
*
Tu avais acheté un canot, amarré derrière chez toi sur la Moldau. Tu allais ramer, souvent, longtemps, dans le silence du fleuve. Le dimanche, des amis se joignaient à toi. Vous partiez à plusieurs embarcations sur la Vltava – la Moldau -, naviguiez pendant des heures en manœuvrant acrobatiquement à travers les barrages. Max disait : j’admirais la virtuosité avec laquelle Franz nageait et ramait, il dirigeait avec une dextérité particulière une nacelle. Il était toujours plus habile et plus hardi que moi, et il avait l’art de vous abandonner à votre sort dans les moments critiques, avec un sourire presque cruel qui semblait dire : « Aide-toi toi-même. » Combien j’ai aimé ce sourire, dans lequel il y avait tant de confiance et d’encouragement ! La fécondité de Franz en variantes sportives inédites me paraissait inépuisable.
Cher Max ! J’admire la qualité de l’amitié qu’il te manifesta toute sa vie. Son soutien ne fit jamais défaut, qu’il s’agît de t’encourager à écrire ou de t’aider à ne pas te replier dans la solitude en te faisant fréquenter les cafés et rencontrer du monde. Il fut un écrivain célèbre bien avant toi – qui cherchais si peu à l’être, et jusqu’ici ne le fut jamais vraiment -, et pourtant il n’y eut jamais de rivalité entre vous. Il fut celui à qui tu fis lire ton premier texte littéraire (Description d’un combat), et dès lors, bien que tu n’eusses jamais publié une ligne et fusses un parfait inconnu, il n’hésita pas à te considérer comme l’un des plus grands auteurs de langue allemande, allant même jusqu’à citer ton nom parmi ceux d’illustres contemporains dans un article pour une revue littéraire !
Indéfectible Max… À moi aussi il fut d’un secours précieux lorsque, après que tu m’eus interdit de continuer à t’écrire, je pus épancher ma douleur en lui adressant des lettres où je lui parlais de toi, de moi, et de la façon dont notre amour s’était révélé impossible.
Max est aussi extraverti que tu étais introverti : il était déjà une figure dans le riche milieu littéraire de Prague, couvert de relations, coureur de jupons, engagé dans son temps, amoureux inconditionnel de la vie (malgré une enfance maladive et une déviation de la colonne vertébrale qui le laissa chétif et difforme)… Clairvoyant et généreux, il décela tout de suite ton génie, et n’eut de cesse de le faire savoir – y compris à toi-même, dans tes périodes de doute et de stérilité littéraire.
En tout cela, il agit avec beaucoup de délicatesse, sachant combien tu pouvais être ombrageux. Car tu étais loin d’être aussi docile qu’on l’imagine parfois, à considérer ton doux regard et tes humbles postures. Tu pouvais être au contraire – tu l’étais même presque toujours – intraitable. Spécialement en ce qui concernait tes idées, et plus que tout, la littérature.
C’est d’ailleurs ainsi que tu avais rencontré Max. Après avoir tâté de la chimie, puis de la philosophie, puis des lettres (discipline en laquelle les professeurs te parurent trop stupides), tu t’étais décidé pour le droit – dont tu allais ingurgiter la peu ragoûtante matière jusqu’au doctorat. Max venait de faire, à l’université où vous étiez tous les deux étudiants, un exposé sur Schopenhauer, au cours duquel il avait traité Nietzsche de charlatan. Quand il eût fini, tu l’interpellas et t’engageas avec lui dans une interminable conversation où tu lui reprochais la simplicité de ses jugements par d’assez âpres critiques, se souvenait Max. Mais il ne t’en tint nullement rigueur, et vous devîntes inséparables.
C’est aussi une divergence d’opinion qui t’avait éloigné, avant la terminale, de ton camarade Hugo Bergmann. Il était devenu sioniste, et toi socialiste, antisioniste et athée. Hugo, qui était alors ton ami depuis plusieurs années, était un garçon brillant et solide dans ses engagements, aussi bien intellectuellement que sur le terrain. Pourtant, malgré toute son assurance, il avoua plus tard qu’il lui avait été très difficile d’encaisser tes attaques déterminées et sans concession de ses convictions.
Tu étais un ami dévoué, attentif, plein d’esprit et d’entrain, mais aussi terriblement exigeant. On devrait pouvoir dire qu’on tombe en amitié comme on tombe amoureux. C’est ce qui m’est arrivé ici avec Grete : nous sommes tombées en amitié l’une pour l’autre.
Et c’est ce qui t’est arrivé avec Oskar Pollak, pendant ta dernière année de lycée. Il était la vedette de l’école, un personnage hors du commun, champion de ski et grand amateur d’art. Bien qu’ils eussent son âge, à côté de lui tous les autres élèves avaient l’air de petits garçons. Tu lui vouas un sentiment exclusif et presque jaloux – telle était souvent ta façon d’être, en ce domaine – et si ton amitié avec Max perdura, ce fut sûrement parce qu’il sut te comprendre et te ménager, tout en conservant sa propre liberté.
*
Toutes les fins de semaines, tu organisais des excursions dans les environs de Prague. Avec Max, votre ami philosophe Felix Weltsch, et même une fois Franz Werfel, ce jeune poète qui en garda un mémorable coup de soleil sur les fesses. Vous partiez le dimanche, ou dès le samedi midi, marchiez des heures, nagiez dans les rivières, dormiez dans de modestes refuges, faisant provision de grand air et arpentant infatigablement la campagne. Vous preniez aussi des bains de soleil, dans une espèce de frénésie de rencontre physique avec les éléments. Durant l’été, vous profitiez de vos deux ou trois semaines de congés pour voyager, légers, guidés par le plaisir, et vous dormiez dans les auberges les moins chères… Il vous arriva même de finir la nuit sur un banc. L’important c’était d’être ailleurs, de se déplacer, de s’amuser entre amis, loin, bien loin de toutes les contraintes de votre vie pragoise. Mouvement, fantaisie, liberté, insouciance… Nous devenions des enfants folâtres, dit Max, nous inventions les tours les plus extraordinaires et les plus charmants…
C’est ainsi que tu voyageas avec Max et son frère Otto, puis en Italie du Nord, à Weimar, et par deux fois, à Paris. Les Tchèques étaient très proches de la culture française, alors que vous, les juifs « allemands » de Prague, étiez plutôt tournés vers Vienne, Munich et Berlin. Cependant tu adorais Flaubert, et tu avais de la sympathie pour Napoléon.
Ton deuxième voyage à Paris fut agréable, mais le premier fut un désastre. Vous aviez fait halte à Nuremberg pour une nuit. Au matin, tu t’éveillas couvert de boutons. À Paris, on diagnostiqua une furonculose. Tu laissas tes amis sur place, et rentras seul.
Après cette déception, tu t’intéressas davantage à la culture française, d’autant que Paul Claudel, consul à Prague, employait tout son prestige à la défendre et à la propager. Plus tard, en 1938 – mais tu n’étais plus là pour le voir – l’attitude de la France et de ses intellectuels, hélas !, changea. Tant qu’il s’était agi pour eux de nous exporter leur bonne parole, tout avait été parfait. Mais quand nous eûmes besoin de leur soutien, il n’y eut plus personne à nos côtés. En janvier 1939, dans Pritomnost, j’envoyai cette lettre ouverte à Jules Romains et à ses pairs :
Si en son temps la France a décidé de conclure une alliance avec nous, c’est que la France y trouvait son intérêt (…) Si la France ne s’est pas trouvée à nos côtés, au moment décisif, elle nous a trahis, cela ne fait pas de doute. Mais, ce faisant, elle s’est aussi trahie elle-même (…) Le peuple (…) pardonne plus facilement une hostilité ouverte qu’une trahison enrubannée. Chez nous, aujourd’hui, dans les villages et dans les usines, quand ils parlent des Allemands, les gens disent : « Y a pas à dire, ils savent s’y prendre ! » Et ce qu’ils disent des Français – je préfère ne pas le répéter.
*
À Prague, le rythme de ta vie était bien plus régulier : bureau-repos-Arco, et la nuit pour écrire. De huit heures à quatorze heures, tu t’acquittais avec sérieux et dévouement de ta fonction aux « Assurances ouvrières contre les accidents pour le royaume de Bohême », une administration dont tu connaissais chaque rouage, et où tu étais apprécié de chacun, tant d’un point de vue humain que professionnel, et à tous les niveaux de la hiérarchie. L’après-midi tu faisais une sieste, puis une ou deux heures de promenade, le plus souvent avec Max. Parfois vous alliez à la piscine, ou bien tu partais ramer sur la Moldau, ou encore monter à cheval.
Le soir, vous vous retrouviez au café Arco, écrivains, philosophes, poètes, artistes, à refaire le monde tout en buvant des bières. C’est dans une dizaine de ces cafés pour tous milieux que se trouvait concentrée la vie des Pragois. Ils pouvaient y passer des journées entières, attablés devant un café, et bavarder à perte de vue dans le brouhaha général, tandis qu’à l’arrière-salle, souvent, on jouait au billard. Comme tu l’avais noté, c’est dans les cafés que l’on pouvait librement discuter avec des inconnus et se sentir proche des autres hommes sans être corseté par des obligations, des conventions ou des hiérarchies rigides.
Si tu appréciais l’atmosphère des cafés, c’est aussi parce qu’ils relevaient de ce que tu appelais « cette zone frontière entre la solitude et la vie en commun », la seule « contrée » où tu parvenais à vivre malgré son inconfort. En dehors du café, tu pouvais te sentir bien en compagnie de deux ou trois proches ; dès que tu te trouvais dans une société plus nombreuse, tu étais mal à l’aise et désemparé.
Les « Arconautes », comme disait leur ennemi Karl Kraus, faisaient chaque soir leur petite révolution en chambre, élaborant des pamphlets et ne sachant plus qu’inventer en matière d’obscénité et d’ésotérisme bon marché pour choquer le bourgeois – puisque la nouvelle religion du bourgeois était la science. Mais on comptait aussi parmi eux nombre d’intellectuels de grande valeur, qui faisaient de Prague un foyer de culture et de création.
Et puis il fallait bien s’amuser, et plusieurs fois par semaine tu allais au théâtre, et vous terminiez la soirée par des virées entre amis dans les cafés ou au bordel, ou encore en ville, en quelque galante compagnie.
Le mardi, vous assistiez aux soirées de Berta Fanta qui, avec le soutien d’Hugo Bergmann et de Felix Weltsch, organisait des conférences et recevait l’élite intellectuelle de la ville. On pouvait aussi bien y parler de littérature, de philosophie ou de psychanalyse que de relativité et de quantas, puisqu’y vinrent le mathématicien Kowalewski, le physicien Franck, et même Einstein, alors jeune professeur à l’université de Prague.
Tu te passionnas pour le théâtre yiddish. On te voyait au club des jeunes anarchistes, et aussi aux deux réunions mensuelles au café Louvre, avec les disciples de Franz Brentano. Mais tu t’en lassas, ainsi que de l’Arco, ainsi que du cercle Fanta, ainsi que des bordels. Car tu avais besoin de temps pour écrire, ta vie était inconcevable sans l’écriture, elle primait sur tout. Ne pas écrire te rendait malade et, même les périodes de bonheur, quand elles t’enlevaient l’envie d’écrire, finissaient par te paraître insupportables.
Une soirée et la moitié de la nuit, parfois la nuit entière, n’étaient pas de trop pour écrire, convoquer ce fantôme qui était en toi et qui voulait parler. Ou plutôt pour convoquer l’écrivain, l’être vrai, alors que le fantôme, c’était ce Dr Franz Kafka que chacun connaissait, celui qui se rendait à son travail, sortait, faisait des projets de mariage, se conformait aux mouvements des autres comme si lui et eux n’étaient ni plus libres, ni plus conscients, ni plus réels que des ombres sur un écran.
L’ordre qui ne s’adressait qu’à toi était de plus en plus impérieux, de plus en plus irrésistible. À la fois la faim et le gouffre, le désir et la jouissance, l’appel et le départ. Être vivant, c’était être écrivant.
*
à suivre, selon le principe exposé en note 1 de sa catégorie

à Paris, rue Mouffetard aujourd’hui, photo Alina Reyes
*
Pour le combattant de la vérité l’exclusion ; pour l’exclu pas de sorties, pas de vacances, pas de voyages, pas même de déplacements possibles ; mais toujours la possibilité de se promener… et de s’échapper en regardant des séries, où du moins nul ne peut s’interposer dans les épisodes déjà tournés.
Ne jamais, jamais, jamais se rendre aux pourris et à leur système. Les laisser s’agiter dans leur tombe, et loin de leur puanteur, vivre.
*



















aujourd’hui à Paris 13e, photos Alina Reyes
*





aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes
*

aujourd’hui au Jardin des Plantes, photo Alina Reyes
*
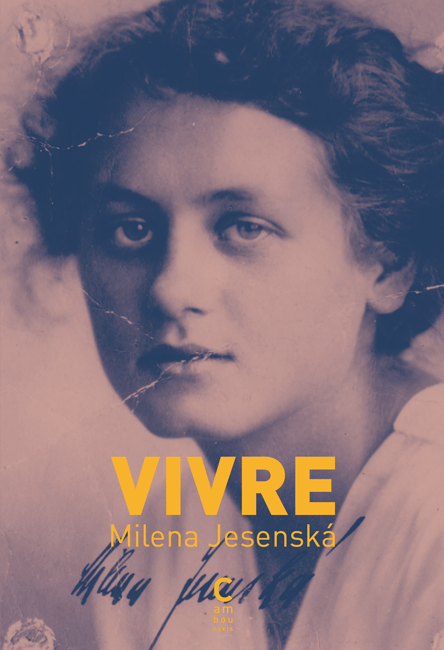
couverture de l’excellent recueil des chroniques et articles politiques de Milena Jesenska
*
Je crois que tu aspirais à changer de peau.
Devenir panthère au lieu de jeûneur ; ou cet autre animal : une jeune fille qui s’étire, au lieu d’un misérable voyageur de commerce.
L’instinct…
Haine du singe savant.
À force de renoncement, changer de peau.
Moi, j’aspirais à changer de jour (j’étais encore assez animale).
À force de rage, atteindre l’aube.
Dépouillée, mais re-naissante à un autre jour.
Pourtant je vais mourir. Trop tôt, moi aussi. Un de ces matins, je ne te verrai plus passer par la fenêtre ! Et le corbeau ne me verra pas non plus.
Franz, je te voulais vivant !
Au moins, viens en rêve et couche-toi sur moi !
Une fois entré en moi, tu changeras de peau. Et moi, emplie de toi comme un solide bateau, j’atteindrai l’aube une fois encore.
*
Ma mère mourut. Je noyai mon chagrin dans les larmes, et je m’autorisai enfin à sortir de chez moi. J’avais treize ans, je voulais vivre.
Il n’y avait plus que mon père et moi à la maison – c’est-à-dire que la plupart du temps, il n’y avait plus personne. Mon père était bien trop pris par ses activités professionnelles et mondaines pour s’occuper de moi ou seulement surveiller mes allées et venues. Le seul garçon qu’il avait eu était mort en bas âge. Il me considérait donc tour à tour comme son fils et sa fille.
Comme sa fille, lorsqu’il m’avait obligée, pendant des mois et des années, à rester confinée à la maison avec ma mère, et à veiller sur elle quand sa maladie s’était aggravée.
Comme son fils, lorsqu’il m’avait inscrite au lycée Minerva, le premier et très réputé lycée pour filles de Prague, où l’on recevait une éducation égale à celle des garçons – et même supérieure, car l’enseignement y était à la fois moins rigide et plus ouvert que celui qui te fut imposé au lycée de la Vieille Ville.
Comme sa fille encore, lorsqu’ayant eu vent de mes frasques (qui n’étaient autres que ces exercices de liberté et de découverte qu’on pratique à l’adolescence, et pour lesquels on montre ordinairement assez d’indulgence aux garçons), il entrait dans des colères terribles.
J’aurais tant aimé à être la petite chérie de ce père prestigieux, qui, comme il l’aurait fait pour un garçon, n’hésitait pas à me frapper pour me punir. Pourquoi ne cherchait-il pas à se consoler auprès de moi de la perte de ma mère ? Je me cachais ces sentiments, mais j’étais profondément frustrée de constater qu’il continuait à mener sa vie comme avant, comme s’il n’avait jamais eu besoin ni d’elle ni de moi. Tout ce qui semblait l’intéresser, c’était son ambition de me faire mener, plus tard, des études de médecine. Pour le reste, son attitude démontrait que la vie n’avait d’intérêt pour lui qu’en dehors du foyer. Et malgré moi, j’adoptai le même comportement – quoiqu’il pût m’en coûter.
Avec Stasa et Jarmila, nous formions un trio d’effrontées qui défrayait la chronique. D’une manière générale, les « minervistes » étaient émancipées. Rares étaient les filles qui avaient accès au lycée : nous constituions une sorte d’élite. Par la suite, la plupart des filles de Minerva ont obtenu d’ailleurs des postes importants dans la société.
Je me souviens avec émotion de ma première rentrée au lycée. C’était en 1907, j’avais onze ans. Papa et moi, pour une fois complices, avions choisi notre tenue avec un soin particulier, alliant l’élégance et l’originalité. Il m’avait accompagnée jusqu’au portail – j’avais conscience que nous avions tous les deux beaucoup d’allure, et que de nombreux regards se posaient sur nous. Il portait mes livres, avec la plus exquise galanterie paternelle. Maman m’avait fait faire, par notre couturière, un bel ensemble taillé dans un tissu souple aux tons gris, et comme une femme je portais sur mes boucles blondes enfantines un large chapeau de velours sombre qu’illuminait un ruban de couleur.
Un sentiment nouveau se faisait jour en moi : j’allais aimer merveilleusement la vie, l’aventure de la vie ; j’étais faite pour les plaisirs de la vie.
Stasa et Jarmila entraient aussi dans l’adolescence avec une grande intrépidité. Nous étions avides de nous livrer à toutes les fantaisies qui nous passaient par la tête. Nos corps changeaient, nous devenions des femmes tout en gardant l’esprit de jeu des enfants que nous étions encore. J’amenais Jarmila chez ma couturière, et aux frais de mon père – qui n’avait ni le temps ni le goût de vérifier les notes -, elle se faisait faire exactement les mêmes vêtements que moi : par amitié, elle avait décidé de me copier en tout, imitant jusqu’à mon écriture. Stasa avait deux ans de moins que moi, mais une personnalité très affirmée. Elle était déjà rayonnante de beauté, et nous nous aimions toutes les deux si follement que l’on disait partout que nous étions lesbiennes.
Peu nous importaient les rumeurs. Au fond, elles ne faisaient que pimenter encore un peu la vie que nous nous inventions chaque jour, et nous n’avions jamais assez de piment. Munies d’ordonnances et d’argent que j’avais volés à mon père, nous nous procurions toutes sortes de médicaments dont nous usions comme de drogues – je lui dérobais aussi de la morphine. Le désir de vie nous brûlait, il nous fallait expérimenter le plus de sensations possible. Parfois nous étions enthousiastes jusqu’au délire, et parfois sombres jusqu’au désespoir, mais toujours nous nous soutenions, liées par l’amitié comme on peut l’être à cet âge.
Nous nous faisions faire de longues jupes moulantes, des vêtements fluides, et près du corps, qui paraissaient scandaleux et que nous mettions pour passer et repasser, bras dessus bras dessous en riant, devant les cafés remplis d’Allemands du Prikope, une avenue que des jeunes filles tchèques ne pouvaient fréquenter que par provocation. Pourtant, là aussi, nous étions guidées avant tout par un esprit de découverte et un désir d’échange. Prague était si bien partagée entre ses diverses cultures et nationalités que traverser un quartier allemand revenait, pour nous, à nous aventurer en territoire étranger.
Seule, je me livrais aussi à certains actes que les autres appelaient excentricités, mais qui n’étaient pour moi que des pulsions naturelles et innocentes. J’aimais sortir de chez moi à l’aube – toujours mon goût de l’aube -, ou bien la nuit. J’aimais la proximité de la mort et celle de l’érotisme.
Une fois, au lever du jour, je fus arrêtée par la police pour avoir cueilli des magnolias dans un parc public. J’adorais les fleurs, j’en avais toujours sur moi, chez moi, à offrir, à respirer…
À la tombée du soir, la nuit ou même en plein jour, j’allais déambuler dans les allées du cimetière, et je finissais par grimper sur le mur pour m’y asseoir et rêver avec les morts, avec ma mère, rêver à mes malheurs de vivante qui se dissolvaient peu à peu dans la douceur des tombes.
Je ne sais pourquoi, il me revient en mémoire, comme une mélopée, ce passage des Histoires pragoises de Rilke :
C’était une belle nuit d’automne avec des nuages rapides. La lumière incertaine était juste assez patiente pour permettre à Bohusch de reconnaître une plaque de marbre sur laquelle entre les branches foisonnantes il pouvait lire:Bitezlav Bohusch, portier ducal. Et chaque fois que le petit lisait cela, il commençait à creuser avec des ongles avides dans l’herbe et la terre, jusqu’à ce (…) que ses ongles commençassent à crisser sur le bois lisse du grand cercueil jaune. (…) Crac! La planche cède comme une vitre, et Bohusch étend sa main brûlante (…) et ne parvient pas à comprendre pourquoi ses deux mains sanglantes ne retrouvent pas la voix de son père.
*
Je me plongeai dans la découverte de la littérature avec le même appétit de vivre. Je lus Dostoïevski, Hamsun, Tolstoï, Thomas Mann, Byron, Oscar Wilde… Je trouvai dans les livres une réponse à ma soif d’absolu, avec le sentiment d’apprendre la vie infiniment plus vite que celles de mes camarades qui lisaient peu. Parfois j’écrivais un poème, et puis je le brûlais. Deux de mes tantes étaient romancières, et peut-être rêvais-je moi aussi de devenir écrivain. Mais je n’osais me l’avouer, tant je me faisais une haute idée de la littérature. Aujourd’hui je ne l’avouerais toujours pas, et de toutes façons il est trop tard. Être ta traductrice, tel fut mon plaisir d’écrivain – et il fut grand.
D’instinct, je savais que rien ne me serait plus précieux dans la vie que la littérature et l’amour. L’amour m’attirait, mais je me méfiais de ce sentiment. Oh, je ne prétends pas que je ne tombais pas amoureuse ! Je tombais sans cesse amoureuse. Mais quelque chose me disait que ce n’était qu’un effet de mon imagination débordante, et je n’avais pas envie de me laisser gruger par mon propre imaginaire. J’en goûtais les joies et les tourments tout en sachant qu’il ne s’agissait que d’un jeu, un jeu indispensable pour vivre et auquel tout le monde se livre, mais qui peut devenir dangereux si on lui abandonne sa lucidité. Confusément, je me rendais compte qu’on élevait les filles dans l’attente de l’amour pour pouvoir, ensuite, au nom de ce prétendu amour, les sacrifier.
Que ne suis-je restée toujours aussi sage ! Mais si, plus tard, je me suis entièrement donnée à l’amour, c’est parce que j’avais appris à être davantage confiante envers la vie – et cela est encore plus important que le désir de ne jamais perdre le contrôle de soi-même.
En attendant, je n’avais aucun exemple, autour de moi, de ces amours magnifiques que l’on rencontre dans les livres. En revanche, la misère des sentiments humains, que je retrouvais détaillée dans les romans, se révélait partout, aussi bien dans mon entourage immédiat que dans les journaux.
C’est peut-être pourquoi je m’intéressais davantage au sexe qu’au sentiment. Le sexe me paraissait plus innocent, moins dangereux et plus excitant : il était à mes yeux un phénomène physique, naturel, moins porteur de mensonge et plus authentique. Le sexe était une montagne à escalader ; alors que le sentiment n’était qu’un parcours dans la galerie des glaces d’une quelconque fête foraine.
Je voyais, je sentais se transformer mon corps et mes sens s’éveiller, et je savais que mon corps ne mentait pas. Alors que mon imagination inventait de plus en plus de mensonges, afin de me permettre de passer à travers les mailles du filet que le monde tendait autour de moi. Je mentais à mon père, je mentais à mes professeurs, je mentais parfois à mes amies, et, le plus grave – comme je n’allais pas tarder à m’en rendre compte – je me mentais à moi-même.
*
À notre âge, il n’était pas question d’avoir une relation charnelle complète avec un homme, et le reste (je devrais dire les restes) ne m’intéressait pas. Je n’avais pas gardé un très bon souvenir de mon premier baiser. L’inachevé, me semblait-il, n’était acceptable que s’il était occasionnel, et non rendu nécessaire par une quelconque obligation sociale. Dans notre milieu de jeunes filles et jeunes gens, l’inachevé était un système, celui de la morale hypocrite qui gouvernait notre monde. Je décidai qu’en ce qui me concernait, ce serait tout, ou rien.
Cependant j’avais envie de connaître ce qui se passait entre un corps d’homme et un corps de femme. Tu sais combien tout était fait pour nous séparer, jeunes gens et jeunes filles. Vous, les garçons, pouviez le moment venu accéder facilement aux « petites femmes ». Toutes ces femmes du peuple étaient mises à votre disposition pour que vous ne vous en preniez pas à nous, jeunes filles de bonne famille. Elles étaient condamnées à la petite vertu, et nous à la vertu tout court, ce qui n’était pas plus enviable. Un soir, je trouvai une idée pour commencer à assouvir ma curiosité sur la question.
Une fois mon père rentré et couché, je ressortis, seule dans les rues sombres de Prague. Les halos jaunes des lampadaires effleuraient, sans parvenir à les trouer, la nuit et le brouillard accrochés à chaque mur de la ville comme des tentures de cuir noir. Les passants surgissaient et disparaissaient de ce théâtre obscur, et j’avançais sans réfléchir dans le labyrinthe des rues au sein duquel je me déplaçais sans la moindre angoisse, me fiant à mon intuition.
J’étais maintenant dans la vieille ville. J’entrai dans un hôtel qui me parut assez louche – ce fut peut-être celui où tu as passé ta « première nuit » ? Je n’avais pas l’intention de me livrer à la débauche, mais de m’instruire. Je passai une partie de la nuit à guetter les allées et venues dans le couloir, à essayer de percevoir à travers les murs quelque chose du commerce sexuel qui pouvait s’y livrer. Le moindre bruit de porte me plongeait dans des rêveries érotiques qui me tenaillaient le ventre. Je finis par m’endormir.
J’étais partie dans l’intention de rentrer chez moi avant l’aube, mais je m’éveillai à huit heures passées. Évidemment, je trouvai mon père hors de lui. Évidemment, j’inventai des histoires auxquelles il ne crut pas, et il y eut encore des cris, des pleurs et du drame.
*
J’avais l’impression que quelqu’un cherchait à sortir de moi. J’étais de plus en plus agitée, j’avais des accès de mélancolie, je m’étourdissais avec mes amies, je rentrais moins régulièrement à la maison, pour ne plus voir mon père ni provoquer sa colère quand je le voyais. Je m’affichais dans les rues avec Stasa, sachant les rumeurs qui couraient sur notre amitié pourtant innocente, mais qui rendaient son père malade, au point qu’il faisait tout pour l’éloigner de moi.
Nous arpentions les trottoirs en nous gavant de chocolat et de bananes, ce fruit rare dont nous raffolions et qui semblait nous rendre plus scandaleuses encore aux yeux de la bonne société… Nous portions de longs vêtements flottants et colorés, nos cheveux dénoués caressaient ou fouettaient nos visages au gré des vents, j’achetais des fleurs par brassées, l’argent n’avait pas d’importance, que ce fût le mien ou celui des autres, et l’on pouvait avoir tout ce qu’on voulait à condition de le vouloir vraiment. Beaucoup de minervistes étaient comme nous, faisant souffler sur la ville un désir de liberté, un désir de vie… Nous nous amusions follement, et parfois nous avions envie de mourir.
*
Comme le personnage d’un livre que je venais de lire, je tombai amoureuse d’un chanteur, Hilbert Vavra. C’est avec lui, dans sa chambre, qu’eut lieu ma « première fois ». J’étais exaltée, pleine d’adoration, mais je déchantai. Il n’était ni délicat, ni amoureux. Pas très intéressant, comme je le compris trop tard. J’essayai d’y croire encore quelque temps, puis je cherchai mon bonheur ailleurs.
Je fis la connaissance du peintre Scheiner, qui me demanda de lui servir de modèle ; il travaillait alors à l’illustration de contes. Je rencontrai d’autres peintres du même groupe. J’acceptai de poser pour l’un d’eux, nue. Je te l’ai dit, je n’ai pas de pudeur physique. Maintenant que mon corps était tout à fait formé, je m’y étais habituée, il ne m’embarrassait plus, et j’étais ravie d’en faire une espèce d’objet d’art. Je ne trouvais pas indécent de me déshabiller devant un peintre tant il me semblait que c’était pure routine, pour lui. Je m’aperçus que tel n’était pas le cas.
C’est ainsi que je « connus » mon deuxième homme dans un atelier, au milieu des couleurs, des toiles et des pinceaux. J’étais venue là sans arrière-pensée – je n’étais pas amoureuse de ce garçon – et pourtant je me laissai faire sans protester. En sortant de chez lui, j’hésitais entre la joie et la colère. J’étais en colère contre lui, mais plus encore contre moi, car j’avais le sentiment de ne pas m’être assumée dans cette affaire, de m’être menti, abusée. Mais je revins le lendemain, alors qu’il ne m’attendait pas.
Quelques semaines plus tard, j’étais enceinte. Mon père m’envoya chez un médecin de ses amis, qui me fit avorter. Je restai cloîtrée pendant trois jours, en me jurant de n’avoir plus jamais à refaire cela. Mon père, voyant mon état, cessa quelque temps de me harceler avec ses éternels reproches.
*
J’ai quinze ans, j’ai l’air d’une femme.
Je parais aussi mûre qu’une adulte, et pas seulement physiquement. Si j’ai vieilli aussi vite, c’est peut-être parce que ma mère n’est plus là ; pour remplacer ma mère en moi. Pourtant, parfois, je me sens encore une enfant. J’aime de tout mon cœur Albina Honzakonva, qui est l’une de mes professeurs. Je lui envoie de longues lettres que j’écris à l’encre violette sur du papier mauve. Je lui parle de musique, de livres et de peinture. Je la remercie de ne m’avoir jamais traitée d’exaltée. Je sais que Mme Honzakonva me comprend, même si elle ne me répond jamais.
*
à suivre (voir principe en 1ère note de sa catégorie)