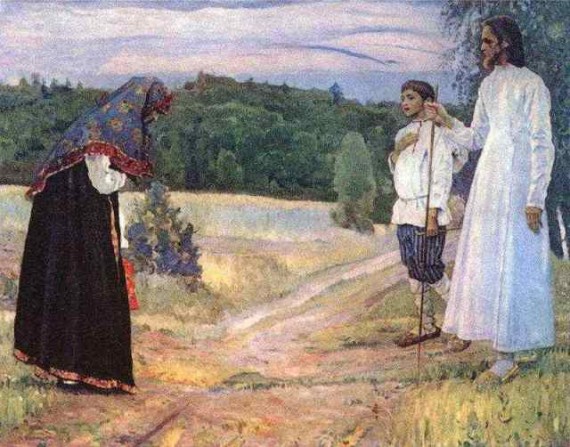Miniature du XVe siècle : BNF
Miniature du XVe siècle : BNF
« Il n’est pas question ici, bien entendu, de tenter une incursion dans les profondeurs de la philosophie hégélienne. » (p.361)
« La longue introduction aux Leçons sur la philosophie de l’histoire est une sorte d’hymne au soleil de l’esprit : contrairement à celui du soleil cosmique, son mouvement « n’est pas une répétition de soi-même… ; l’aspect changeant que l’esprit se donne dans des figures toujours nouvelles est essentiellement progrès ». » (p.362)
Et Lubac cite encore Hegel :
« … C’est l’esprit qui conduit à la vérité, il connaît toute chose et pénètre même les profondeurs de la Divinité… L’évolution de l’esprit qui pense, dont le point de départ a été cette révélation de l’Être divin (dans l’Écriture sainte), doit s’élever enfin jusqu’à saisir par la pensée aussi, ce qui fut proposé d’abord à l’esprit qui sent et représente. Il doit être temps enfin de comprendre aussi cette riche production de la raison créatrice : l’histoire universelle. » (pp367-368)
« Après deux siècles bientôt écoulés, la philosophie de Hegel n’a pas cessé d’exercer sa fascination, ni d’inspirer une pluralité foisonnante d’interprétations, de déductions, de transformations et de critiques. « Certes, Hegel a cherché à ne dire qu’une seule chose, à être cohérent, univoque, mais ce qu’il dit est en fait fort complexe… Sans doute tient-il beaucoup au fait historique ; avouons cependant que l’accent est tellement mis sur le savoir de Dieu que la Trinité immanente semble parfois s’estomper derrière le savoir vécu, la théorie de la Trinité et le Christ lui-même derrière la christologie » [M. Régnier] » (p.375)
« La relation de Schelling à Joachim de Flore est plus explicite et plus proche de celle de Hegel (…). En 1800, dans le Système de l’Idéalisme transcendental, il donne une première ébauche de ce qu’est pour lui « la loi de l’histoire » qui doit aboutir au « règne de la liberté » : c’est celle d’une révélation de la divinité qui se fait en trois temps, aux limites indécises : le temps de la force aveugle où domine le hasard, le temps de la nature qui découvre et impose sa loi, le temps de la Providence qui est aussi pour l’homme celui de la liberté ; quand commencera ce troisième temps, « on ne saurait le dire ; mais on peut affirmer que, le jour où il aura commencé, aura aussi commencé le règne de Dieu ». (p.378)
Selon Schelling, montre Lubac, « l’Église de Jean [sera] « la seconde, la nouvelle Jérusalem », que le Voyant de l’Apocalypse a contemplée descendant du ciel. Elle rassemblera tous les chrétiens aujourd’hui séparés, elle accueillera dans son sein les Juifs et les païens ; elle subsistera en elle-même, sans contrainte et sans limite, sans autorité extérieure de quelque sorte que ce soit ; chacun s’y adjoindra librement ; ce sera la seule religion vraiment publique, la religion de la race humaine, possédant en elle le plus éminent savoir. » (p.390)
« Interprété dans tous les sens, livré aux passions de l’époque, le mythe schellingien n’en a pas moins exercé, plus en profondeur, une action stimulante. La seule chose que nous ayons à retenir, et que les prochains chapitres confirmeront, c’est que, dans les milieux les plus hautement intellectuels comme dans d’autres plus modestes de fait sinon d’intention, au cours du dix-neuvième et du vingtième siècles, le joachimisme, en se transformant, poursuit sa carrière et continue de fructifier. » (p.393)
*
Ainsi arrivons-nous à la fin du premier tome de cet ouvrage d’Henri de Lubac. Acheminons-nous maintenant vers la Pentecôte avec le deuxième tome, de Saint-Simon à nos jours, qui nous fera voyager par bien des personnalités… pour n’en citer que quelques-unes, Fourier, Michelet, Marx, Hitler, Dostoïevski…
Et surtout avec la pensée que la vision première de Joachim, qui continue à vivre, errer et fructifier depuis plus de huit siècles, ne peut que contenir une vérité, une prescience et un pressentiment d’une vérité à venir, encore à dégager de sa gangue mais appelée par l’histoire à voir le jour, comme l’est la figure de l’ange cherchée par le sculpteur dans le bloc de marbre.
Si l’utopie doit avoir lieu, ce lieu ne peut qu’être « céleste ». Or le travail du christianisme, son travail invisible à travers l’histoire, qui est aussi plus ou moins confusément celui de toutes les religions, est de rendre toujours plus proche de l’homme le royaume des Cieux. À la différence près qu’ils n’aboliront pas les religions mais les réconcilieront et participeront à exhausser leur essence, les Pèlerins d’Amour seront en quelque sorte l’Église de Jean entr’aperçue par Schelling. Non pas une église de pierre ni de territoire ni d’institution, mais une église qui, tout en oeuvrant en bonne intelligence ou communion avec les peuples et les institutions, aura pour lieu la vie même qui s’y vivra, unissant tous les hommes par des liens souples et libres, maintenus dans un Ordre lumineux parce qu’il ne sera qu’obéissance à Dieu. (voir Voyage). À suivre ! Avec mon coeur donné.


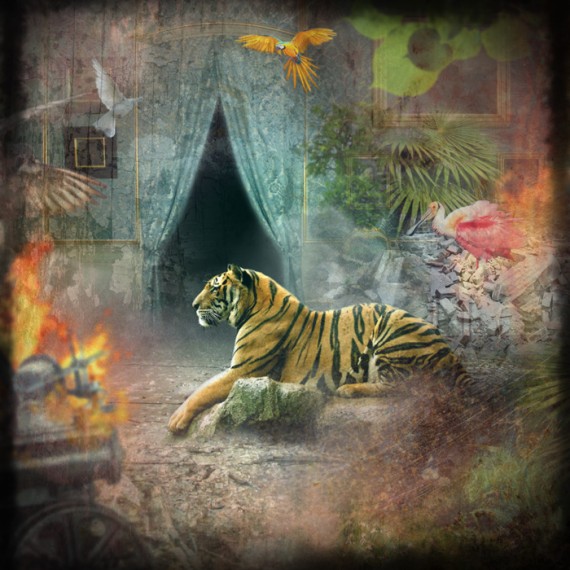 Mia Mäkilä,
Mia Mäkilä,