Le duc du Livre du Duc des vrais amants a-t-il jamais existé ? Si le texte et ses illustrations ne donnent aucun indice sur l’identité de celui dont l’auteure se présente comme une sorte de ghostwriter, c’est peut-être que celui pour qui elle dit je est lui-même le fantôme de l’affaire, son prétexte pour se faire homme le temps d’un roman, tout en gardant la main, sa main de femme et de militante de la cause des femmes qui récupère la romance mensongère racontée par les hommes pour finalement la démystifier. Et après tout, peu importe qu’il ait existé ou non. Car, tout séduisant amoureux qu’il soit, il n’est qu’un stéréotype. Il est même moins que l’archétype de l’amant tel que l’élaborèrent les romans de fin amor. En ce début du XVe siècle, on est déjà bien loin de Chrétien de Troyes, de ses chevaliers valeureux et aventureux, hommes accomplis affrontant tous les dragons du monde par sens de l’honneur, le leur, celui du roi et celui de leur dame. Ici l’amant est un tout jeune adolescent qu’une jeune femme mariée à un vieil homme pénible va jouer à séduire. Mais le garçon charmant finira en homme comme les autres, et de l’histoire d’amour il ne restera rien, qu’un sentiment de gâchis.
Christine, comme elle s’appelait elle-même, essaie-t-elle donc de décourager les femmes de l’amour ? Loin de là. Elle-même, avant la mort de son aimé, a vécu avec lui le grand et heureux amour. Ils étaient tous les deux jeunes et amoureux, ils ont eu trois enfants, et bien des indices dans ce livre montrent qu’elle a goûté pleinement tous les plaisirs de l’amour, qu’ils ont joui d’une vie amoureuse ardente et accomplie. Christine ne repousse pas l’amour, au contraire : elle met en garde les femmes contre le faux amour. En a-t-elle eu l’expérience après son veuvage ou l’a-t-elle simplement observé autour d’elle ? En tout cas c’est une femme redoutablement intelligente qui dénonce l’illusion d’aimer à laquelle hommes et femmes s’adonnent volontiers comme à un vin, une drogue. Ainsi que le fera bien après elle Stanley Kubrick dans son film testament, Eyes Wide Shut, Christine déploie le spectacle de l’ivresse amoureuse, mais jusqu’à la gueule de bois. Et quand Nicole Kidman, au bout du compte, déclare à la fin du film qu’il ne reste au vrai couple qu’à laisser au néant les fantômes et à recommencer à faire l’amour, il semble que Christine ait écrit son dialogue. Ce sont bien souvent les conseils les plus simples qui sont les plus subtils et les plus difficiles à comprendre. Lors d’une journée consacrée à ce livre, j’ai entendu des agrégatives se demander comment on pouvait qualifier de féministe une auteure qui donnait aux femmes, à travers le personnage de Sibylle de la Tour, des recommandations telles que de s’occuper de leurs travaux et de leur foyer plutôt que de rêver d’amants. Mais Christine de Pizan fait la même chose qu’allait faire Cervantès deux siècles plus tard avec son Don Quichotte : non seulement prévenir les hommes et les femmes contre les vaines rêveries, mais aussi et surtout, ce faisant, dénoncer une société rigide, hypocrite, bornée, liberticide. Car le rêve ne devient néfaste que parce qu’il est interdit de cité.
« Dames d’honneur, sans vouloir vous déplaire,
Je vous conseille que de vous vous écartiez
Les imposteurs, croyez-moi, sans colère,
De ces méchantes langues il faut vous méfier »,
écrit Sybille à l’amante. Et si l’histoire est narrée par le duc, et selon son point de vue, c’est elle, la dame, qui a les derniers mots du livre :
« Seule Mort l’en détachera,
Qui m’a atteinte. »*
Mais le poème virtuose qu’est le roman de Christine de Pizan recèle d’autres audaces que celles de sa versification et que cet avertissement implacable, qui démolit la romance et met à nu des fonctionnements sociaux tristes et mortifères sous leurs apparences joyeuses. Il est aussi, malicieusement, une ode à l’amour physique, l’amour vrai pour le coup, l’amour des vrais amants. Alors que la règle de l’amour courtois est de ne pas aller « jusqu’au bout » et de se contenter de flirter indéfiniment, hypocritement et stérilement, les embrassades étant permises mais pas la pénétration, Christine ponctue son texte de petits mots aussi importants que les petites fleurs dans les tapisseries de dame et de licorne, et qui sont autant d’évocations des plaisirs bien crus et nus de l’amour. Le jeune homme, auprès de la dame, « attise son tison ardent » (celui qui est dans son cœur, bien sûr) et se compare à « un papillon attiré par la chandelle » ou à « un oisillon qui se prend à la glu » ; une fois de retour chez lui, seul, il s’étend sur son lit sans pouvoir dormir, obsédé par « la douce et exquise piqûre d’amour » ; une autre fois, il prend congé d’elle « après la dégustation des épices » ; d’autres fois la dame se fait préparer des bains et invite le jeune homme à venir la voir prendre son bain (Ains joye avoye perfaitte, « j’avais une joie parfaite », Se ce m’estoit grant delis, « mon plaisir était immense »…) ; une autre fois, loin d’elle, il lui écrit que son ardent désir l’épuise, lui parle de ses transports d’ardeur ; une autre fois encore, il lui demande de le soulager de son désir amoureux ; une autre fois, après l’amour, il se félicite d’avoir pris la peine de tenir les chevaux (il s’est déguisé en palefrenier pour la rejoindre) pour en retirer « un si doux et délicieux salaire ». Ces chevaux ne sont-ils pas aussi ceux de son ardeur qu’il a retenue pour la rejoindre ? Au milieu du XIIIe siècle, dans le Fabliau de la dame qui demandait l’avoine pour Morel, Morel était le nom d’un cheval noir pour lequel, par code entre eux, la dame demandait à son mari de l’avoine, c’est-à-dire, en décodé, lui signalait qu’elle désirait faire l’amour. Comprenons aussi que tout au début, quand le jeune puceau s’en va à la chasse aux connilz, ces « lapins » désignent aussi, déjà, les cons, les sexes des femmes. À n’en pas douter, Christine n’ignorait rien de l’amour vrai, et duc signifiant conducteur, son livre pourrait s’intituler Guide des vrais amants.
* éd Champion Classiques, traduction Dominique Demartini et Didier Lechat





 *
*

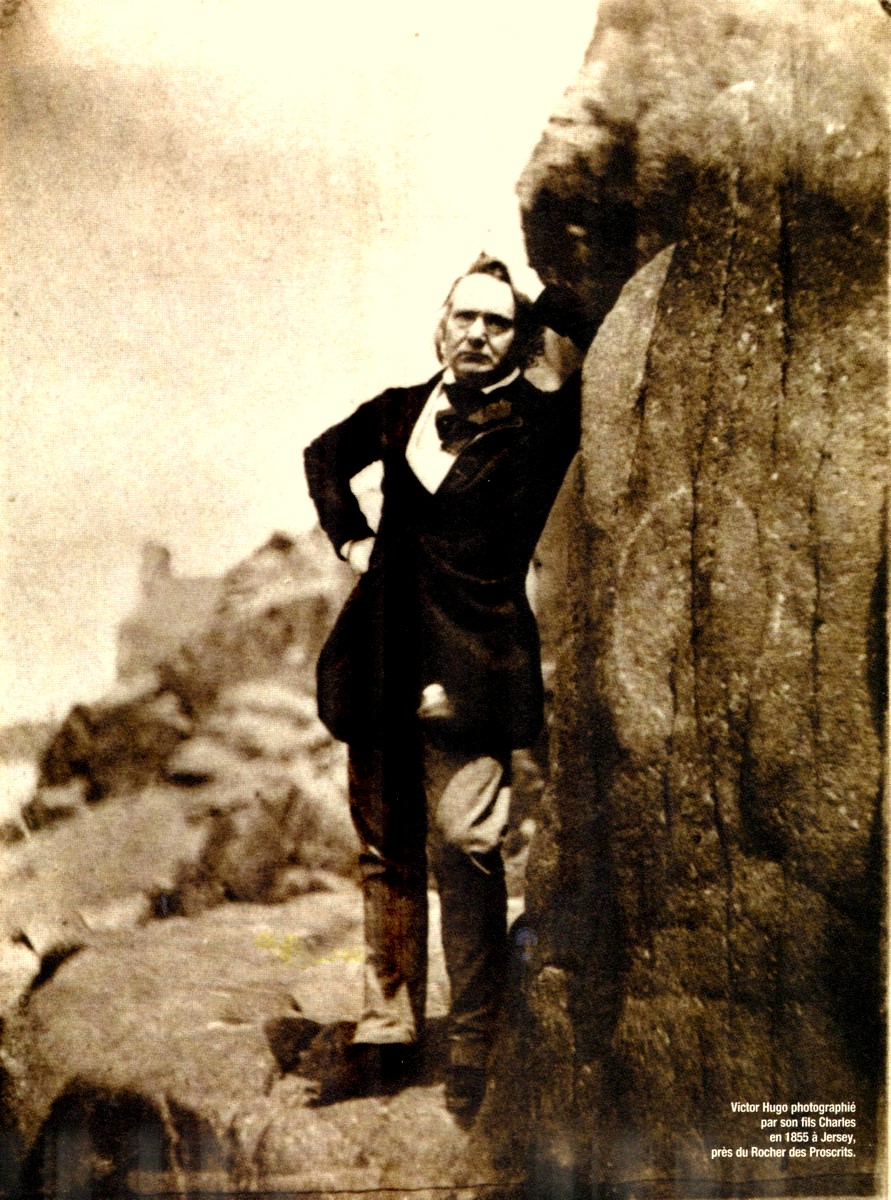
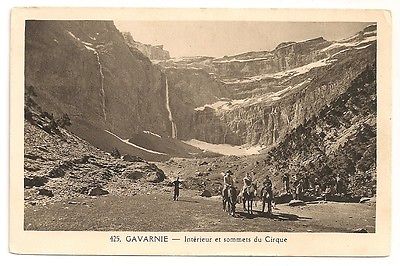 Cirque de Gavarnie
Cirque de Gavarnie

