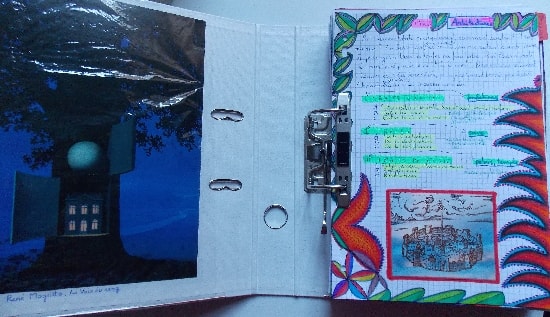Aujourd’hui j’ai une longue « parole du jour » à donner. Longue, lucide et magnifique, d’une extraordinaire humanité, notamment envers les femmes, ce qui est rare. Il s’agit d’un passage du livre de Georges Darien La belle France, paru en 1901 après avoir été refusé par la plupart des éditeurs. Un texte de combat, qui peut toujours grandement servir.

Georges Darien
Je suis un Sans-patrie. Je n’ai pas de patrie. Je voudrais bien en avoir une, mais je n’en ai pas. On me l’a volée, ma patrie !
À tous ceux qui ne possèdent point, à tous les pauvres, à tous ceux qui ne sont ni les laquais des riches ni les bouffons à leur service, on a volé leur patrie. À tous ceux qui sont obligés de travailler pour des salaires dérisoires qui leur permettent à peine de réparer leurs forces ; à tous ceux qui ne trouvent même pas, en retour de la sueur de sang qu’ils offrent, le morceau de pain qu’ils demandent ; à tous ceux que leur cerveau plein désigne à la haine et dont le large front est brisé par l’indigence comme par un casque de torture ; à tous ceux qui errent le long des rues ou des routes en quête d’une pitance et d’un gîte ; à tous ceux qui renoncent à gagner leur vie et se décident à l’empoigner ; à tous ceux qui crèvent dans le fossé du chemin, dans leur taudis, sur le grabat de l’hôpital ou dans la cellule de la prison ; à tous ceux que tue la misère physique ou morale, ou qui se donnent la mort pour lui échapper — on a volé leur patrie.
À toutes celles dont l’immense labeur sans salaire permet à l’abjecte Société de continuer sa route imbécile ; à toutes celles dont les flancs féconds fournissent aux éternels Molochs la chair humaine qu’ils réclament sans trêve ; à toutes celles dont les flancs stériles sont voués aux luxures assoupissantes et dont les baisers mettent le baume du vice sur les plaies vives de l’universelle détresse ; à toutes celles dont l’intelligence, la bonté, la délicatesse et la grandeur d’âme sont étouffées ainsi que des plantes mauvaises ; à toutes celles qui sont victimes, esclaves, damnées — on a volé leur patrie.
Aux tout petits, dont l’âme à peine ouverte est flétrie par les émanations pestilentielles du marécage social ; aux enfants dont l’esprit a conçu des rêves que la liberté aurait fait naître grandioses, et que font avorter les grilles de la misère — on a volé leur patrie.
Aux armées de pauvres, aux hordes de misérables, et même aux bandes de brigands — on a volé leur patrie.
Je crie : Au voleur !
De tous les hommes auxquels on fait croire que le patriotisme est un sentiment abstrait, indéfinissable, qu’il ne faut point tenter d’expliquer, mais pour lequel il est utile et glorieux de souffrir et de mourir — on a chouriné l’esprit afin de les empêcher de voir ce que c’est que la patrie.
De toutes les femmes auxquelles on persuade qu’elles doivent, par patriotisme, mener une existence de dévouement morne et stérile, de noire abnégation, qu’elles doivent sacrifier sans espoir de récompense leur vie, leurs affections, leurs rêves, et les fruits de leurs entrailles — on a étranglé l’âme et arraché le cœur afin de les empêcher de voir ce que c’est que la patrie.
De tous les enfants dont on farcit le cerveau d’abominables et ridicules légendes et des infâmes leçons du catéchisme religioso-civique — on a étouffé l’intelligence afin de les empêcher de voir ce que c’est que la patrie.
De tous ceux qui travaillent, qui peinent, qui souffrent, et qui n’ont rien — on a tué l’énergie afin de les empêcher de voir ce que c’est que la patrie.
Je crie : À l’assassin !
Je crie révolte, et je crie vengeance. Je crie : En voilà assez !
Voleurs et assassins — les Riches — sont parvenus, grâce à la terreur et à l’ignorance qu’ils imposent et entretiennent, à obscurcir complètement la signification du mot : Patrie. Avec l’aide de leurs deux valets, le Prêtre armé du mensonge et le Soldat qui brandit un sabre, ils ont réussi à interdire à ceux qu’ils ont spoliés la compréhension du mot ; et, devant ce vocable qui ne doit avoir pour elles aucun sens précis, les victimes des Possédants ont dû se courber avec respect, jurer de tout sacrifier, existence comprise, aux choses mystérieuses qu’il représente. Mieux encore. Devant les menaces et les murmures des déshérités, las enfin de l’épouvantable servitude qui pèse depuis si longtemps sur leurs épaules, les Riches se sont émus ; non contents d’avoir à leur service le prêtre et le soldat, ils ont enrôlé dans leur garde les pions et les sous-diacres de l’écritoire : et ces drôles, s’emparant du mot qu’il ne faut pas qu’on comprenne, le déguisant davantage encore sous le clinquant des phrases et les oripeaux de la déclamation, sont arrivés à en faire un spectre qu’ils opposent aux plaintes et aux demandes des Pauvres — ce mot, qui doit être la synthèse de toutes les revendications sociales !
La Patrie, aujourd’hui, — et, hélas ! depuis si longtemps ! — la Patrie, c’est la somme des privilèges dont jouissent les richards d’un pays. Les heureux qui monopolisent la fortune ont le monopole de la patrie. Les malheureux n’ont pas de patrie. Quand on leur dit qu’il faut aimer la patrie, c’est comme si on leur disait qu’il faut aimer les prérogatives de leurs oppresseurs ; quand on leur dit qu’il faut défendre la patrie, c’est comme si on leur disait qu’il faut défendre les apanages de ceux qui les tiennent sous le joug. C’est une farce abjecte. C’est une comédie sinistre.
Un bœuf de Durham est de race anglaise ; un mulet du Poitou est de race française ; (il n’y a de race française que pour les animaux) ; ces bêtes ont-elles une patrie ? Les pauvres n’en ont pas davantage. Quel intérêt les attache au pays dans lequel les fit naître le hasard ? Aucun. Quelle garantie d’existence leur donne leur naissance sur un certain point du globe ? Aucune. Quelle solidarité existe entre eux, qui n’ont rien, et ceux qui possèdent tout ? Aucune. Quels liens, quel contrat moral, même quels efforts communs, voire quelles légendes, les lient les uns aux autres ? Néant. Et réellement, quel antagonisme d’intérêts peut exister entre un pauvre allemand et un pauvre français ? Quelles inimitiés raisonnables peuvent les diviser ? Il est bien certain qu’ils sont frères d’infortune, que les différences que l’on peut constater entre eux ne sont que superficielles. Proudhon avait raison de dire que la nationalité est surtout le résultat d’institutions politiques communes ou de la contrainte exercée par le Pouvoir central. Oui, c’est l’habitude d’une servitude identique ; la marque du même joug sur le cou.
Ces Pauvres, que les Riches arment les uns contre les autres pour les luttes que provoquent les querelles de vanité ou les rivalités commerciales, ces Pauvres eurent, il y a quelque trente-cinq ans, l’idée la plus extraordinaire et la plus touchante qui se puisse concevoir. Ils constatèrent que, quel que fût leur pays d’origine, ils n’avaient pas de patrie ; et ils résolurent de se lier les uns auxautres par une association fraternelle, l’Internationale des Travailleurs. Songez-y ; songez à ce fait formidable : les travailleurs européens, dans le dernier tiers du xixe siècle, déclarant qu’ils n’ont pas de patrie, et qu’ils n’ont pas de patrie parce qu’ils travaillent. Quel jour jeté sur notre civilisation !
Que les conclusions soient fausses que tirèrent les déshérités de cette triste constatation, je n’en disconviens pas. L’émancipation des travailleurs n’est pas un problème simplement local ou national, certainement ; pourtant, on peut en entreprendre la solution nationalement, pour commencer. Quant à la nécessité de subordonner tout mouvement politique au grand but de l’émancipation économique, elle est plus que discutable ; les événements de 1870, qui suivirent de quatre ans le congrès de Genève, se chargèrent de le prouver. Mais peu importe, pour le moment. Le grand fait subsiste qu’en 1866, les Pauvres affirmaient à l’unanimité qu’ils n’avaient point de patrie.
Ils n’en ont pas ; non. Les rapports de non-possédant à possédant sont pires, souvent, que n’étaient autrefois les rapports d’esclaves à maîtres. L’esclave, d’ailleurs, n’avait pas de patrie ; mais on ne lui disait pas qu’il en avait une. Aujourd’hui, l’on jure aux malheureux qu’ils ont une patrie ; on les engage à en être fiers, et à se montrer dignes d’elle en renonçant à toute autre préoccupation que celle de sa défense. En vérité, ce n’est même point le passé qui triomphe ; c’est quelque chose de plus hideux encore. Jadis, on ne connaissait pas l’immonde hypocrisie qui a cours maintenant. Les vieux spectres n’ont point cessé de hanter notre existence, mais l’imposture nouveau jeu les a drapés dans des linceuls neufs, dont Tartufe tient la queue.
Si les pauvres ont fini par s’apercevoir qu’ils n’avaient pas de patrie, il ne leur est pas encore venu à l’esprit, malheureusement, de chercher à savoir au juste ce que c’est que la Patrie ; et, ayant réussi à le savoir, d’en réclamer une. Car toute la question est là : s’ils admettent, comme le faisait l’Internationale, que les revendications politiques particulières doivent céder le pas aux revendications économiques générales ; s’ils admettent que les déshérités, afin de devenir citoyens du monde, doivent d’abord renoncer à la qualité de citoyens de leur pays (ou, au moins, renoncer à réclamer cette qualité pleine et entière, effective) ; s’ils admettent qu’afin de mettre un terme aux spoliations dont ils sont victimes d’un bout à l’autre du globe ils doivent s’abstenir d’abord de s’attaquer aux filous qui les dépouillent chez eux — ils sont perdus ; ils ne réussiront jamais à briser leurs chaînes ; ou ils n’y parviendront qu’au bout d’un temps très long. — Si, au contraire, ils cherchent à se rendre compte de la cause primordiale de leur sujétion ; si, l’ayant découverte, l’ayant réduite, pour ainsi dire, à son expression la plus nette et la plus simple, ils s’attaquent à cette cause avec énergie, avec ténacité, avec une volonté terrible qui refuse de se laisser détourner de son but — alors, leur succès est assuré ; et s’ils savent faire usage d’une politique très simple, dédaigneuse des vieux rouages de la politique bourgeoise, ce succès se manifestera très rapidement.
*
Le livre vient d’être réédité aux éditions Prairial
Il peut aussi être lu en ligne sur Wikisource, par exemple. Les vieilleries du pays qu’il y dénonce sont toujours en place, et toujours plus vieilles et plombées, plombantes. Ce que j’appellerais la maison, plutôt que la patrie, a bien besoin d’un coup de balai.
*