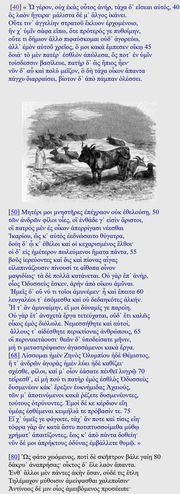J’actualise cette note à mesure de ma lecture d’Almudena Grandes… et du constat de l’indigence de la presse française à son propos.
29-11-21
Je me suis remise à lire Le cœur glacé au milieu de la nuit, captivée par la puissance de la langue d’Almudena Grandes. Dans la journée les pages évoquant la journée de fête des républicains espagnols de Paris à l’annonce de la mort de Franco m’avaient déjà sidérée. Dans la nuit un autre épisode, celui de la visite du grand-père et de sa petite-fille à une famille riche, m’a aussi abasourdie. Il y a très longtemps que je n’ai pas lu quelque chose d’aussi puissant. Je suis à la fête, d’avoir enfin trouvé une auteure contemporaine que je puisse lire, qui vaille à ce point d’être lue. Nous sommes très loin en France d’avoir quiconque d’aussi puissant, oubliez les stars, oubliez tous les prix Goncourt et autres de ces nombreuses dernières années. Et même dans la littérature étrangère : on a encensé Toni Morrisson ? Je l’ai lue, c’est une bonne auteure, mais vraiment pas extraordinaire, visiblement inspirée de Faulkner mais pas à sa hauteur. Almudena Grandes, elle, a une voix unique. On sent ça tout de suite, quand on connaît intimement la littérature. La différence entre ce qui est talentueux et ce qui est exceptionnel.
L’Espagne est en deuil de sa grande écrivaine, toute la presse lui rend hommage, tous les médias, à la télé on interroge les gens dans la rue sur elle, ils témoignent, comme auraient témoigné les Français à la mort de Victor Hugo. Mais en France personne n’en parle. Un article dans le Huff Post, quelques autres rapides évocations ici et là mais en ce lundi matin 11 heures où j’écris, deux jours après l’annonce de sa mort, rien dans les grands médias culturels de référence, Le Monde, Le Figaro, L’Obs, Libération, etc. – tous ne parlent que de la mort d’un styliste de LVMH. Les milliardaires aux commandes de la presse française ? Le fait est que la presse française ne s’intéresse pas à une grande auteure engagée dans des combats de gauche, historienne de formation, qui a beaucoup travaillé sur les suites de la guerre civile espagnole. Si elle était américaine, oui, sûrement, là, ce serait mode, comme LVMH, ce serait bankable. Pourtant on ne peut même pas dire qu’Almudena Grandes soit un génie inconnu, elle a vendu des millions de livres. Et ne serait-ce que pour évoquer l’émotion provoquée par sa mort chez nos voisins espagnols, les journalistes devraient se fendre d’un article, tout simplement pour faire leur travail, qui est d’informer. L’Europe, ça leur dit quelque chose ? Ou ils ne voient que leur petit hexagone, et son grand mentor yankee ?
*
28-11-21
« regardez ce ciel, comme la sierra est nette, on voit jusqu’à Navacerrada, quelle belle matinée, cet air réveillerait un mort, on a une de ces chances… Almudena Grandes, Le cœur glacé
Je me rends compte, en apprenant qu’elle est morte hier, que je n’ai jamais lu Almudena Grandes. J’ai toujours eu l’impression de connaître cette importante auteure espagnole parce que, née quatre ans après moi, elle a publié un an après moi son premier roman, un premier roman érotique comme mon premier roman, qui avait eu un grand succès, comme le mien. J’étais en Espagne pour faire la promotion de mon premier roman quand on parlait du sien, qui venait de sortir. Puis dans ses romans et textes suivants, elle s’est intéressée à l’histoire et à la politique de son pays, notamment aux années d’après la guerre civile. Quoique nos façons d’écrire soient très différentes l’une de l’autre, j’ai l’impression que vient de partir l’un de mes doubles – ces doubles inscrits dans mon nom d’auteur, emprunté à une nouvelle d’un autre hispanophone, Cortazar.
Voici donc un autre de mes doubles passé de l’autre côté, d’où il va m’enseigner. Je viens d’emprunter l’un de ses livres, et je vais donc la lire pour la première fois. J’en reparlerai. Merci à toi, Almudena, dont le prénom signifie en arabe la citadelle.
*
… et j’ai signé pour une primaire populaire qui puisse éviter une répétition en forme de chantage Macron/extrême-droite au second tour