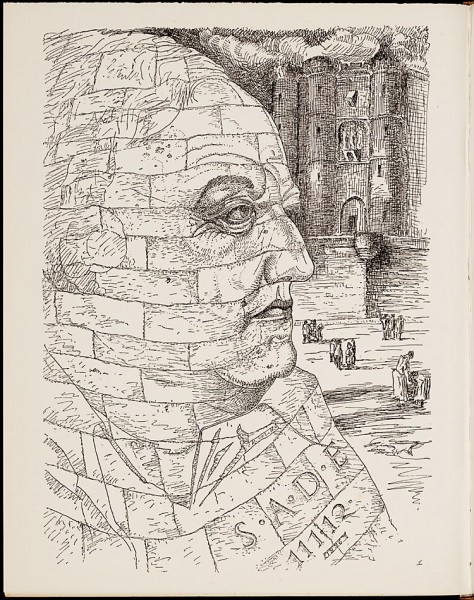Enluminure de l'Évangile d'Echternach, La tempête apaisée
Henri de Lubac consacre maintenant un chapitre à Philippe Buchez (1796-1865), qui écrivit :
« Depuis des siècles, le monde social, la religion, la philosophie, la science tournaient dans un cercle toujours le même, sans prévoir qu’on pût en sortir, assurant même que telle était l’éternelle vérité des choses. Le christianisme rompit ce cercle où les destinées humaines semblaient arrêtées à jamais, et il en fit sortir un monde nouveau. L’immensité de ses oeuvres est telle qu’il suffit de jeter un coup d’oeil sur l’histoire pour en être étonné. » (t.2, p.89)
Et :
« L’esprit critique passa sur les sociétés comme un ouragan ou un déluge ; il abattit les temples, brisa les sanctuaires, enfouit les traditions ; il mêla et roula la matière de Dieu et des hommes, et la jeta çà et là, et la laissa immobile, comme un sable inerte et sans volonté, attendant le germe de l’arbre qui devait l’abriter et la fertiliser. » (t.2, p.103)
Lubac évoque l’attachement de Buchez aux Pères de l’Église, dont la pensée est toujours à retrouver, et aussi « l’admiration de Buchez pour Grégoire VII, partagée par nombre de ses contemporains », ajoutant : « Sur la fin du dix-neuvième siècle, Mgr Duchesne consacrait une opinion commune lorsque, après un sombre tableau des liens dans lesquels se trouvait alors enfermée l’Église, il écrivait : « Il fallait sortir de là ; Grégoire VII ouvrit la porte, une porte qui ressemblait à une brèche. Le scandale fut énorme dans un monde qui vivait sur les abus. Mais le grand pape eut confiance dans la barque de saint Pierre. Sur la mer démontée où il la conduisit, elle répondit à la foi de son capitaine ». » (t.2, p.109)
Commentant la pensée de Buchez, Lubac écrit enfin :
« Ce principe de progrès, cette influence active, bref, cet élément dynamique, était dès le premier jour au coeur de la foi nouvelle. Il a pénétré les peuples qu’elle a formés. Plus profondément que bien d’autres facteurs, il est à l’origine de ce grand fait, devenu banal, que devait constater le second concile du Vatican : « Le genre humain passe d’une notion plutôt statique de l’ordre des choses à une conception plus dynamique et évolutive » ; de là, dit encore le concile en restant dans les généralités, « naît, immense, une problématique nouvelle, qui provoque de nouvelles analyses et de nouvelles synthèses ». Comme hier encore le Concile, Buchez avait la conviction que la fidélité totale au principe qui avait donné l’impulsion première était indispensable pour éviter aux hommes de s’engager dans des voies sans issue. Cependant, aujourd’hui encore, bien qu’on le devine partout à l’oeuvre, cet élément dynamique de la foi se laisse mal cerner. C’est autre chose qu’une notion nouvelle du développement dogmatique, autre chose aussi qu’une logique plus intrépide – ou plus simpliste – dans l’application de l’Évangile à la vie sociale. C’est tout le contraire d’une adaptation trop complaisante aux mentalités d’un monde qui change. C’est un jour nouveau, qui ne devrait pas être purement rétrospectif, sur la fécondité de la révélation chrétienne, un approfondissement dans la conscience que l’Église a de son rôle et des moyens renouvelés qu’elle doit mettre en oeuvre pour le remplir. » Ce qui « suppose une forte unité pour assurer non plus seulement le maintien d’une foi sans compromissions mais la droite orientation d’une Église toujours en marche. Au coeur de l’Église et de sa foi, en vertu même de ce qu’elle fut dès l’origine mais aussi des situations nouvelles du monde qu’elle a mission de sauver, ouverture d’une dimension d’abord insoupçonnée, – utopique ou prophétique, on en pourra discuter. »(t.2, pp 133-134)
*
J’injecterai l’Ordre des Pèlerins d’Amour
dans les veines du monde avec vous, soeurs et frères
passionnément présents dans mon corps qui vous aime
Libres




 L’entrée de la Demeure. Photo Microtokyo. Une utopie réalisée, voir
L’entrée de la Demeure. Photo Microtokyo. Une utopie réalisée, voir  Miniature du XVe siècle :
Miniature du XVe siècle :