
à Paris ces jours-ci, photo Alina Reyes
*
Un harcèlement constant d’un tas de profs anonymes sur Twitter ces jours derniers m’a décidée à fermer mon compte (une énième fois – car des harceleurs me suivent depuis des années et opèrent chaque fois que j’ouvre un nouveau compte avec des complicités nouvelles, qu’ils trouvent aisément parmi le cancer des anonymes d’Internet). Mieux vaut avoir un cancer que d’en être un ; quand on l’a, on s’en débarrasse, d’une façon ou d’une autre ; quand on l’est, il n’y a rien à faire pour en sortir.
Je parcours les comptes de profs sur le réseau social pour mieux comprendre leurs problèmes, ceux des élèves et de l’Éducation nationale. Et il m’arrive de temps en temps, comme les autres, de participer à une conversation ou de retweeter un tweet, bref, de faire ce qu’on fait sur Twitter. L’autre jour je suis tombée sur un prof qui fustigeait les profs stagiaires (en première année d’enseignement) qui selon lui prétendaient donner des leçons aux profs titularisés depuis longtemps. J’ai dit que moi j’avais vu l’inverse, des profs prenant le ou la stagiaire pour un élève et voulant le ou la forcer à adopter sa pédagogie. Alors le harcèlement s’est déclenché. Pendant des heures et des heures, une avalanche de profs anonymes, surgis je ne sais d’où, a submergé le fil de ses sarcasmes contre moi. Cela a fini par se calmer, et j’ai décidé de ne pas tenir compte de ce sale épisode.
Le lendemain, tombant sur la remarque d’une prof anonyme, toujours, selon laquelle il fallait appeler par leur prénom, plutôt que « madame », Madame de La Fayette ou Madame de Staël, parce que les appeler madame serait prétendument sexiste, je lui ai fait remarquer qu’il n’y avait en fait rien de sexiste dans cette affaire, qu’il s’agissait seulement d’une façon de l’époque d’indiquer la haute naissance de ces femmes, comme d’autres auteurs appelés par leur titre de noblesse, Duc de La Rochefoucault, Marquis de Sade etc. Cette simple remarque a mis cette prof en fureur, et elle s’est mise à déclencher elle aussi une avalanche de tweets sarcastiques, insultants, à grands renforts de smileys et de gifs, comme le font tous ces anonymes qui n’ont pas une conversation très élevée. Elle m’a accusée de commettre une faute de syntaxe alors que c’était elle qui était en tort, prétendant qu’il fallait dire « le nom avec lequel il signe ses œuvres », et non comme je l’avais dit « le nom dont il signe ses œuvres » – faisant une autre fois une énorme faute d’orthographe tout en m’accusant de ne pas savoir écrire. Sa virulence et ses insultes, que je ne relevais pourtant pas, essayant juste de la ramener à la raison et de démonter calmement ses fausses accusations, se sont poursuivies des heures durant aussi, bientôt renforcées par le tas des autres harceleurs anonymes, de plus en plus insultants, vulgaires, grossiers, sexuels, sexistes.
J’ai fait des captures d’écran des dizaines de pages de leur harcèlement, puis finalement, comme cela se poursuivait aujourd’hui, j’ai préféré fermer mon compte, sachant qu’une fois lancés ils recommenceraient, les anonymes se reformant toujours sous un autre anonymat quand on les bloque (quand on les empêche d’avoir accès à notre compte). Voilà donc ce qu’il en est de l’Éducation nationale : gangrenée par des profs pratiquant le harcèlement de groupe sous anonymat, et des profs de lettres se permettant de changer les noms des auteurs, tout en commettant d’énormes fautes de syntaxe et d’orthographe. À la façon dont ils traitent une adulte, il y a fort à s’inquiéter de la façon dont ils traitent les élèves, des violences psychologiques masquées qu’ils peuvent leur infliger et de l’enseignement déplorable qu’ils peuvent leur donner. Tout cela dans le sentiment d’impunité que leur confère leur statut de fonctionnaires.
Est-il besoin de le préciser, je n’estime pas que ces indignes, que ces infects, représentent tous les enseignants. Mais ils sont sans aucun doute beaucoup trop nombreux à être en charge d’enfants, d’élèves qui ont besoin de recevoir le meilleur enseignement possible ; ce qui malheureusement n’est pas le cas dans notre pays, classé loin derrière beaucoup de pays européens pour les résultats et la qualité de son enseignement. Une éthique serait grandement nécessaire.
*
23-6-2018
J’actualise cette note avec quelques remarques sur l’étrange tour pris par le harcèlement de la prof qui voulait changer les noms des auteurs à son gré et selon son idéologie, estimant qu’on n’était plus sous l’Ancien Régime et qu’on n’avait donc plus à donner les titres des auteurs, que ce soit « Madame » ou « Marquis » – comme si leur appartenance à la haute société de l’époque n’avait aucun sens, comme si opérer un tel anachronisme n’était pas vider la littérature et l’histoire de la richesse de leur sens, comme si, enfin, les profs et non les auteurs avaient le droit de décider de quel nom les œuvres devaient être signées, comme si les œuvres étaient la propriété des profs. Malheureusement je dois dire que cette prof pas finaude ne sortait pas cette idée de sa propre cervelle, apparemment c’est une idée prétendument féministe qui court puisque j’avais entendu le même discours il y a deux ans d’une professeure de la Sorbonne faisant un cours en amphi – laquelle, tout en se voulant féministe, ne citait par ailleurs parmi les romanciers contemporains dont elle estimait que leur œuvre n’était pas vraiment de la littérature… que des romancières. Sans doute médiocres, mais bien moins que certains de leurs confrères aussi ou encore plus connus. La bêtise vit de beaux jours sous les plafonds des collèges, des lycées et des universités.
Pour en revenir à la prof harceleuse de Twitter, voici ce que vers la fin elle me dit :

… avec cette énorme faute « j’aurais entendu parlé » au lieu de « j’aurais entendu parler » (comment voulez-vous que les élèves aient une orthographe correcte avec de pareils profs ?). Comme elle se moquait du fait que je n’avais que peu d’abonnés sur le réseau social, je lui avais répondu que je préférais compter des millions de lecteurs de mes livres, avec les traductions. Voici donc que « Muriel de Chypre » prétendait avoir travaillé dans l’édition, chez deux de mes éditeurs (Gallimard et Seuil), et juste après ce tweet disait qu’il lui suffisait de passer un coup de fil chez mes éditeurs pour avoir le chiffre de mes ventes, ajoutant « on va bien rire ». Tout en ayant travaillé chez mes éditeurs (et pas récemment, car il y a longtemps que le Seuil n’est plus rue Jacob), elle ignorait que j’y avais publié des livres – mais qu’y faisait-elle donc ? la maintenance de la plomberie ? Et cependant, comme si elle était un ponte du milieu, il lui suffisait d’un coup de fil pour connaître les chiffres de mes ventes ? Soit cette personne est tout à fait folle, soit c’était quelqu’un d’autre qui s’était alors mis à la faire parler, quelqu’un qui travaillait bel et bien chez Gallimard par exemple – où j’ai intenté il y a quelques années un procès pour plagiat contre un livre publié par Sollers, procès que je n’étais pas en mesure de gagner et que je perdis, à grands renforts de mensonges de l’avocat de la puissante maison ; procès après lequel je n’ai plus pu publier nulle part, si l’on excepte les petits éditeurs de littérature religieuse. Comprenne qui pourra, ce n’est pas très difficile à comprendre.
Précisons tout de même que Le Boucher a été vendu en France depuis trente ans à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires (et qu’il continue à se vendre) ; en Russie à au moins deux cent mille exemplaires ; en Italie, en Grande-Bretagne… ce fut un best-seller aussi, sans compter plus d’une vingtaine de traductions. Un autre de mes titres, Derrière la porte, a eu un succès à peu près comparable (et des éditions pirates donc non chiffrées). Sept nuits a été publié en feuilleton dans un journal allemand, le Bild, tirant à quatre millions d’exemplaires, puis par centaines de milliers de livres dans le même pays ; sans compter les autres traductions du même titre. Ces titres m’ont permis de vivre en écrivant mes autres livres aux ventes plus modestes, ainsi va le travail.
Je continuerai à actualiser cette note. À suivre, donc !
*
24-6-2018
Qui sont ces anonymes qui régulièrement, depuis des années, me harcèlent en ligne ? À cause de qui j’ai dû fermer mes pages facebook, fermer tous mes comptes twitter chaque fois que j’en ai ouvert un nouveau, fermer les commentaires sur ce blog aussi ? Qui par leurs insinuations me font savoir qu’ils peuvent, comme des flics et des hackers, me surveiller et s’immiscer dans mes relations professionnelles ? Qui, comme de sales curés hypocrites, m’accablent de sermons à la façon des gens qui veulent dominer ce qu’ils ne peuvent pas dominer ? Qui s’accrochent à mes basques comme des toutous enragés et trouvent toujours de nouveaux toutous anonymes comme eux pour participer, bien planqués, à leurs grosses et petites saletés ?
Pour ce qui est du dernier épisode de cette misérable affaire, dernier épisode ayant embarqué un tas de profs dans la partouze des impuissants anonymes, après vous avoir présenté hier « Muriel de Chypre » voici « Le Hiérophante » et « Jean-Michel Apeuprè ». Le premier est celui qui du piédestal de son statut de prof titularisé fustigeait les profs stagiaires qui soi-disant prendraient de haut les titulaires, et à qui j’avais répondu que je connaissais le cas inverse de certains titulaires traitant les stagiaires comme des élèves, et des élèves bien mal traités. Voici un exemple de réaction des profs anonymes que cette simple remarque a rameutés pour m’accabler de sarcasmes et d’insultes.

Je laisse chacune et chacun d’entre vous imaginer ce qu’il en est de confier ses enfants à des gens qui se conduisent en petites frappes virtuelles dès qu’ils sont masqués. Du vertige de toute-puissance sur autrui qui s’empare si facilement d’eux, sans doute exacerbé par leur position de pouvoir face aux enfants et d’impunité face à leur employeur, l’État.
À suivre.
*
24-6-2018
Je ne vais pas citer tous ceux qui ont pris part à ce harcèlement, après tout ce serait leur faire trop d’honneur. Une dernière copie de tweet témoignant de leur contentement obscène et de leur énorme bêtise, satisfaite d’avoir trouvé là une occasion de se montrer :

véritable aveu du harcèlement en groupe auquel ils et elles venaient de se livrer. Avec toujours la même tactique : prétendre répondre par une agression de masse à un tweet qualifié d’incendiaire alors qu’il ne s’agissait que d’une réponse modérée, dépourvue d’attaque personnelle, à leur déchaînement lâche et malsain. Une occasion pour moi de reprendre la leçon de grammaire dont il fut question dans cette affaire. Contrairement à ce qui fut prétendu doctement, le COS (complément d’objet second) n’est pas nécessairement un datif ; avec les verbes du dire et du don et leurs contraires, il est fréquemment introduit par la préposition « de » comme dans « signer de son nom », où « de » est pronominalisable en « dont », contrairement à ce que ces profs de lettres prétendaient, comme dans le bel exemple donné par le dictionnaire : « Stradivarius est le nom latin dont il signait ses instruments ». Ou bien encore dans la phrase : « J’accuse l’instigateur et ses complices de délits et de crimes » : « Les délits et les crimes dont j’accuse l’instigateur et ses complices »… à compléter par quelque chose comme « finiront par être sus et payés. »
Fin (du moins, pour l’instant). Les mafias ont leurs repentis, un jour ou l’autre.
Moi j’ai choisi de vivre dans l’amour et la paix.
*




































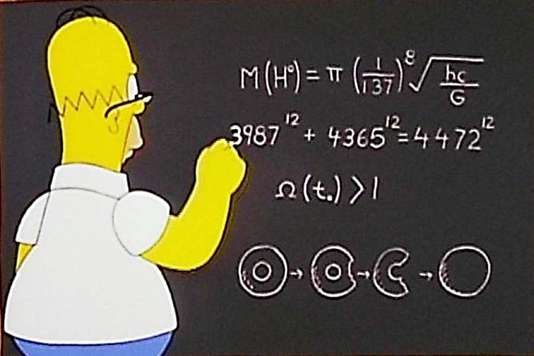








 à l’hôpital
à l’hôpital à la gare
à la gare au jardin
au jardin à la mosquée
à la mosquée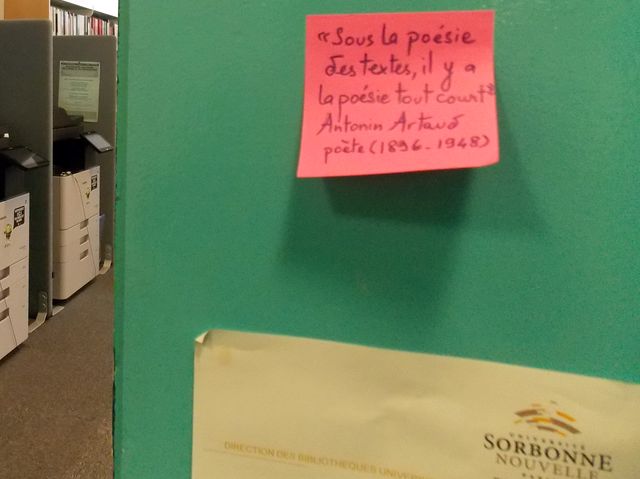 à la bibliothèque universitaire
à la bibliothèque universitaire aujourd’hui à Paris : Pitié-Salpêtrière, Jardin des Plantes, Grande mosquée, Sorbonne nouvelle : PostIt et photos Alina Reyes
aujourd’hui à Paris : Pitié-Salpêtrière, Jardin des Plantes, Grande mosquée, Sorbonne nouvelle : PostIt et photos Alina Reyes