Me voici partie pour un long et merveilleux travail, dont voici la première ébauche de projet.
*
POÉTIQUE DU TRAIT :
LE GESTE ORIGINEL CHEZ PARMÉNIDE, SHAKESPEARE, POE,
SCHWOB, KAFKA, BORGES
« … nous sommes parti d’une conception qui postule le sémantisme des images, le fait qu’elles ne sont pas des signes, mais contiennent matériellement en quelque sorte leur sens. » Gilbert Durand, Structures anthropologiques de l’imaginaire
Tracer, imprimer sa trace. L’homme est un être, le seul être, qui trace des lignes. Ce geste immémorial et toujours actuel, dans sa pulsion comme dans sa sophistication, ce geste d’inscrire, plus ancien peut-être que le langage articulé, plus ancien que l’écriture et qui trouve son accomplissement dans l’écriture, signe la conscience d’être au monde, d’habiter poétiquement le monde.
Comment s’est perpétuée la mémoire de ce geste originel chez les poètes de langues et d’époques différentes que nous étudierons ? En ce qu’il constitue la poésie comme maison, habitation, situation dans le monde, et en même temps comme viridité, accroissement, dépassement.
Le geste originel
Notre interrogation porte sur la spécificité du geste précurseur de l’écriture, puis du geste d’écrire, dans le processus poétique. Notre intuition est que la littérature première, littérature orale, avant de devenir littérature écrite, a pris langue dans le traçage de lignes et de points, de figures abstraites ou concrètes, pratiqué par les hommes du Paléolithique sur les objets et dans les grottes qui en gardent la trace. Nous développerons notre réflexion en ce sens par des lectures et des rencontres avec des paléontologues, nous entretenant notamment avec Henry de Lumley, qui a une longue fréquentation d’Homo Erectus, prédécesseur d’Homo Sapiens qui pratiquait déjà l’inscription géométrique ; Anne Dambricourt, qui a étudié de façon très spécifique le développement crânien des hominidés (y percevant une part de déterminisme qui dans notre esprit peut être mise en relation avec la thèse de Chomsky d’une grammaire universelle et générative) ; Jean Clottes, selon qui la production de lignes, de points, de gravures et de peintures dans les grottes ornées était liée à des cérémonies de type chamanique, avec chants et danses – ce qui peut être mis en rapport avec le système poétique des Aborigènes d’Australie, où chant et tracé pointilliste s’équivalent pour situer l’homme et son territoire dans le monde.
Si tracer une ligne dans le sable ou dans la pierre n’est ni pour le petit enfant d’aujourd’hui ni pour l’ancêtre de l’homme moderne un moyen de communication avec ses semblables, qu’est-ce ? Nous voyons dans ce geste la marque d’une contemplation de l’invisible à travers le visible. D’une première conceptualisation : l’homme « voit », voit alors qu’il est homme, et le marque. L’homme « voit » (et entend). Le tout-petit humain est aussi le seul primate à faire le geste de montrer du doigt. Mais à travers ce que ses sens perçoivent des messages immédiats de l’environnement (là il y a à manger, là il y a danger etc), l’homme pressent autre chose. Sa « vision » lui donne l’ « idée » (idein : voir, connaître). Le signe tracé peut servir de repère spatial : marquer une direction, un objet pour le destiner – par exemple un arbre à abattre. Mais fondamentalement le geste d’inscrire, de donner une forme concrète à une forme mentale, est la manifestation d’une prise de conscience de l’être. La naissance de la pensée, la conceptualisation, fait concevoir le trait, la forme.
Habiter poétiquement le monde
Tracer, inscrire (dans une proto- ou méta-écriture pratiquée par le tagueur des murs de nos villes modernes comme par les tout premiers humains gravant des traits abstraits sur les parois des grottes), c’est s’inscrire dans le monde. La poésie, une fois la langue et l’écriture advenue, gardera cette fonction. Nous nous attacherons à montrer chez les auteurs de notre corpus comment la poésie bâtit la maison de l’être, son armature. Comment elle fait du monde une habitation possible pour l’homme, une habitation qui est en même temps acte et croissance. Comment l’homme y grandit avec elle, et comment son habitation est parcours, avancée. Comment, née d’un geste physique, la poésie demeure physique, en ce qu’elle révèle et fait se produire le vrai réel de l’homme.
Quelles structures mentales présidant aux proto-écritures préhistoriques se trouvent transposées dans la poésie écrite de l’homme moderne, et comment ? Comment la poétique des œuvres de notre corpus répond-elle à la même nécessité ontologique que la poétique de l’art pariétal ? Pourquoi l’humain est-il l’être qui « habite en poésie », selon le mot du poète ?
Corpus
Les fragments retrouvés du poème de Parménide signalent à la fois le trajet de l’être (figuré par une course) et son habitation, celle de la déesse dont il franchit les portes. Parménide expose sa doctrine en vers. Révélant par la forme de son expression ce qu’il n’énonce pas : la pensée est poésie. Rappelons un fait capital : sa parole est scandée, de la même façon que celle d’Homère. Au rythme de l’hexamètre dactylique, vers dont la mesure est fondée sur le dactyle (doigt), à savoir un son composé d’une (phalange) longue suivie de (deux phalanges) courtes ou brèves. Partant de ce constat, nous comprenons que son poème s’intitule Péri phuséos : Sur la nature, ou plus précisément Autour de la nature. Il est très productif de songer aux Présocratiques comme « physiologues », « parleurs de la nature ». Que dit Parménide ? Notre traduction du poème, par sa forme sonore et par son fond, le sens qu’elle indique, parle d’elle-même. La pensée comme le corps est mue par un ensemble d’articulations, de même que la parole s’articule dans le vers selon la mesure du dactyle, des articulations du doigt. Si conceptuelle puisse-t-elle paraître, la pensée de Parménide, comme celle de tous les Présocratiques, est fondée sur la nature, l’ordre du cosmos, qui en grec ancien est beauté, comme la parole poétique. Parménide prend la voie de ce qui est, il la prend physiquement en utilisant la forme poétique et en commençant son poème par la description d’une course vers et dans la lumière, avec des juments, un char, des jeunes filles, des cris de flûte dans les roues, une déesse qui parle, une porte à franchir.
Comment les apparences doivent être en leur apparition, traversant tout via tout : cette formule de Parménide pourrait servir de programme, distribué à l’entrée, de toute œuvre de Shakespeare. Songeons à l’apparition de Bottom, coiffé d’une tête d’âne comme le théâtre coiffe le théâtre, et le prologue la pièce dans la pièce, dans Songe d’une nuit d’été (III, 1). Situation, habitation et action : Shakespeare déploie en abîme ces propriétés poétiques du théâtre. Dans Songe d’une nuit d’été, l’homme cherche à se dégager d’un espace nocturne et sauvage, la forêt, figurant la confusion des esprits et leur quête erratique de la vérité. Dans La Tempête, l’habitation est une île où les personnages se sont retrouvés du fait de l’exil ou d’un naufrage, et où combattent le pouvoir de l’esprit et le pouvoir temporel, politique. Le roi mage déchu plonge tout le monde dans l’illusion afin de rétablir la justice. Puis, dans un espace rétréci, un cercle magique, il renonce aux esprits. Les naufragés sont alors libérés, l’espace de l’île réduit à un cercle aliénant s’ouvre, le bateau peut reprendre la mer. Nous sommes ici dans un processus de renaissance, de reverdissement, comme dans le sonnet 15 :
…
À mesure qu’il vous ruine, je vous regreffe.
Dans Macbeth, l’homme « habite » par le meurtre et le processus est inverse : l’espace habitable se réduit à une tache de sang sur la main, et finalement au néant. Esti gar einai, mèden d’ouk estin, disait Parménide. Et dans l’espace d’Elseneur, où son action est menacée par la paralysie, Hamlet s’interroge : to be or not to be ?
Car l’habitation poétique du monde par l’homme a son négatif, son anti-habitation. Kafka parlait de la fosse de Babel, Poe évoque le maëlstrom où l’être s’engouffre. …et l’étang froid et profond à mes pieds se ferma, maussade et silencieux, sur les fragments de la « MAISON USHER ». Ne peut-on lire sa Chute de la maison Usher comme la chute d’une maison de mots, d’une maison où l’esprit s’est par trop séparé du réel, de ce qui est, et de ce fait, s’écroule, entraînant dans la mort ses habitants, irrémédiablement ? Nevermore, le refrain sinistre du Corbeau rappelle l’homme à sa vanité, lorsqu’il habite une maison par l’horreur hantée. Mais l’habitation négative, ou impossible, ou labyrinthique, sert aussi à exprimer et raviver le désir humain d’habitation et de croissance positives, réelles, orientées.
Le Livre de Monelle est peut-être la plus étrange des œuvres de Marcel Schwob. Avant de se perdre dans les mille visages de ses sœurs (la Perverse, la Fidèle, la Sacrifiée…), Monelle parle et ordonne. D’apparitions en disparitions, seule et démultipliée, elle est l’insaisissable, dans un univers peuplé de masques où le réel est perpétuellement en fuite. Avec ses Contes et récits dont les titres disent l’ambiguïté (Cœur double, Le Roi au masque d’or, Mimes), ses Vies imaginaires, ses études sur l’argot, ses traductions, l’univers de Schwob forme des habitats-labyrinthes qui fascinèrent Borges et préfigurent une forme moderne de fractalisation de l’être.
Et comme autrefois, dans son sommeil, Monelle se pelotonna contre l’invisible et me dit : « Je dors, mon aimé. »
Ainsi je la trouvai ; mais comment serai-je sûr de la retrouver dans ce lieu très étroit et obscur ?
Labyrinthique aussi, d’une autre façon, le monde de Kafka, son habitation, sa façon d’arpenter l’espace sans jamais y trouver sa place. Un monde marqué par la honte d’être, la honte paradoxale de ne pouvoir vivre en ce monde honteux. À travers sa construction de lettres il la fuit mais la honte demeure, il le dit à la fin du Procès et en terminant sa Lettre au père, c’est comme si la honte devait lui survivre. Le Verdict du père c’est la mort, où le fils se précipite dans l’allégresse du soulagement tant a clairement éclaté l’impossibilité de vivre dans le mensonge général, l’essence implacablement mensongère du monde. À bien des reprises les personnages de Kafka se font si humbles ou si petits, cafard, souris, singe, chien, pelote, taupe ou encore artiste de la faim finissant par fondre, que l’on pourrait se demander s’il ne s’agit pas là d’une tentative pour passer par quelque porte étroite, à défaut de pouvoir affronter le gardien de la Loi. L’être, l’être-homme chez Kafka, se réduit à ces bêtes ou objets si humbles et méprisables, dont l’habitation est tel ou tel réduit, sous le lit, dans des terriers, en cage… Et quand, parce que la poésie le veut, le reverdissement a lieu, ce n’est pas un homme qui renaît de la poussière du disparu, mais un animal plein de vie, comme à la fin d’Un artiste de la faim :
… ce corps noble, doté de tout le nécessaire jusqu’à presque s’en déchirer, semblait trimballer aussi avec lui la liberté…
Borges conçoit des histoires que la raison peut concevoir afin d’en faire sortir quelque chose qui reste pour la raison inconcevable, et s’avère pourtant concevable par l’esprit, puisque le voilà conçu. L’écrit dit et révèle ce qui dépasse la raison, comme dans Le Livre de sable, dont les pages échappent à l’ordre rationnel et ne peuvent être vues deux fois :
L’inconnu me dit alors :
– Regardez-la bien. Vous ne la verrez jamais plus.
Le jamais plus prononcé par l’inconnu de Borges rappelle celui du corbeau d’Edgar Poe. Nous sommes ici au bord du gouffre. L’habitation de l’homme est plantée sur ou devant l’abîme, à moins qu’elle ne regarde, de la rive, le fleuve qui n’est jamais le même, et qu’elle ne soit toujours de nouveau entraînée, dans une sorte de flux héraclitéen, hors d’elle-même, dans une stupéfaction qui est aussi extase.
– Si l’espace est infini, nous sommes dans n’importe quel point du temps.
Ayant acquis contre une Bible ce fascinant livre de sable qu’il finit par qualifier de monstrueux, et qui lui rend une image monstrueuse de lui-même, le narrateur ressent la nécessité de s’en débarrasser, et pour cela l’abandonne sur l’un des rayons humides de la Bibliothèque Nationale. Le livre de sable aura-t-il absorbé toute l’humidité de la bibliothèque ? Toute sa langue ? Menace-t-il d’avaler toute la maison ? Il faut pourtant continuer à chercher, par-delà l’être réel et l’être du poème, L’Autre tigre.
…
Nous chercherons un troisième tigre. Celui-ci
Sera comme les autres une forme
De mon rêve, un système de mots
Humains et non le tigre vertébré
Qui, au-delà des mythologies,
Foule la terre. Je le sais bien, mais quelque chose
M’impose cette aventure indéfinie
Insensée et ancienne, et je persévère
À chercher tout le temps du soir
L’autre tigre, celui qui n’est pas dans le poème.
Méthode : le trait d’union
Notre méthode de travail est fondée sur le dialogue. Si le dialogue avec les hommes préhistoriques ne peut avoir lieu directement de langue à langue, si leurs tracés abstraits nous demeurent indéchiffrables, une approche poétique, plus intuitive que rationnelle, peut cependant nous permettre de les faire « parler » ou du moins évoquer, comme ils font parler certains poètes inspirés par leurs œuvres. Et nous pouvons aussi parler directement avec les spécialistes qui ont étudié ces hommes de l’enfance de l’humanité, ces infantes, ces « sans-parole », ces paléontologues qui les ont fréquentés si longtemps qu’ils sont pour ainsi dire devenus leurs intimes – « les gars », les appelle Jean Clottes lorsqu’il décrit leur comportement.
Quant aux auteurs de notre corpus, nous dialoguons avec eux en tout premier lieu par l’action de les traduire. Entendons notamment dans le terme traduire : traduire en justice. Dans un processus inverse de celui du Procès de notre corpus : il ne s’agit pas de condamner l’homme absurdement et sans retour, mais au contraire de rendre justice au texte et par le texte, en retour, en réponse. Le fait de traduire ouvre entre le texte original et sa traduction le champ de la critique ou de l’exégèse. Si toute traduction est réécriture, transposition d’un texte à un autre texte, le commentaire qui l’accompagne, l’explique, l’ouvre, la libère, peut prévenir la trahison dont elle toujours soupçonnée. La traduction, qui est dialogue, au fil du dialogue devient trait d’union.
Si rien ne peut faire mourir la poésie, l’homme peut mourir d’oublier la poésie, de ne plus savoir la reconnaître, alors qu’elle le constitue, qu’elle est tout à la fois sa maison, son armature, et sa sève, sa croissance. Nous désirons par cette thèse la faire apparaître où elle se voit par trop confusément. La poésie appartient à l’univers physique, elle peut illuminer l’être à la vitesse de la lumière, elle lie espace et temps comme dans la relativité générale et comme en physique quantique demeure à la fois là et ailleurs, insaisissable mais présente, et agissante, possiblement avec une immense puissance. La poésie est trace, laissée par l’homme pour sortir de ses limites physiques, spatiales et temporelles. Né de l’interrogation extasiante – l’homme se projetant hors de lui par son geste -, le trait que l’homme trace depuis son origine est trait d’union entre lui et le monde, et à travers les générations, par pointillés et dans la continuité, déroulement d’un fil et forme de lien et d’union entre les vivants passés et les vivants présents.
*
*
août 2020 : ma thèse, soutenue en 2018 avec un projet qui a évolué depuis cette ébauche, peut être lue en grande partie dans le premier tiers de mon livre Une chasse spirituelle, en libre accès ici.
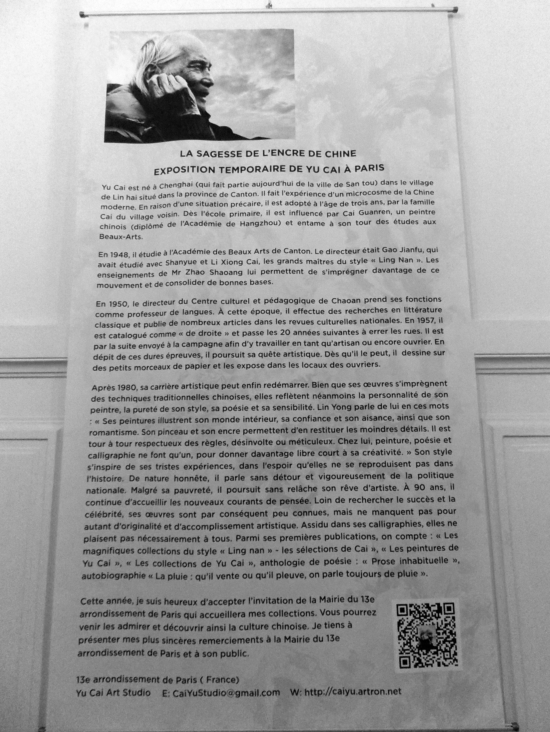










 aujourd’hui, photos Alina Reyes
aujourd’hui, photos Alina Reyes


































 aujourd’hui au jardin de l’Allée haute à la Pitié Salpêtrière, photos Alina Reyes
aujourd’hui au jardin de l’Allée haute à la Pitié Salpêtrière, photos Alina Reyes



 « les fleurs parlent », disait la petite fille en jaune dans les fleurs
« les fleurs parlent », disait la petite fille en jaune dans les fleurs


 aujourd’hui, photos Alina Reyes
aujourd’hui, photos Alina Reyes

 prises avant l’aube de ma fenêtre et ne rendant pas la beauté du phénomène, l’éclipse faisant la lune très brillante et exhaussant ses paysages
prises avant l’aube de ma fenêtre et ne rendant pas la beauté du phénomène, l’éclipse faisant la lune très brillante et exhaussant ses paysages