 J’ai lu cette nuit cette âpre et belle nouvelle, qui pose la question à la fois des droits des femmes et des droits des enfants. Fantah Touré est une auteure franco-ivoirienne, professeure de littérature agrégée au Sénégal. L’Afrique qu’elle met en scène est celle qu’elle vit au quotidien, sans exotisme. L’histoire est ici celle d’un garçon guinéen de six ans, séparé de sa mère par son père polygame, qui décide de répudier sa femme et de se débarrasser de ses enfants mâles en donnant l’aîné à un vieux cousin, et le petit à une école coranique sénégalaise. La séparation d’avec sa mère et les conditions de vie terrible le conduiront à la mort. Histoire touchante et terrible du chagrin immense de l’enfant et de la mère, de l’injustice sans nom, inspirée d’une histoire vraie, qui a longtemps hanté l’auteure après qu’elle lui a été racontée.
J’ai lu cette nuit cette âpre et belle nouvelle, qui pose la question à la fois des droits des femmes et des droits des enfants. Fantah Touré est une auteure franco-ivoirienne, professeure de littérature agrégée au Sénégal. L’Afrique qu’elle met en scène est celle qu’elle vit au quotidien, sans exotisme. L’histoire est ici celle d’un garçon guinéen de six ans, séparé de sa mère par son père polygame, qui décide de répudier sa femme et de se débarrasser de ses enfants mâles en donnant l’aîné à un vieux cousin, et le petit à une école coranique sénégalaise. La séparation d’avec sa mère et les conditions de vie terrible le conduiront à la mort. Histoire touchante et terrible du chagrin immense de l’enfant et de la mère, de l’injustice sans nom, inspirée d’une histoire vraie, qui a longtemps hanté l’auteure après qu’elle lui a été racontée.
En voici les premières pages :
« Une région sévère : la terre est plate, grise, semée de baobabs tous frères, aux formes déchiquetées. Quelques épineux trouent le sable, des arbres ou des buissons pas très hauts qui portent des fruits tout en noyau, à la maigre chair acide. Le long de la route, des panneaux fantômes, tout rouillés, signalent parfois des villages dont on ne voit trace nulle part. De temps en temps, on rencontre une charrette sur laquelle sont installés des hommes et des femmes dont le boubou enfle au vent. On traverse parfois des villages où se mêlent des cases ocres et des constructions au toit de tôle étincelant au soleil. Au milieu de la journée, on y étouffe de chaleur.
Les hommes sont maigres, grands, la chair rigoureusement répartie autour des os, dont le bas du pantalon bouffant ou du boubou dévoile la sécheresse charbonneuse. C’est le pays de l’arachide, même s’il y a de moins en moins d’arachide. Les petits garçons travaillent dans les champs de leurs parents ou sont confiés très tôt à un marabout, maître spirituel et temporel qui leur enseigne le Coran et les envoie mendier leur pitance. Même dans les campagnes, le pot de concentré de tomate vide tend à remplacer la calebasse ; tous les enfants se ressemblent : la peau craquelée et grise, frissonnant dans l’air du petit matin, le geste implorant et l’œil espiègle.
Rentré de Guinée avec ses parents, Cheikh fut confié à cette rude école ; il ne connaissait de la vie que les douceurs : friandises du restaurant maternel, menues obligations récompensées : un beignet, une piécette, un sourire et toujours la présence grondeuse et affectueuse de la mère et celle d’un frère un peu plus grand que lui mais déjà protecteur. Le père passait de loin en loin dans cette vie confortable, gonflé de vêtements et d’importance, trop occupé pour octroyer à sa progéniture plus qu’un regard ou une tape sur la joue.
Cheikh était un très bel enfant – les gens le disaient à voix basse, pour conjurer le mauvais sort -, élancé comme un jeune rônier, les muscles jouant avec aisance sous sa peau, les pommettes hautes sur les rondes joues de l’enfance, l’œil toujours aux aguets, frayant avec tous, parlant couramment le wolof, le soussou, le bambara, et sachant même quelques mots de français déformé glanés dans les conversations du marché.
Son seul souci, c’était la tristesse qu’il surprenait parfois dans les yeux de sa mère. Il savait que son père avait d’autres foyers, d’autres enfants, il voyait aussi qu’il disparaissait de longs jours et que seule la gargote de sa mère, fragile enclos de bols et de calebasses autour du fourneau malgache, grande natte sur laquelle on installait plusieurs fois par jour les assiettes individuelles ou le plat commun, assurait le riz quotidien. Il n’allait pas à l’école, il vagabondait tout le jour dans une ville ouverte sur la mer. Mais une amarre ombilicale invisible le ramenait toujours au marché, à sa mère accroupie près du feu, un autre enfant sur le dos. Toute la portion de la ville autour du marché était son territoire. Il ne connaissait pas la faim : à n’importe quelle heure, sa mère lui tendait une poignée d’arachides, des morceaux de bananes frites ou le fond bien croustillant de la marmite de riz étalé sur une assiette, grains craquants et parfumés sous la dent.
À six ans, il voyait bien les limites de son enfance en regardant son grand frère partir tous les matins pour l’école coranique ; il voyait les enfants accroupis sur les trottoirs ânonnant autour des planches marquées de caractères arabes, qui l’interpellaient lorsque le maître tournait le dos.
Et un jour, il entendit les mots divorce, retour, Sénégal. Son père réapparut, la mine sombre. »
Fantah Touré, Enfance, Les Éditions de l’Atelier In8, 2006
*
 Un entretien avec Fantah Touré : ici
Un entretien avec Fantah Touré : ici



















 photos Alina Reyes
photos Alina Reyes


 Ce sont deux amies. L’une a mis des chaussures noires, l’autre des blanches. L’une une jupe bleu foncé et un blouson bleu clair, l’autre un pantalon rouge et une veste rose. Et quand elles sont arrivées à cet embranchement de l’escalier, pour continuer leur jeu de symétrie, elles ont pris chacune un côté. J’ai dû faire vite pour saisir l’image, elle n’est pas très droite. En fait, tant mieux.
Ce sont deux amies. L’une a mis des chaussures noires, l’autre des blanches. L’une une jupe bleu foncé et un blouson bleu clair, l’autre un pantalon rouge et une veste rose. Et quand elles sont arrivées à cet embranchement de l’escalier, pour continuer leur jeu de symétrie, elles ont pris chacune un côté. J’ai dû faire vite pour saisir l’image, elle n’est pas très droite. En fait, tant mieux.





 Hier et aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes
Hier et aujourd’hui à Paris 5e, photos Alina Reyes

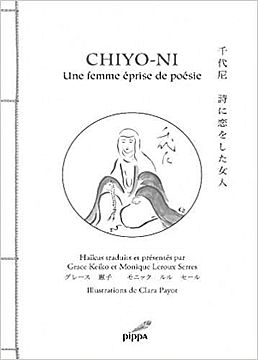

 J’ai lu cette nuit cette âpre et belle nouvelle, qui pose la question à la fois des droits des femmes et des droits des enfants. Fantah Touré est une auteure franco-ivoirienne, professeure de littérature agrégée au Sénégal. L’Afrique qu’elle met en scène est celle qu’elle vit au quotidien, sans exotisme. L’histoire est ici celle d’un garçon guinéen de six ans, séparé de sa mère par son père polygame, qui décide de répudier sa femme et de se débarrasser de ses enfants mâles en donnant l’aîné à un vieux cousin, et le petit à une école coranique sénégalaise. La séparation d’avec sa mère et les conditions de vie terrible le conduiront à la mort. Histoire touchante et terrible du chagrin immense de l’enfant et de la mère, de l’injustice sans nom, inspirée d’une histoire vraie, qui a longtemps hanté l’auteure après qu’elle lui a été racontée.
J’ai lu cette nuit cette âpre et belle nouvelle, qui pose la question à la fois des droits des femmes et des droits des enfants. Fantah Touré est une auteure franco-ivoirienne, professeure de littérature agrégée au Sénégal. L’Afrique qu’elle met en scène est celle qu’elle vit au quotidien, sans exotisme. L’histoire est ici celle d’un garçon guinéen de six ans, séparé de sa mère par son père polygame, qui décide de répudier sa femme et de se débarrasser de ses enfants mâles en donnant l’aîné à un vieux cousin, et le petit à une école coranique sénégalaise. La séparation d’avec sa mère et les conditions de vie terrible le conduiront à la mort. Histoire touchante et terrible du chagrin immense de l’enfant et de la mère, de l’injustice sans nom, inspirée d’une histoire vraie, qui a longtemps hanté l’auteure après qu’elle lui a été racontée.