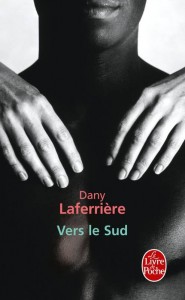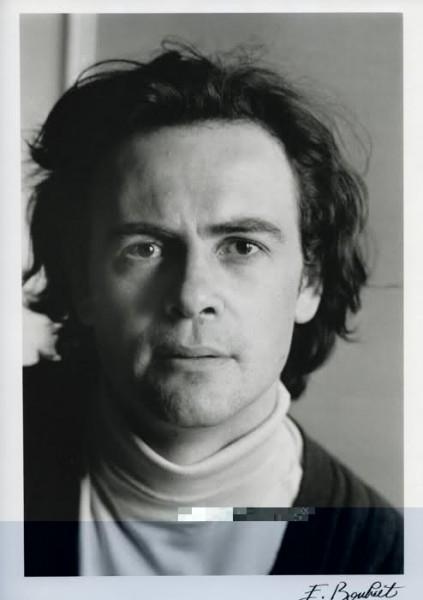*
*
Parallèlement à Vers le sud, de Dany Laferrière, j’ai lu aussi Le faste des morts, de Kenzaburô Ôé. Le livre le plus sombre que je connaisse de cet auteur. Je me souviens de m’être guérie d’une très forte fièvre, un jour à Bordeaux, en lisant son gros roman M/T et l’histoire des merveilles de la forêt. Une autre fois j’ai relu son livre Une affaire personnelle, ce texte si violemment désespéré, qui m’a rappelée à lui pour m’éclairer dans l’abîme où je tentais de voir.
Cette fois, il s’agit de trois nouvelles de jeunesse, dont la première éponyme du recueil, fut écrite avec une extraordinaire maturité en 1957, alors que l’auteur avait vingt-deux ans. Ici aussi le sexuel est très étroitement lié au politique, et de façon terrible, implacable. Dans Vers le sud la mort mène le bal des ardents en des noces de feu et de nuit où les êtres se réduisent à l’irréelle folie de zombies. Dans ce livre de Kenzaburô Ôé, elle est une puanteur et une vision omniprésentes, un appel écoeurant, le signe d’une damnation qui d’un texte à l’autre fait monter paroxystiquement le désir, paille plongée dans un cocktail amer de solitude, de culpabilité et de désespoir.
Ici toutes ses victimes sont très jeunes, privées d’avenir par le poids monumental d’une faute qu’elles doivent porter alors qu’elle n’est pas la leur mais celle de l’Histoire, de leurs aînés et de la société. Un très mince espoir de vie clôt la première nouvelle, où la jeune fille prête à avorter se demande si elle ne va pas laisser naître son enfant, afin qu’il vive quelques jours. Au terme de la deuxième nouvelle, le jeune garçon cherche dans une mort physique la solution à son insoutenable enlisement moral. Dans la dernière, où le mal-être sexuel atteint son comble, c’est à une mort spirituelle que se condamne l’adolescent, en s’engageant, dans un élan de noir mysticisme, dans un parti d’extrême-droite.
Dans Vers le sud les vieilles Blanches baisent les jeunes Noirs, les vieux Blancs baisent les jeunes Noires. Souvent personne ne dit rien, ou monologue. Ou bien les Noirs parlent avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs. Si tous ont l’air de prendre des risques, celui qui en meurt est tout de même un jeune Noir, pas un vieux Blanc. Revanche d’une sinistre vieillesse sur une vivante jeunesse. Ceux qui vont mourir, ces ogres lubriques, vous tueront d’abord, vous qui devez vivre. Plus que jamais le sexe sectionne. C’est aussi ce que je lis, dans un tout autre contexte, dans Le faste des morts, où les gens évoluent les uns à côté des autres sans pouvoir réellement s’atteindre, dans l’impossibilité de l’amour, objets les uns pour les autres, ainsi que les fabrique de plus en plus l’obscène modernité.