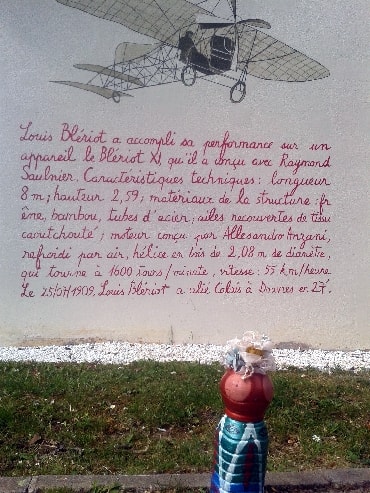*
Dérèglement de la méthode, disais-je. C’est ce que j’ai toujours pratiqué, d’une façon ou d’une autre, pour écrire. On peut produire de l’art épate-bourgeois, comme dit Barthes, en flattant l’air du temps et en s’y conformant par fabrication, artifice. Ce qui en résulte peut, comme toute illusion, rencontrer de vifs succès sur le moment, le temps que les yeux des gens distinguent ce qu’il en est vraiment ou que leur esprit, sans avoir besoin d’y porter jugement, tout simplement le rejette dans l’oubli, au néant. Une véritable œuvre n’est pas une fabrication mais vient d’un travail en soi-même, sorti hors de soi-même. L’érotisme dans mes livres est l’expression la plus visible de ce travail qui fait à son tour sortir de lui le lecteur (ce qui en effarouche certains). Mais c’est l’ensemble de mon travail qui tend à être une parole performative, comme l’indique par exemple cette parole d’un critique à propos de mon roman Forêt profonde : « ce livre terrasse le lecteur ». Je ne me vante pas de cela, j’en rends grâce aux milliers de textes que j’ai lus, et qui, de concours avec ma nature ardente, m’ont transformée en être littéraire. D’où ma pratique du Journal, depuis l’âge de douze ans, qui se poursuit en partie en ligne depuis des années (et n’aurais-je aucun lecteur en ligne, j’y tiendrais quand même ce Journal car c’est à mon travail d’abord qu’il sert – j’y pense, je le contemple, et j’avance : il fait plus que baliser mon chemin, il le débroussaille à mesure).
En dévoreuse de livres, j’ai lu un certain nombre de romans d’Aragon dans ma jeunesse. Deux de ses textes m’ont particulièrement marquée : Le Paysan de Paris et Blanche ou l’oubli. Je n’ai pas l’impression qu’on publierait aujourd’hui des œuvres témoignant d’une véritable recherche, comme aussi Nadja de Breton ou Marelle de Cortazar, pour citer parmi bien d’autres des textes qui ont marqué ma jeunesse de lectrice – ou alors sans doute on s’emploierait d’abord à en falsifier le sens, à le récupérer. À la même époque j’ai lu aussi Elsa Triolet, je me souviens de ce roman sur une enfant pauvre qui voulait rester propre dans un monde sale.
J’ai découvert ce court-métrage d’Agnès Varda, un témoignage d’amour au long cours très touchant, avec des épisodes de lumière somptueux – notamment au moment d’intimité des vieux amants au jardin et à la fin avec la barque sur l’eau – en écoutant le cours d’Antoine Compagnon sur l’année 1966. Pour compléter ce que je disais dans la note précédente de la pensée de Foucault et de celle de Lévi-Strauss, je veux dire que je me sens profondément et naturellement proche de leurs deux démarches, et venant ces dernières années de réfléchir sur l' »Immaculée Conception » (moins le dogme que son interprétation par la petite Bernadette Soubirous) et sur l’islam, que je poursuis ardemment mon investigation dans un désir de science et d’exploration des systèmes conceptuels, tant pour en dénoncer le caractère aliénant quand ils sont fabrications humaines, politico-sociales, que pour lever le voile sur un système conceptuel absolu, dont la connaissance libère. La recherche en bibliothèque, capitale, n’est pas la seule façon scientifique d’aborder les œuvres. Si je ne peux tout faire à la fois, je peux me servir des recherches faites par mes consœurs et confrères universitaires pour commencer à défricher l’autre chemin (ce dont j’ai donné un petit aperçu avec Rimbaud, en rebondissant à partir des recherches d’Eddie Breuil) et en puisant aussi aux sources d’autres disciplines scientifiques. La tâche est quasiment surhumaine et je suis loin d’avoir les capacités de m’approprier l’énorme somme de connaissances qu’il y faudrait pour l’accomplir par les méthodes connues, mais par une méthode inconnue, peut-être, oui.
*