 …Vivre libre ne peut que provoquer la jalousie du destin, pensai-je vers l’âge où Dante pénétra aux Enfers. La jalousie du destin, j’avais lu cette formule sous la plume de Julien Green, et elle m’avait autant frappée, par son caractère énigmatique, que le nom de cette petite ville des Etats-Unis où j’étais passée un jour, Truth or consequences. Trois mots chaque fois, dans les interstices desquels se glisser pour allumer la lumière, même s’il ne s’agissait que d’une minuterie – puisque nous passons le plus clair, si l’on peut dire, de notre vie, à voir confusément, comme dans un très vieux miroir plein d’ombres.
…Vivre libre ne peut que provoquer la jalousie du destin, pensai-je vers l’âge où Dante pénétra aux Enfers. La jalousie du destin, j’avais lu cette formule sous la plume de Julien Green, et elle m’avait autant frappée, par son caractère énigmatique, que le nom de cette petite ville des Etats-Unis où j’étais passée un jour, Truth or consequences. Trois mots chaque fois, dans les interstices desquels se glisser pour allumer la lumière, même s’il ne s’agissait que d’une minuterie – puisque nous passons le plus clair, si l’on peut dire, de notre vie, à voir confusément, comme dans un très vieux miroir plein d’ombres.
Comment, malgré toutes les contradictions portées par ces termes, atteindre à la fois son destin, sa vérité et sa liberté ? Oui, il fallait se faufiler entre les impossibilités, marcher sur le fil et y funambuler, vertigineusement, joyeusement, et, tant pis, dramatiquement aussi.
Dans un moment, j’allais me lever. En cette nuit, aller chercher la neige pour m’y enrouler comme dans un cocon serait une vraie douceur. La boucle, simplement, allait se boucler. Née pauvre et sans culture, je mourrais seule et en conscience.
L’être en marge tient à sa marge comme à sa liberté la plus aiguë, mais il endure aussi la souffrance de l’exclusion, et de ce double mouvement de l’esprit tient une conscience du destin parfois dévorante. Échapper au déterminisme, à l’asservissement de ma condition, sans pour autant trahir le dénuement de mes origines, tel avait été le sens de mon incessant combat, qui m’avait pourtant vue maintes fois chuter dans les servitudes volontaires qu’entraînent la passion amoureuse, le désir de reconnaissance, la tentation du confort ou l’échappée dans le rêve. Rêve, un mot comme bien d’autres alors en perte accélérée de sens, bientôt réduit aux manipulations de ce qu’un penseur politique appela spectacle, roi déguenillé mais tout-puissant que des milliards de sujets aliénés reconnurent un peu plus tard sous le nom de réalité virtuelle.
J’allais me lever, et cette nuit il ne s’agissait plus pour moi de me libérer d’une souffrance, ni d’échanger un échec de ma liberté contre une affirmation de mon libre arbitre. J’étais une très vieille femme désireuse de quitter paisiblement ce monde où elle avait réussi à réchapper de tout, même de la perte de ses proches et de l’enfermement au bordel, même de l’idolâtrie qu’elle avait suscitée pendant les Ruines, même enfin de la tentation de rester éternellement sur terre. Oui, je pouvais, l’âme en paix, quitter ce monde où plus aucun ancêtre ni plus aucun enfant n’avait besoin de ma présence. Et ce qui rendait cette quête de la neige plus douce encore, c’est que malgré d’évidents signes de craquements, Paris était toujours prise dans les glaces.
…
et je savais cette chose étrange et paradoxale : que l’éternité reviendrait dès que le temps aurait terminé d’être arrêté.
Malgré la neige mes semelles dans la descente glissaient sur la glace, et il faisait si sombre que je levai la main gauche pour me tenir au mur de l’Institut des sourds et muets. De temps en temps une voiture remontait de la Seine et me jetait ses phares aux yeux, que je fermais pour n’en pas rester éblouie. Après son passage j’avais comme la tête qui tournait, à cause du contraste violent entre sa vitesse, sa lumière, son bruit, et la lenteur de ma progression dans le boyau muet. J’étais dans l’une des artères principales de Paris, jadis jour et nuit parcourue d’une circulation incessante, et maintenant on se serait cru dans les catacombes.
À la hauteur du Val-de-Grâce, une carcasse de voiture rouillée et désossée encombrait la petite place à la fontaine gelée. Je n’avais encore croisé personne, sauf un cycliste sans phares. Malgré le silence je ne perçus sa présence qu’au moment où son vélo me rasa en chuintant dans sa descente en roue libre et en sens interdit, alors que j’allais m’élancer pour traverser. Je scrutai l’ombre et tendis l’oreille pour m’assurer que plus rien ne venait, et les yeux rivés sur la masse claire de la bâtisse, rejoignis les hautes grilles, sur l’autre trottoir. J’essayai, en vain, de pousser le portail. Non, ce n’était pas cette nuit que je pourrais aller me recueillir dans la chapelle ni déambuler dans les galeries de l’ancien couvent. Que restait-il de ce pays où une reine fit élever un élégant édifice de pierre blonde pour remercier Dieu de la naissance de son fils, le futur Roi-Soleil ?
Je traversai dans l’ombre la rue Gay-Lussac, poursuivis ma descente le long des trottoirs verglacés. Au 216 de la rue Saint-Jacques était né Cendrars, dont j’avais un jour dit, au Théâtre Molière, la longue Prose du Transsibérien – Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre ? –, né là où avait été écrit le Roman de la Rose, en ce Moyen Âge dont j’avais beaucoup fréquenté le musée, plus bas dans la rue pour contempler la Dame à la licorne posée sur son île de verdure au plan incliné comme celui de ma clairière, à la montagne.
Au 176, je levai les yeux sur le deuxième étage de l’immeuble qui s’avance sur une courte portion de large trottoir, à l’emplacement d’une ancienne porte de la ville. L’endroit où, de ses trois voies de circulation en montant du boulevard Saint-Germain, la rue se rétrécit à une seule. Dès l’île de la Cité on voit, au fond de l’artère rectiligne, ce mur d’habitation qui marque la frontière des anciens faubourgs.
J’avais vécu là à la fin du siècle précédent, à côté de la librairie d’art tenue par Nassir, un Libanais qui m’offrait chaque fois que j’y passais du café à la cardamome et des gâteaux au miel, tout en évoquant la situation au Proche-Orient, d’année en année de plus en plus préoccupante malgré quelques répits, et qui avait déterminé son destin, à lui l’ancien journaliste chassé de son pays par la guerre. Durant toute cette période autour du changement de millénaire, la haute instabilité politique de cette région laissait planer dans les esprits la menace d’une libanisation étendue, pour les plus pessimistes, au-delà de la Méditerranée jusqu’au cœur de l’Europe, où les crimes racistes et les violences urbaines se développaient en même temps que les communautarismes exacerbés par le conflit israëlo-arabe.
Et je sentais grandir dans mon propre corps la croix dressée dans le corps de ces terres sensibles, où naquit et reviendra la lumière, où l’homme devint un nom propre et révélé, où se déploya l’espace aux quatre directions, où l’homme dans l’amour se connaît. J’étais cette géographie de l’Eden perdu et pourtant toujours là, dans l’eau le soleil, les cèdres les yeux doux des hommes, je sentais en moi cet orient si proche, si prochain, cette chair de l’être déchirée par la guerre et soutenue par l’esprit. Une croix intérieure m’irradiait d’amour et me clouait au plus cruel des manques, le manque de réponse à la question : pourquoi ?
J’avais quarante ans et je demandais toujours : pourquoi ?, de plus en plus douloureusement. J’avais du moins compris que l’Esprit travaille de la même façon les individus et les peuples, la nature et la nature de l’homme, j’avais compris ce que je savais depuis toujours, ce que les hommes savent depuis qu’ils sont hommes et ont commencé à imprimer leurs mains sur les parois des grottes, à y graver et peindre les animaux de leurs forêts et de leurs visions pour franchir le pas entre nature et surnature, j’avais compris ce qu’il devient si difficile à entendre dans le bruit et l’éparpillement du monde technologique, et aussi difficile à dire qu’à écrire, à l’heure des textes hachés à la mode communicationnelle, en longues phrases déambulant dans un labyrinthique livre : l’unité du tout.
Au rez-de-chaussée de l’immeuble où je vivais alors, un restaurant chinois tenait la place qu’avait occupée, un siècle plus tôt encore, l’Académie d’Absomphe, une taverne où Rimbaud alla souvent dès le matin chercher l’ivresse de l’absinthe. Quand vint pour moi et ma famille le temps des ruines, préfiguration des Ruines qui allaient frapper notre pays, je pris les roses dans le vase du salon et nous partîmes en pèlerinage chez le poète, à Charleville où je les déposai sur sa tombe, après avoir fait réciter en route Ma bohême à nos deux jeunes enfants. C’était Beyrouth dans mon cœur, ville ravagée par un amour illusoire, aussi destructeur qu’une guerre, et qui devait me laisser de longues années sans consolation.
Quelques mois plus tard, réduits en même temps qu’au désarroi existentiel à une situation financière catastrophique, nous quittions Paris, faute de pouvoir payer plus longtemps le loyer de cet appartement où nous avions passé un long temps de bonheur. Souvent, après notre installation à la montagne, j’avais fui le foyer pour revenir errer, seule, dans la ville de mes impossibles amours, trouvant toujours refuge chez une connaissance, un ami ou un proche, et retournant sans cesse dans mon ancien quartier, où je déambulais des journées entières, passant sous mes fenêtres en me demandant pourquoi je ne pouvais pas rentrer chez moi pour me reposer un peu. J’avais bien sûr déjà quitté, sans drame aucun, de nombreux appartements de location, mais ce que j’avais en vain vécu dans celui-ci, et les circonstances de notre départ, semblaient signer l’anéantissement de toute ma vie. J’étais devenue une âme errante, je déambulais entre la vie et la mort sans pouvoir m’établir ni dans l’une ni dans l’autre, et ce n’était pas fini, ce ne serait pas fini tant que je n’aurais pas accompli ma mission.
…
La richesse monstrueuse que je sentais en moi, je ne pouvais pas la dire avec la langue savante et autorisée du bourgeois, je ne pouvais pas la dire avec la langue restreinte et peu exigeante du populaire, je ne pouvais écrire ni dans mes habits de nouvelle riche ni dans mes habits d’ancienne pauvre, je ne pouvais écrire que nue. Je ne pouvais écrire que de mon désert natal, d’où je voyais avec une acuité presque insoutenable le cirque écoeurant des hommes et le cœur splendide du monde.
…
La tour de la Sorbonne se perdait dans la brume, la nuit, la désolation. Ses murs étaient aussi longs que ceux de la Santé, la prison proche aussi du boulevard Gabriel, chez moi. L’ancien Collège de France, prestigieuse institution qui avait accueilli les plus grands noms de toutes les disciplines du savoir, hébergeait maintenant les bureaux de la P.S., Police Spéciale, dont les méthodes étaient directement inspirées des dérives occultes pratiquées par Sad, du temps où il fut ministre de l’Intérieur et où je l’aimais. Espionnage, chantage, torture mentale, mensonge, manipulation, élimination de preuves… Il ne faut pas être trop scrupuleux avec sa conscience quand on occupe ce genre de poste, n’est-ce pas ?
…
Cette nuit pourtant était assez claire. Quand je me fus assez éloignée des projecteurs de la P.S., je relevai la tête vers le ciel. Épais, noir, mat. Je m’arrêtai pour l’ausculter, me tourner en tous sens à la recherche d’une étoile. Eppur, elles y étaient. À moins que je ne les aie trop bues autrefois, où je les avalais par tasses entières, courant au-devant des vagues de cet océan céleste avec des cris de joie, riant à l’énorme Voie Lactée, lame de fond écumante qui emportait dans son sillage les bêtes fabuleuses, plongeant et buvant la tasse, oui, la tasse de sel de la vie, que les nuits projetaient aux cieux des déserts où toujours me ramenait mon existence d’enfant ivre. Je les avais tant bues qu’elles avaient fini par se tarir. Etait-ce donc ça, la loi ?
La loi n’est rien, répétais-je au temps où, lectrice de Paul de Tarse, je sentis le christianisme se révéler à moi dans sa magnificence absolue, annihilant la mort. J’avais compris, j’avais vu ce qui échappe à la vue. Le sens de cette spiritualité adorable, que je pouvais saisir par fulgurances ou longues extases, longues de plusieurs semaines, me filait souvent entre les doigts, mais je finissais toujours par rattraper des yeux ma belle truite, fil de lumière dans l’eau vive.
…
Tout ce que j’avais à faire était d’aller trouver Haruki, pour lui demander de m’aider à entrer en action. Je ne l’avais pas vu depuis des mois, mais j’étais sûre que lui était toujours vivant, qu’il faisait partie des quelques vivants qui restaient certainement dans ces limbes. Peut-être même était-il déjà passé à l’acte, d’une façon ou d’une autre, derrière le paravent de son bar chaque nuit hanté par les morts-vivants de la cité.
Je ne suis pas seulement écrivain, pensai-je. C’était la première fois que me venait ce sentiment, et je m’étonnai de l’avoir formulé au présent. Oui, même sans livres, j’étais toujours écrivain, peut-on cesser de l’être, peut-on cesser d’être ce qu’on est, sauf à mourir ? Je n’avais pas été le meilleur auteur de mon temps, loin s’en fallait, mais j’étais des rares qui n’avaient pas seulement à écrire, mais aussi et peut-être surtout, à dire. J’avais connu l’époque de l’écrit proliférant par les livres, la presse, l’Internet, l’affichage ; du bavardage par écrit généralisé, assourdissant, absurde, tournant en rond, au sein duquel chacun se voulait écrivain, oubliant qu’écrire demande solitude et retrait, longue solitude et long retrait. L’époque où de plus en plus pourtant devenaient effectivement écrivains ; et où les écrivains étaient de moins en moins lus, pour la bonne raison qu’on n’avait plus besoin d’eux mais de prophètes, d’hommes armés et porteurs d’une parole. Ce que j’avais pu apprendre du métier d’écrivain m’avait servi à essayer de parler, pas à faire de la littérature. Et c’était peut-être cette parole encore contenue que les gens avaient cherchée dans mes yeux, au Sacré-Cœur.
Je les avais tous aimés, même en feignant la distance. Ils étaient mes enfants, aussi bien que ceux que j’allaitais sur mes genoux. Sans doute étions-nous maintenant réduits à l’état de vers ou de rats de la déchetterie ; en poursuivant ma descente de la rue Saint-Jacques, je pensai à tous mes concitoyens terrés dans des lits froids, qui m’avaient autrefois inspiré colère et dégoût par leur lâcheté, leur aveuglement volontaire, leur dévotion aux plaisirs et aux conforts ; il ne leur restait plus que la vie mécanique, totalement aliénée et misérable où les avait conduits leur longue décadence. Ils étaient là, réglementairement endormis dans la nuit ou cherchant le sommeil malgré leur ration de Climax, et s’il ne restait en eux qu’une minime lueur d’humanité, elle m’inspirait une compassion d’autant plus grande.
Au cours des siècles, et de plus en plus, l’homme s’était révélé si mauvais qu’il ridiculisait même le Diable, avec ses vieux tours pendables et trop connus. Mais chaque fois que j’ai appris qu’un être humain se formait en moi, chaque fois que j’ai su que j’étais enceinte, j’ai su aussi, instantanément et avec la plus vive évidence, que l’être humain est ce qu’il y a de plus précieux sur terre.
…
Je rêvais que j’étais SDF. Mais sur les toits de Paris. C’est là que je vivais et dormais, au lieu de la rue. En me réveillant je décidais que c’était fini, la fatigue, et je partais une nouvelle fois cueillir des framboises. Pas trop loin, près. J’avais la tête qui tournait beaucoup, je prenais les framboises et les cèpes. La clairière m’attendait comme la vache qu’on la traie. Elle était aussi la demeure de la Lumière qui s’était un jour montrée à moi, elle était ma bure, ma nuisette et mon bureau. Je rentrais, le pantalon trempé de rosée, et je voulais en mettre un autre. Mais je restais couchée sur le lit toute mouillée, à penser que j’étais faite pour la vie, pas pour le monde des hommes. Je pensais à certaines personnes qui me donnaient l’impression si forte d’être d’une autre espèce, d’être de l’espèce humaine, elles. Ce qu’on appelait aujourd’hui l’espèce humaine. Des corps tout couverts d’une épaisse peau aveugle, et rugueuse.
…
Je regardai la Seine jeter des éclats durs dans la nuit comme le Ténéré au soleil. Des lueurs bleu d’acier y traçaient des mirages de fissures, mais je savais la glace assez épaisse pour supporter que l’on y taillât des chemins de fer et qu’on y fît circuler des trains, si l’on avait soudain conçu l’idée de relier les antiques gares des deux rives pour faire de la ville morte un circuit de jeu géant. Au long de ses courbes, un peu en retrait des ponts non entretenus et devenus dangereux, on avait planté d’un bord à l’autre du fleuve des barrières de cordes où s’accrocher pour passer sans glisser ni se briser les os sur la surface gelée. Grâce à cet équipement, la traversée s’annonçait plus facile que la descente de la rue Saint-Jacques, au bas de laquelle m’était réapparu Arthur Cravan, qui avait au numéro 67 fabriqué et vendu seul sa revue Maintenant avant de partir errer de par le monde et de disparaître en mer, type de poète comme ils semblaient avoir été définitivement éliminés de l’espèce humaine, les Rimbaud, les Maïakovski, les Essénine, enragés de vie au moins autant que de verbe. Et moi, que puis-je tirer de mon corps troué pour le va-et-vient des hommes, de la vie et de la mort ? Que je me presse, je suis le tube de couleurs d’où sort la nature nue et pure telle que ne la peuvent retrouver que les êtres sexués pensant au-delà de l’homme et de la femme.
…
Qu’est devenu le peuple ? À l’âge de vingt-six ans, subsistant depuis longtemps et encore pour longtemps entre petits boulots et chômage, j’ai décroché pour quelques semaines un job d’agent recenseur. Par tirage au sort il m’avait été attribué le secteur “Bordeaux Nord”. Le superviseur m’a alors proposé de m’en donner un autre. J’avais l’air d’une poupée de dix-huit ans, il ne voulait pas m’envoyer arpenter pendant des heures et des jours, seule, l’un des quartiers les plus durs et les plus misérables de la ville. Il a même insisté, mais je ne voulais pas de passe-droit, je n’avais pas peur et je l’ai fait sans problèmes, pendant que mes petits de six et deux ans, avec lesquels je vivais seule, étaient à l’école. Entre les barres HLM et les bicoques parfois sans eau ni électricité j’ai effectivement vu beaucoup de misère, je ne pouvais pas me permettre de laisser les papiers, il fallait que je les remplisse sur place avec les gens, souvent incapables de le faire eux-mêmes ou très hostiles à la paperasserie et au Pouvoir, dont j’étais à leurs yeux une représentante. Je me faisais belle pour y aller et tout s’est bien passé, je me souviens d’avoir mangé des loukhoums à la rose avec un vieil Arménien solitaire, avoir bu du café avec une femme dont tous les fils étaient en prison, et sur bien d’autres toiles cirées poisseuses d’alcool, avoir aussi vaincu ma peur de bien des bergers allemands aboyeurs.
Avec une partie de l’argent gagné au bout de plus d’un mois de travail, 1600 francs à l’époque, je suis allée chez Conforama acheter une table et des bancs en pin blanc, bien neufs et clairs ils ont fait comme un rayon de soleil dans la pièce où on mangeait, les enfants et moi. J’aimais bien cet appartement sous les toits, dans le quartier Saint-Michel, les pièces étaient petites et éclairées directement du ciel par des lucarnes, tout aurait été parfait s’il n’y avait toujours eu, en se levant le matin, un énorme cafard noir qui courait sur le lino. À ce moment-là j’étais très pauvre, il n’y avait pas de RMI et j’avais beaucoup moins de moyens qu’un Rmiste plus tard, je n’avais rien, par exemple je n’avais pas le téléphone, ce qui n’était pas grave, ni de quoi manger à ma faim, ce qui n’était pas trop grave non plus tant que j’arrivais à nourrir mes enfants. Mais ça m’a toujours peinée, ensuite, de voir des personnes bien en chair aller aux restos du coeur ou faire la manche. Les pauvres avaient donc tout perdu. Ils avaient perdu la faim réelle, celle qui vous rend maigre et irrécupérable comme un loup, et avec elle leur dignité, qui aurait dû les inciter à cracher dans la soupe à Coluche. Même les pâtes étaient chères pour moi, je ne risquais pas d’être un peu enrobée. À ce moment-là je lisais comme une affamée, béni soit le pays où même les démunis peuvent trouver à lire, c’est à cette époque que j’ai lu La Faim de Knut Hamsun.
Les périodes de pauvreté sont finalement celles qui s’obstinent le plus dans ma mémoire. La pauvreté isole, j’étais très isolée, une femme seule avec deux enfants est plus isolée qu’une femme seule. Le très pauvre n’entre jamais dans un café, un restaurant, un cinéma, un train, un avion. Mais enfin j’avais du temps, de la lecture à volonté, de l’amour quand ça me chantait et ça me chantait tout le temps. J’étais toujours joyeuse, il me semble. La grande pauvreté est une grâce, surtout quand elle est choisie. À qui elle est imposée, elle est aussi une malédiction. Elle vous marque à l’âme, elle vous marque à vie parce qu’elle est aussi le signe d’une vie nécessiteuse, la victoire de la mauvaise destinée, de cette anankè qui désigne aussi en grec les liens du sang (la fatalité de la naissance) et la torture, la prison. C’est comme ça qu’ensuite le riche se sent comme naturellement autorisé à vous traiter en sous-homme et à vous rayer de cette carte du monde où vous n’avez jamais eu le droit d’exister vraiment.
…
Quand j’ai relevé la tête, j’ai regardé en bas et j’ai vu des corps un peu partout par terre, du sang et des bouteilles vides. Plus personne ne se battait, presque plus personne ne baisait. Je me suis retournée vers ma Joyce, j’ai vu les ciseaux plantés au niveau de l’estomac, le sang épais. Elle n’était pas morte, puisqu’elle a dit : “Encore !”
J’ai enfilé ses fringues de soldat, j’ai ouvert le vasistas, je m’y suis faufilée, j’ai sauté dans la nuit et je me suis mise à courir, courir.
D’où vient le crime ?
La plus grande ruse du Diable, c’est de faire croire qu’il n’existe pas. “J’ai trente-deux ans et j’ai reçu une formation de tueur psychopathe. La douleur me fait bander.” Le soldat Massey veut ébranler les murs des consciences de ses compatriotes et laver la souillure qui l’empêche de trouver le sommeil. Dans cet univers inversé où des hommes transformés en machines à tuer pactisent avec la bête dans un parfum de sang et de terreur. Communient dans la violence.
Dehors les champs, la terre gelée, les collines, les forêts de pins, un bouleau isolé, un moulin abandonné avec un homme pendu à l’intérieur.
Je t’aime, mon ange, tu es beau, tu es doré, tu es doux et dur comme un lionceau, je me promène dans tes forêts, je me promène sur ta peau, je brûle, je fonds, je tombe à tes pieds, je te lèche, je perds la tête, je t’aime.
Les forces coalisées la population locale les programmes d’aide le travail de reconstruction les bases militaires les camps les jeux sur les ordinateurs portables la cantine les patrouilles du soir.
Nous aimons la nuit. Fusils à visée nocturne ils ne peuvent pas nous voir, les terroristes aussi aiment la nuit.
Dis-moi si tu le sens dis-le moi dans ta tête.
Check-point, quelquefois nous trouvons des choses dangereuses armes explosifs mortiers.
Ils comptent les jours qui les séparent du retour au pays.
L’existence de ce peuple est menacée.
L’existence.
Maternité, paysage dévasté, ruines, hommes arrêtés puis déportés la nuit, rafles.
Dans les rues femmes enfants vieillards.
Tortures, exécutions, la mort est partout, silencieuse.
Résistance par la vie, naissances, survie du peuple, femmes dans les couloirs, chaque jour médecins et sage-femmes risquent leur vie pour se rendre à la maternité.
On n’a pas perdu notre humanité.
Humanité.
Pas de chauffage, l’électricité rarement, l’eau précieuse.
Couvertures de fortune, draps entassés, bébés couchés par deux pour conserver la chaleur, les mères sont malades, pas assez de lait, presque tous prématurés la plupart maladies respiratoires, la bonbonne d’oxygène dans la salle de couveuses, danger. D’autant que de dehors ça tire tout le temps, beaucoup de bébés meurent.
Par-delà le brouhaha du banquet j’entends une voix qui dit “je suis”, c’est un poème, je tends l’oreille mais la suite se perd, je ne comprends que ce “je suis” qui revient régulièrement, lancinant, ce n’est pas possible personne ne dit un poème, je regarde les gens les bouches pas de poème sur aucune bouche et ce “je suis” qui revient lancinant, un violoncelle violonce ses notes de silence, ce “je suis” se perd dans la foule et j’ai sur le palais un goût de raisin blanc.
Le vent la nuit dans la forêt à peine souffle la neige est un nuage ces gros flocons lents, vraiment, on dirait du duvet d’anges.
Dans la forêt j’ai retrouvé mon homme la nuit dans la forêt, il était là parmi les loups dormant au creux de leur cercle d’argent. J’ai avancé dans leur fourrure et ils m’ont reconnue puisque j’avais la même odeur que lui. Les loups étaient couchés là sous la lune et chacun sur mon passage me léchait les chevilles, en gémissant comme une femme qui jouit quand il ne faut pas faire de bruit.
Et j’ai marché dans leur pelage cachant sous mon manteau de soldat mon sexe rougeoyant qui tisonnait mon corps, et j’ai léché mon homme, couchée à ses côtés moi sa louve gémissante j’ai léché les paupières de mon homme, la nuit et la nuit j’ai léché le pus qui collait ses paupières et au petit matin il a ouvert les yeux.
Beaucoup de femmes meurent en couches.
Mitrailleuses kalachnikov bombes grenades tanks seuls bruits que les enfants connaissent.
La famille apporte à manger aux accouchées.
Bougies et lampes à kérosène car les soldats tirent sur les transformateurs pour s’amuser.
La nuit je ne dors pas j’ai peur j’écoute on ne voit pas la fin de cet enfer.
Je me sens brisée l’angoisse est partout on a tous un déséquilibre de l’âme.
Nous sommes prêts au combat ils veulent exterminer un peuple.
Où est la brande enneigée où couraient les sentiers les champs les arbres et les taillis les pierres et les marais ?
Armes chimiques biologiques nucléaires nous devons nous tenir prêts à utiliser n’importe quel type d’arme pour tenir tête à l’ennemi.
Au loin brillait la lumière d’une masure.
Nous riposterons notre peuple a reçu la lumière.
Lequel filait sans se retourner sur la neige où brillait la lune.
Zone de repli, base logistique, centres de décisions, les combattants s’infiltrent par une zone frontalière difficile d’accès, le gouvernement ne la contrôle plus, ils tentent de réduire à l’impuissance les seigneurs de la guerre.
Je le promets devant Dieu, fit le voleur qui d’un geste ample montra les taillis les carrières les marais et les champs plongés dans la nuit.
Mon amour est un lointain pays aux frontières de feu dont je franchis le cercle par les bonds insensés de ma jument nerveuse, une fois projetée dans sa sphère en chaleur je m’enroule avec lui autour de son noyau et là où confondus nous sommes un seul serpent, je lui suce la queue.
Camps d’entraînement, aucune mesure significative pour les démanteler, organisations terroristes, nul n’est coupable tant qu’on ne lui a pas démontré sa faute.
La savoureuse queue.
Des jeunes gens préparés depuis leur plus tendre enfance à devenir des martyrs.
La savoureuse queue où je sens affleurer tout contre mon palais l’exquis magma de ses laves en fusion.
Notre foi est pure nous sommes prêts à partir pour la guerre car c’est la volonté de Dieu.
Mon amour est le secret pays niché entre mes cuisses.
Les combats embrasent le pays.
Gorgé de mon brûlant désir.
Scintillant d’explosions.
Début de l’offensive de printemps.
C’est de là que j’appelle, là où il se trouve, dans la nuit de la chair d’où jaillit la lumière, jaillissent et rejaillissent nos corps galvanisés.
Hauts dignitaires, cibles potentielles, attentats-suicides, commandos, convois, créer un climat de terreur, d’anarchie, d’insécurité.
Dans la nuit de lumière qu’il veut que je lui donne et que la petite voix
gigantesque dépôt de munitions
de mon volcan l’appelle à venir dérober.
Nouvelle offensive.
Combattants retranchés dans les montagnes.
Body-bags avec dedans les corps des soldats tués.
Multiplication des mutilations.
Grenades et roquettes lancées lors des embuscades, grenaille des bombes artisanales utilisées dans les attentats-suicides, éclats d’obus, mains membres yeux arrachés, chirurgiens militaires.
Un soldat tourne des vidéos-souvenir, une partie d’entre eux ne rêve que d’appuyer sur la détente et de revenir en racontant combien ils en ont tué, la dépression fait des ravages.
Le cheval mort dans l’arbre dis-le moi dans ta tête tais-toi je ne veux pas entendre je veux juste savoir si tu les sens marcher toutes les roues dentées qui tournent dans ma tête.
Un seul désir rentrer chez eux, ils tuent des hommes non armés des innocents et après ils cogitent pourquoi cette guerre.
Il a sauté sur une mine de sa propre armée.
Lors d’une attaque de terroristes femmes et enfants parmi les victimes.
Des dragons dans le ciel chéri dis-moi si tu les vois, que je voie tout sortir vas-y chéri tu es beau tu es si beau quand tu le fais.
Lorsque chez l’amant mystique l’amour humain atteint à ce paroxysme extatique.
Des corps dans des sacs au milieu de la rue.
Vas-y vas-y vas-y, vas-y mon salaud viens montre-moi ça.
Des morts jonchent les rues, des chiens mordillent leurs cadavres, il fait froid, humide, la puanteur est insupportable.
Dans le même jour il fleurit et il vit tant qu’il est dans l’abondance, il meurt lorsqu’il est satisfait.
L’épais manteau neigeux qui recouvre la ville bombardée assourdit tout sauf le pilonnage de l’artillerie.
C’est l’amour de ma vie elle dit et les autres rigolent.
Rendez-vous ou vous serez détruits sans pitié, serinent les haut-parleurs des hélicoptères.
Nettoyage nocturne, des colonnes de soldats enserrent et verrouillent le quartier, dans la maison ils me trouvent.
Rendez-vous rendez-vous, ils cherchent des caches d’armes des terroristes, ils me trouvent ils me violent, en uniformes lourdement armés.
Arrêtent les futurs disparus détruisent les maisons puis s’évanouissent laissant dans leur sillage pleurs terreur ruines fumantes cadavres fille violée eau polluée.
Pas d’eau au robinet et dans les rivières on jette les cadavres.
Hommes femmes et enfants fagotés ensemble et pulvérisés à la grenade et à l’explosif.
Mourir pour de l’eau en allant chercher de l’eau.
…
Dans l’escalier qui remonte des berges de la Seine à l’île de la Cité je me retournai, le temps de voir que des pans de glace se désolidarisaient et avançaient lentement dans le lit du fleuve, qui recommençait à couler. En sentant les premières gouttes, je relevai les yeux au ciel. Les cumulus s’étaient rassemblés en une gigantesque masse noire, et oui, il pleuvait. Sur le parvis de Notre-Dame, les gens se mirent à pousser des cris de joie.
…
De la galerie des chimères j’ai vu se monter peu à peu les six minarets autour du Sacré-Cœur, six minarets fins, circulaires et élancés comme ceux qui entouraient Sainte-Sophie à Istanbul, dédiée à la Sagesse de Dieu, quel que fût le nom de ce dieu. Et j’entendis les messes reprendre à Notre-Dame, puis les répétitions d’orgue. De là-haut je vis les marchands à la sauvette s’installer sur le parvis, où le monde recommençait à circuler. La glace, en s’évacuant, avait dû aussi emporter la pollution du fleuve, car il y avait chaque jour des pêcheurs à la ligne au bout de l’île et sur le Petit Pont. Les péniches avaient repris du service, tout était de nouveau animé.
…
Retourne-toi, fais face à ce qui te poursuit, combats loyalement.
Fracasse le miroir. Quand tu sauras que le royaume ceint d’un miroir n’est pas encore le royaume.
Être puissant n’est pas régner sur soi ni sur autrui. Qui veut régner est appelé araignée, comme a dit le poète. As-tu envie d’une existence d’araignée ? La puissance est dans la foi.
La foi c’est juste adhérer à la vie, à la ruche de sens de la vie. Être relié aux circuits qu’ils empruntent par et depuis toutes les dimensions. La foi, c’est être au centre des sens l’absolu de la justesse. Souviens-toi : il ne s’agit pas d’avoir la foi, il s’agit de l’être. Sois la foi.
Sois souple, écoute la Langue, réponds, ajuste-toi, navigue.
Sois souple vraiment, car voici l’aube des déchirures et des passages entre les dimensions, voici le nouveau monde et les nouvelles vies à inventer.
Sois doux, sois douce.
Que le chant te porte.
Je t’aime. »
Je me tus, et l’oiseau s’envola.
…
L’Ecriture déclare : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé.
C’est difficile de regarder dans les yeux, on a peur de se noyer. Pourtant c’est la seule chose à faire, en ce monde.
Le calme d’avant quelque chose était tombé. Il faisait froid, je frissonnais de fièvre. Je me suis efforcée de rester très attentive, je voulais tout voir. Je regardais les brindilles au bout du bout des branches, aussi tendues que moi, je regardais au-delà des faîtes des arbres, dans la trouée. Et soudain j’ai vu arriver au galop le ciel de neige, suivi de ses blanches armées. Déversée de partout elle est venue, dansante, voluptueuse. Oh, mon dieu, que de beauté. Tout ce blanc, l’amour. Je me suis relevée sur mon coude, et dans un étourdissement j’ai vu aussi des étoiles dorées surgir et valser avec les flocons et les petites plumes duveteuses, partout sous mes yeux, où que je les tourne. Oui, je vais appeler Florent et les enfants, leur dire comme tout sera beau lorsqu’ils me rejoindront, à Noël.
extraits de Forêt profonde
tandis que le prochain roman est en route, ainsi que la prochaine vie, que je vous donnerai comme je l’ai toujours donnée
*

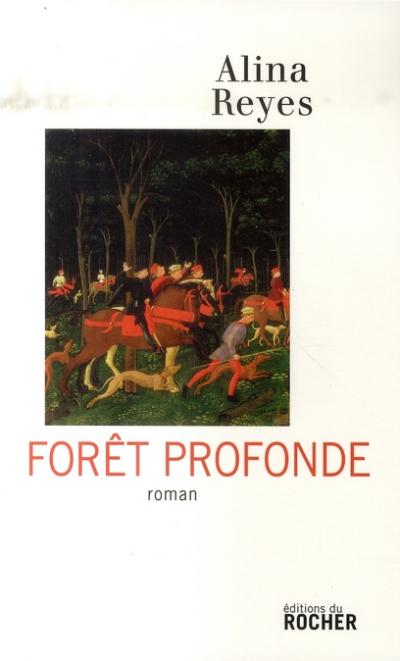


 …Vivre libre ne peut que provoquer la jalousie du destin, pensai-je vers l’âge où Dante pénétra aux Enfers. La jalousie du destin, j’avais lu cette formule sous la plume de Julien Green, et elle m’avait autant frappée, par son caractère énigmatique, que le nom de cette petite ville des Etats-Unis où j’étais passée un jour, Truth or consequences. Trois mots chaque fois, dans les interstices desquels se glisser pour allumer la lumière, même s’il ne s’agissait que d’une minuterie – puisque nous passons le plus clair, si l’on peut dire, de notre vie, à voir confusément, comme dans un très vieux miroir plein d’ombres.
…Vivre libre ne peut que provoquer la jalousie du destin, pensai-je vers l’âge où Dante pénétra aux Enfers. La jalousie du destin, j’avais lu cette formule sous la plume de Julien Green, et elle m’avait autant frappée, par son caractère énigmatique, que le nom de cette petite ville des Etats-Unis où j’étais passée un jour, Truth or consequences. Trois mots chaque fois, dans les interstices desquels se glisser pour allumer la lumière, même s’il ne s’agissait que d’une minuterie – puisque nous passons le plus clair, si l’on peut dire, de notre vie, à voir confusément, comme dans un très vieux miroir plein d’ombres.