
« Life Is a Gift », technique mixte sur bois (fond et cadre d’un vieux miroir brisé) 38×48 cm
Pourquoi faisons-nous des cadeaux aux enfants, et les présentons-nous comme venus du ciel ? Parce qu’eux-mêmes, en naissant, sont des cadeaux venus du ciel. La vie est un cadeau qui nous vient du ciel à chaque naissance, les nôtres, celles des autres ; et les cadeaux que nous faisons et recevons à l’âge adulte rafraîchissent en nous l’enfance. Noël est la fête de l’origine, de la joie que donne la survenue de l’original – ai-je songé cette nuit en lisant ces mots d’Haruki Murakami dans son livre Profession romancier, alors que j’ai demandé pour Noël un CD du Sacre du printemps, que j’ai tant et tant écouté dans ma jeunesse et que j’ai follement envie de réécouter :

« Chant du monde », technique mixte sur papier A4

« How many People in the Universe ? », technique mixte sur papier 42×30 cm
« Les Beatles. J’avais quinze ans lorsqu’ils sont apparus. Je crois que la première chanson d’eux que j’ai écoutée à la radio était Please Please Me, et j’en ai eu la chair de poule. Pourquoi ? Parce qu’il y avait là des sonorités que je n’avais jamais entendues. Tout simplement, j’ai trouvé cela génial. J’ai du mal à expliquer ce qu’il y avait là de si incroyable, mais c’était époustouflant. Environ un an plus tôt, j’avais ressenti une impression presque analogue en écoutant pour la première fois Surfin’ USA, des Beach Boys, à la radio. « Ah, ça, c’est extraordinaire ! » « Complètement différent ! »
En y repensant aujourd’hui, je comprends que mon émotion était due à l’originalité exceptionnelle des Beatles et des Beach Boys. Ils émettaient des sons que personne n’avait produits jusqu’alors, ils faisaient de la musique comme personne jusque-là. Qui plus est, d’une qualité sans pareille. Et ils avaient quelque chose de tout à fait spécial. C’était tellement clair qu’un adolescent de quatorze ou quinze ans pouvait le saisir immédiatement, même en écoutant ces chansons sur un pauvre transistor. En somme, l’affaire était toute simple.
Mais où résidait l’originalité de leur musique ? En quoi étaient-ils différents des autres musiciens ? Il me paraît extrêmement difficile de donner une réponse logique et argumentée à ces questions. Pour le jeune homme que j’étais, c’était une tâche impossible, et aujourd’hui encore, alors que je suis écrivain de métier, j’ai beaucoup de mal à le faire. Pour pouvoir fournir ce genre d’explication, il faudrait avoir les compétences d’un expert, mais, même avec cet éclairage théorique, le résultat ne serait peut-être pas très concluant. En fait, tout va bien plus vite quand on écoute leur musique. Écoutez-la, et vous comprendrez.
(…)
On pourrait dire la même chose du Sacre du printemps, de Stravinsky. Quand cette œuvre a été donnée à Paris en 1913, le public a été sourd à sa nouveauté et s’est livré alors à un chahut monumental, resté célèbre. Cette partition qui allait contre toutes les conventions avait stupéfié l’assistance. Mais, au fil des représentations, les réactions hostiles se sont calmées, et de nos jours Le Sacre du printemps est devenu extrêmement populaire. (…) Quand le public d’aujourd’hui écoute Le Sacre du printemps, il n’y a ni tumulte ni stupeur, les auditeurs étant néanmoins capables de ressentir la fraîcheur intemporelle et la puissance de cette œuvre. Cette émotion est en somme une référence mentale des plus précieuse. Un repère essentiel auquel ceux qui aiment la musique se raccrochent, et qui, pour une part, sert de base à leurs jugements de valeur. Pour aller à l’extrême, disons que, entre ceux qui ont entendu Le Sacre du printempset ceux qui ne l’ont pas entendu s’est instaurée une certaine différence dans la profondeur de leur compréhension musicale.
(…)
Pour qu’un créateur puisse être qualifié d’« original », il doit, à mon avis, satisfaire à ces conditions fondamentales :
1) Il faut qu’il possède un style qui lui soit propre (sonorités, manière d’écrire, formes, couleurs), clairement différent des autres, et qui doit être perceptible immédiatement.
2) Il faut qu’il ait la faculté de retrouver de la nouveauté. De se développer avec le temps. De ne pas stagner. Il doit posséder en lui-même une force de renouvellement spontanée.
3) Il faut que ce style personnel devienne un standard avec le temps, qu’il soit intériorisé dans l’esprit du public, qu’il soit érigé pour partie en norme. Qu’il devienne une source d’inspiration pour les créateurs suivants. »
*
Joyeux Noël !



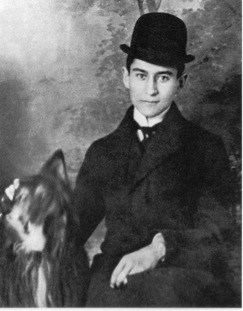 *
*