à O, qui chaque matin m’accompagna
 photo Alina Reyes
photo Alina Reyes
*
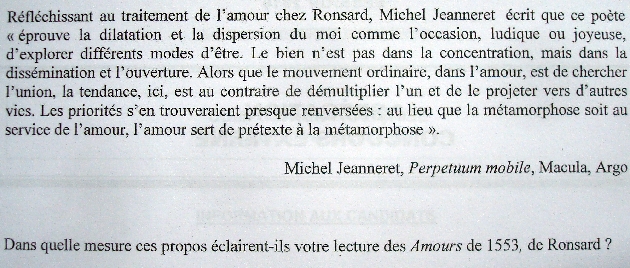 *
*
La multiplicité se lit à même le titre des Amours de Ronsard, recueil paru en 1553 en pleine Renaissance. L’innamorento venu d’Italie avec Pétrarque se décline chez le poète vendomois au pluriel. Et si ses vers gardent la marque des cruautés et des tourments infligés à l’amoureux, ils n’en sont pas moins porteurs – se distinguant par là de la tradition pétrarquiste – d’une verdeur toujours revivifiée. Il y a dans l’expérience du poète une dynamique par laquelle il échappe à l’état exclusif de patient de l’amour. Le sens du mouvement dans le recueil de Ronsard incite à s’interroger sur le sens de l’écriture comme métamorphose, ici portée par l’amour, agent ou terreau de transformation.
Ronsard aime-t-il pour se métamorphoser en écrivant, ou écrit-il pour éprouver dans l’amour la métamorphose ? Les deux hypothèses peuvent s’envisager, notamment en essayant d’identifier le « Dieu » qu’il invoque dès le premier sonnet, et la position du poète par rapport à lui : comment il est par lui contraint, mais aussi transformé : par l’écriture passant de l’hortus conclusus au chaos, puis du chaos au cosmos extérieur et intérieur.
« Qui voudra voir comme un Dieu me surmonte,
Comme il m’assaut, comme il se fait veinqueur,
Comme il m’enflamme & m’englace le cœur,
Comme il reçoit un honneur de ma honte. »
Dès le premier quatrain du premier sonnet, Ronsard invite le lecteur à « voir » ce dont il va être question, à savoir non pas une relation avec une jeune femme mais l’expérience d’une sorte de combat avec un « Dieu ». Ce dieu non nommé est généralement identifié avec Amour. N’est-ce pas lui qui donne son titre au recueil ? Mais le recueil porte la marque du pluriel et il est probable que cet Amour a plus d’un visage. Plus d’un nom, même. Les Grecs le nomment Éros, ce qui lui donne une autre profondeur que celle de l’Amour italien inspirateur de mignardises dont le recueil porte aussi la marque. Ici d’emblée nous est présenté un dieu puissant, majuscule, capable d’action violente tout à la fois dans la chair et dans l’esprit de l’homme. Ce dieu conquérant qui travaille le cœur d’oxymores et se nourrit d’antithèses semble plonger le poète dans le chaudron de son épreuve, glacé comme l’Enfer de Dante. Mais la fière façon dont il revendique cette épreuve n’est-elle pas le signe que par sa soumission à cette dernière il partage un peu la gloire de ce dieu ? Car c’est en acceptant la « honte » des tourments qu’il devient lui aussi puissant : ne faut-il pas l’être pour être capable de faire « honneur » à un Dieu – rien moins que cela.
Tout au long du recueil, le poète endure le désir, constant et presque toujours insatisfait. Cassandre est l’inaccessible. Le désir de l’aimée le brûle, le refus de l’aimée le glace. Le temps passe, il lui a donné toute sa jeunesse et n’a rien obtenu en retour, ou si peu. Si peu de charnel, du moins. Car à la fin, vient quand même le plaisir de se savoir lu et considéré par Cassandre, aussi lointaine que mythique mais pourtant proche, dans le temps et dans l’espace et peut-être par l’esprit et par le cœur aussi.
Il y a là un premier indice de transformation. Et c’est l’écriture qui en est l’agent. Parce que Ronsard écrit, parce que Cassandre lit ses poèmes, les tourments de l’amour impossible se changent en bénédictions. Ils deviennent le moyen de transport qui permet de s’élever jusqu’à la joie, ici même sur cette terre où l’objet du désir donne malgré tout de soi-même. Ici ou là son attention est évoquée, parfois même est remémoré un baiser. Pourtant le lecteur appelé dès le début à contempler ce qui fait l’expérience du poète constate que ses joies ne sont ni les plus fréquentes ni, de loin, les seules qu’il éprouve. Ronsard devant Cassandre ne se place pas seulement face à un être humain. C’est toujours le Dieu qui mène le jeu, et ce Dieu dont Cassandre assume parfois la position, comme « quinte essence » du poète, son essence divine, distribue ses joies avec l’infinie libéralité que lui donne sa puissance d’amour. Si Cassandre ne déclare pas comme la Juliette de Shakespeare que sa libéralité est aussi vaste que la mer, le seul fait de l’aimer, donc de combattre avec Amour, transforme l’être par une augmentation peut-être sans limites. On se souvient du combat biblique de Jacob avec l’ange de Dieu. Il dura toute la nuit et nul ne vainquit, mais Jacob en garda une double marque : une hanche déboîtée, et une bénédiction glorieusement inscrite dans le changement de son nom. De Jacob, il devint Israël. Ainsi se produit aussi la métamorphose de Ronsard. Meurtri dans sa chair, dans son cœur qui souffre et dans son corps qui vieillit, il recevra pourtant un nouveau nom, celui de Prince des poètes. L’amour est bien le prétexte de la métamorphose, le matériau initial, le terreau sombre où se préparent, dans des douleurs secrètes, et à partir duquel se réalisent, la germination, la poussée, l’élévation, le bourgeonnement, l’éclosion et enfin l’ouverture totale de la rose. La rose est l’être accompli dans sa part divine, l’être est le texte, l’être et le texte ont leur racine et leur source dans l’amour, ce dieu aux multiples noms et visages (ceux des aimées successives du poète), ce dieu qui fait endurer mais aussi jouir, de et par la transformation du vivant qu’il opère.
« Tant que sous l’eau la balene paitra,
Tant que les cerfs aimeront les ramées… »,
le poète trouvera sa nourriture aussi bien dans les profondeurs mêlées de la vie et de la mort que dans l’élévation de sa pensée vers la voûte malgré tout protectrice et bienfaisante au-dessus de sa tête. Ce jardin primitif, comparable à celui que Baudelaire nommera plus tard « vert paradis des amours enfantines », forme dans l’esprit une sorte d’hortus conclusus, empreint de candeur et de délicatesse. Un cosmos aux proportions harmonieuses, de format adapté à l’enfance de l’âme, où l’océan se résume à une prairie pour animal débonnaire et où la rude virilité des cerfs s’adoucit de feuillages. Il s’agit là d’un premier état de l’amoureux, pacifié par sa découverte enchantée de l’Autre comme bulle de pureté et de beauté – bulle projetée par son propre désir de pureté et de beauté. « Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant », dira plus tard Rimbaud. C’est pourquoi peut-être Ronsard ne désire pas vraiment avancer. Certes il perdra lui aussi le premier paradis, mais sans le perdre. Parce que l’écriture née de l’amour est l’agent de la transformation, il pourra tout à la fois sortir de la clôture, connaître le vaste monde dans tous ses états, et revenir au refuge d’où Adam et Ève ont été à jamais exclus, ainsi que le commun des mortels. Nous l’avons vu, de par sa nuit avec son dieu, le poète n’est plus le commun des mortels. S’il n’est pas question chez Ronsard, à la différence de chez Pétrarque, d’espérance en une vie après la mort, c’est qu’une certaine immortalité se mêle dès à présent à la mortalité du poète. Parce que sa marche n’est pas un mouvement linéaire, qui le mènerait droit devant lui vers un avenir inconnaissable et par définition pour l’instant inexistant, mais bel et bien une projection de lui hors de lui dans tous les sens, à tout moment possible. Toujours de nouveau Ronsard en appelle aux animaux, aux végétaux, au paysage entier et en parties, pour témoigner de ce qu’il vit. Les éléments eux-mêmes y sont mêlés, il pleut quand il pleure et on dirait que c’est lui, le « il » de il pleut. Il y a là incontestablement une dépense et une joie dionysiaques. Eux sont en lui, lui est en eux. C’est une panique parfois douce et parfois violente, comme l’est la nature de Pan. Oui décidément, le dieu que Ronsard honore au prix de sa honte a bien des visages et bien des noms, figures de la multiplication de soi qu’opère le poète à partir de son geste, l’écriture.
Est-il, dans une extase orphique, passé du jardin à la forêt primitive, du cosmos au chaos ? Oui et non. Ronsard ne choisit pas, ou plutôt il choisit tout. Si, à travers la douceur des paysages de la Loire, il peut se transporter dans des « fureurs sacrées », comme le veut la conception néoplatonicienne du poète exprimée par Marsile Fircin, il ne renonce pas pour autant à cette douceur et à l’invitation au carpe diem que son prédécesseur Horace n’aurait pas manqué d’y trouver. Pas plus qu’il ne renonce au désir de parvenir à embrasser, et même à posséder, son aimée. On se moqua de Thalès parce que, disait-on, à force de marcher en regardant le ciel, il était tombé dans un trou. Ronsard n’est pas homme à qui adviendrait couramment cette mésaventure. Il se déleste, s’étend, se disperse, mais reste lui-même en lui-même et sur terre. En atteste la beauté implacable de ses vers. Le cosmos désigne en grec l’univers mais aussi, parce qu’il est bien arrangé, sa beauté. Et spécialement l’univers de la beauté féminine, le mundus muliebris : monde humain agencé selon l’harmonie qui préside à la disposition de l’univers créé, avec ses régularités de mouvements, spatiales et temporelles. L’homme retrouve là l’équilibre qu’il pourrait perdre par soif de connaissances et de sensations. Le caractère apollinien dialogue avec l’appel dionysiaque – ce qui peut se dire aussi : la poésie dialogue avec le théâtre. Dès le début, Ronsard a invité « qui voudra voir ». C’est à une représentation qu’il convie le lecteur. Le spectacle des mouvements de son âme y est donné sous des masques – allégories, figures mythologiques, images convenues (comme la blondeur de l’aimée, même si comme Cassandre elle est brune), et il s’y donne sur une petite scène, celle du texte, censée représenter le monde. Or le théâtre, tout en figurant l’extérieur, est à l’intérieur du monde, comme le monde, tout en étant hors des limites de l’homme est à l’intérieur de l’homme. Et comme l’avait défini la tragédie grecque, la mise en scène a une fonction cathartique. En ces temps de Renaissance, Ronsard, d’une autre façon que celle de Montaigne dans ses Essais, en levant le rideau sur ses passions ne se contente pas de réinventer le pétrarquisme, il assure une charge cathartique pour la communauté, mais aussi pour l’individu. Il le fait en ne renonçant pas aux appels de la chair, du petit monde humain, en ne les cachant pas. Ronsard donne de lui, de lui en ce qu’il est notre semblable et notre différent, et c’est pourquoi on le lit et le chante encore.
Amour, Éros, Dionysos, Pan, Orphée… Le dieu de Ronsard est multiple, à l’image de ses « Amours ». Comme Zeus, le roi des dieux, il se métamorphose volontiers, et pas nécessairement de façon désintéressée. C’est qu’il veut parvenir à ses fins. Et s’il ne peut parvenir à ses fins avec Cassandre en tant qu’homme, il y parviendra en tant que poète. La jouissance refusée par l’aimée, une autre aimée, l’écriture, la lui donnera, et en abondance. Certes sa nature aura changé, mais elle sera apte à changer l’homme en même temps que le poète. Du début à la fin et dans toutes les parties du recueil, Ronsard le répète : il est heureux de vivre ce qu’il vit. Et si ce ne sont Amour, Éros, Dionysos, Pan ou Orphée, dieux tantôt trop mignards, tantôt trop proches de Thanatos, de Pauvreté ou de Nécessité, tantôt trop destructeurs de l’unité de l’être, qui peuvent le rendre heureux, qui est-ce donc ? Cassandre ne le peut pas davantage. Non, des multiples et nécessaires visages des dieux, celui qui rend heureux, c’est Apollon. Dieu de la poésie, dieu de la mesure et de l’harmonie, c’est lui préside aux Amours de Ronsard, dans leur forme élégante, condensée et chantante.
« Et puis qu’au moins veinqueur je ne puis être,
Que l’arme au poin je meure honnestement ».
Apollon réduit le théâtre au foyer, et rend au foyer sa dignité. Ronsard veut bien faire honneur au dieu au prix de sa honte, mais il a le sens de l’honneur. Agrippa d’Aubigné, son adversaire sur le plan de la religion, en a témoigné : Ronsard avait l’esprit chevaleresque. Il a pu se trouver physiquement sur le champ de bataille, et c’est physiquement aussi qu’il s’implique dans les choses de l’esprit. S’il doit mourir, c’est « l’arme au poin ». L’arme du poète est bien sûr sa plume. C’est aussi sa propre chair érotisée : s’il meurt, c’est en restant jusqu’au bout du côté de la vie. Là, comme sur les champs de bataille, est sa gloire, rendue dans le vers par l’adverbe « honnestement », de sens plus fort en son siècle qu’au nôtre. Là est aussi son malheur, car les hommes n’aiment pas entendre l’honnête vérité. Et Ronsard a aussi le visage de Cassandre elle-même. Non pas la jolie jeune femme du château voisin, mais la Troyenne, à laquelle il fait référence plusieurs fois. Celle, faut-il le rappeler, qui fut condamnée par Apollon, père des Muses, à annoncer la vérité et à n’être jamais suivie, jamais écoutée vraiment. Telle est la condition de Ronsard face à Cassandre Salviati. Et plus généralement, du poète face au monde. Car même un poète reconnu et honoré comme le fut Ronsard se sait toujours en grande partie incompris. Ainsi ce dieu qui l’ « assaut » de ses inspirations, même s’il a figure d’Apollon, a aussi son caractère sombre et fatal. Il y a là une dialectique dont le poète ne peut être « veinqueur » mais qu’il assume avec noblesse.
Et sa première noblesse, évidente, est celle de son art. Le sonnet, forme semi-fixe, libère l’expression des formes poétiques médiévales, ballades et rondeaux. Ronsard, en alternant les formes dites de Marot et de Peletier, ajoute encore à sa liberté. Son recueil n’est pas régi par des règles apparentes ; il peut sembler désordonné, chaotique, avec ses textes qui n’avancent pas dans tel ou tel sens mais reprennent constamment les mêmes thèmes, les mêmes tourments, les mêmes enchantements. Cependant la composition de chaque sonnet touche à la perfection. Paradoxalement, la rugueuse dialectique entre l’apollinien et le dionysiaque trouve son équilibre dans la constance de l’être qui parle là « honnestement ». La rose est « sans pourquoi », a dit Angelus Silesius. Ainsi en est-il du poème de Ronsard : il est gratuit, l’expression d’un présent – presque toujours faite au présent – et non pas un outil pour quelque progression du récit. Le sonnet est en lui-même un hortus conclusus, bien délimité mais avec ce qu’il faut de sauvagerie, et compris dans un ensemble qui peut, de près, ressembler à un chaos, mais qui, si l’on prend un peu de distance, se métamorphose lui aussi en rose. La Terre paraît plate, mais qui peut s’éloigner suffisamment dans l’espace la voit se métamorphoser en sphère. Tel est le fond de la métamorphose : une question de point de vue. Si les thèmes du recueil tournent en rond, c’est qu’ils sont formés et animés comme la rose, comme le cosmos. Dans un sens ils composent une prison, comme la carole, la danse en rond dont la fée Viviane entoura l’enchanteur Merlin. Mais une prison bien parfumée, un jardin des délices, et dont le poète trompe la magie parce qu’il est poète, expert en évasion. Le poète franchit les barrières de l’espace et du temps par la grâce de l’amour et de son art. Est-il loin de l’aimée, il en est quand même près. Prend-il de l’âge, il n’en vit pas moins au présent pleinement. Nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve, a dit Héraclite. « Panta rei », « tout passe », « tout flue ». Ronsard fait le même constat, mais il en éprouve peu de mélancolie. Comme Rimbaud, il tend des guirlandes. Ni l’espace ni le temps ne peuvent séparer les poètes. C’est une joie, et c’est pourquoi beaucoup veulent que leurs poèmes chantent. En son temps Janequin et Certon, parmi d’autres, au vingtième siècle Milhaud et Poulenc, eurent à cœur d’unir leur art au sien.
Musique ! Dans les Amours, tout commence et tout finit avec l’évocation du gracieux troupeau des Muses. La rose a été ouverte, elle se déploie par la langue inventive de Ronsard, sa langue de temps de grandes découvertes. Qu’est-ce que l’écriture pour Ronsard ? Une façon d’éprouver l’amour, de le faire, de le réaliser. Ronsard cherche à toucher la rose, le réel. L’aventure est ardue, mais elle est belle. Physique autant que spirituelle : d’où les joies, les éclatements propres à l’ivresse des sens. Mais la démultiplication de l’être empêche-t-elle l’union ? Il apparaît, à lire l’infatigable Ronsard des Amours, qui jamais ne faiblit ni dans la peine ni dans l’extase ni dans l’art, qu’elle est en fait une dynamique toujours renouvelée de tension vers l’union, et finalement d’union.
« En toi je suis, & et tu es dedans moi :
En moi tu vis, & je vis dedans toi.
Ainsi nos touts ne font qu’un petit monde. »
*
Ce texte est celui de la dissertation, à deux ou trois mots près (et correction de la dernière citation, où je m’adressais à un « vous » collectif au lieu du « tu » de Ronsard) et avec une introduction abrégée du rappel du sujet donné, que j’ai rédigée, près de sept heures durant en mars dernier, pendant le concours de l’agrégation. Pas assez scolaire sans doute pour plaire aux correcteurs – je le signale pour les futurs agrégatifs : ne croyez pas les professeurs quand ils disent qu’il ne faut pas répéter les cours.
12 mai 2017 : j’ai retenté l’agreg cette année, en ayant cette fois conscience de la nécessité de se conformer aux codes d’écriture de la dissertation, qui après tout permettent de mettre tout le monde au même exercice. Je l’ai de nouveau préparée seule et je sais que j’ai encore été très faible en grec ancien et en grammaire, n’ayant pas vraiment eu le temps de les travailler – m’étant décidée tard j’ai seulement eu le temps de lire les œuvres au programme. Malgré cela je suis cette fois admissible. Et je reviens sur ce que je disais ici l’année dernière en découvrant que l’analyse des textes en disposant des textes est en fait prévue lors des oraux – ce qui fait un ensemble d’épreuves finalement très complet. Je ne réussirai peut-être pas l’oral, mais le fait que même en travaillant seul il soit possible de réussir l’écrit, montre que ce concours est un défi qui vaut la peine d’être tenté.
J’ai mis aussi en ligne ma deuxième dissertation, sur « Romans de la fin d’un monde, « Le Temps retrouvé » de Proust, « Le Guépard » de Tomasi de Lampedusa et « La Marche de Radetzky » de Joseph Roth »






 j’ai photographié ce baby-foot mardi au Kremlin-Bicêtre
j’ai photographié ce baby-foot mardi au Kremlin-Bicêtre


 *
*







 *
*
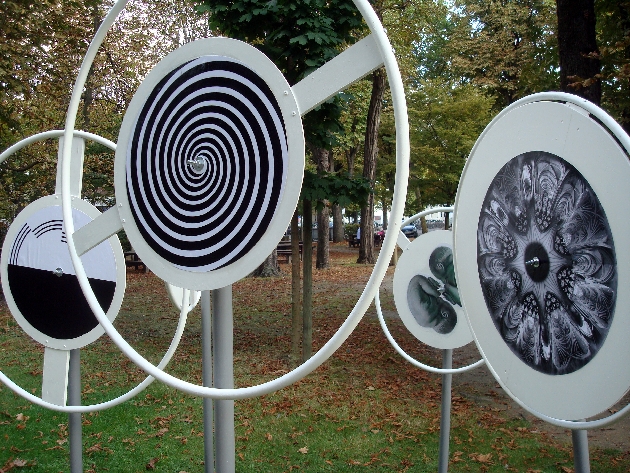







 *
* *
*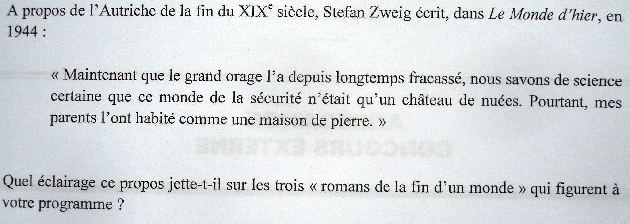
 photo Alina Reyes
photo Alina Reyes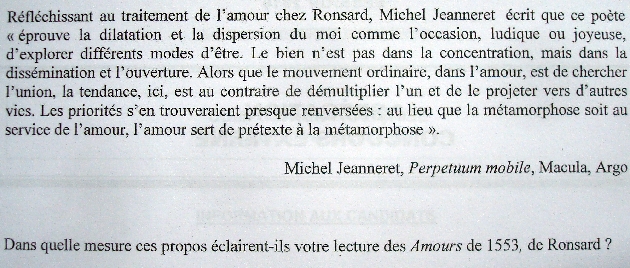 *
*