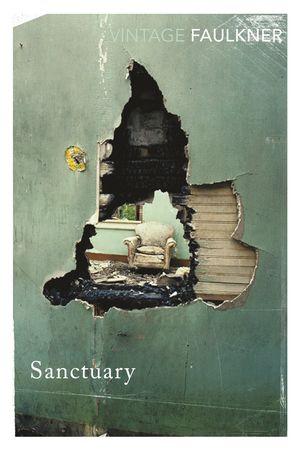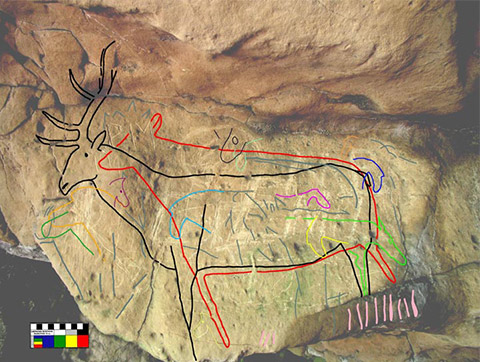La littérature en elle-même ne garantit pas un quelconque accomplissement. On peut lire, même beaucoup, et n’en rien apprendre. Macron déclarait récemment, avec son habituelle obtusion perverse et tyrannique, ne pas aimer les mauvais romans, lesquels, ajoutait-il, ne le détendaient pas. Si l’on croit que les romans servent à détendre, à faire passer agréablement le temps de cerveau disponible du lecteur, c’est qu’on lit en fait de mauvais romans (en effet publiés à cet usage), ou qu’on lit mal de bons romans (chargés d’une tout autre ambition). De fait, la politique toute mécanique et vaine de ce président fardé prouve assez que s’il lit, il lit très mal, à l’instar de son enseignante d’épouse maquillée comme un camion volé.
Mallarmé, du moins tel qu’il fut compris et divulgué par des Sartre, Barthes ou Blanchot, c’est-à-dire comme génocidaire de la littérature*, a effectivement trouvé sa fin dans le génocide de la littérature, tel qu’on peut le constater dans l’édition industrielle de livres à usage d’occupation des temps de cerveau disponibles, et aussi dans l’enseignement imposé aux futurs enseignants comme aux élèves*. Occuper les cerveaux, les saturer de communication, de publicité, de bavardage, de bluff, d’esbroufe, c’est s’aveugler et aveugler, et c’est faire la guerre à la liberté, faire la guerre à la littérature en soi, l’assassiner. Tuer la littérature, c’est tuer l’humain, tuer la vie animale de l’humain, au beau sens premier d’animal : du souffle, de la vie, de l’âme.
Il y a toujours quelques éditeurs et quelques professeurs exigeants, consciencieux et judicieux. Mais même dans des institutions prestigieuses comme la Sorbonne ou le Collège de France, certains cours (pas tous) ressemblent à un interminable et mortel bavardage, ne laissant au bout d’une heure qu’un rien de savoir et de sens qui eût pu être livré en une minute, en littérature et pire – car c’est là une discipline encore trop rare – en littérature comparée. Que doit être un cours de littérature ou de littérature comparée, depuis le collège – voire depuis les classes de primaire ou même avant, car, comme pour la philosophie ou les mathématiques, il n’est jamais trop tôt pour s’initier à la littérature – jusqu’aux plus hauts niveaux d’étude ? Un cours qui doit porter à la fois du savoir et du sens. Mais du savoir et du sens réellement sérieux et pertinents, articulés justement, sur le fond autant que sur la forme (alors que l’enseignement actuel s’acharne sur la forme, réduite à faire écran sur le fond, qu’on occulte).
Certains cours peuvent apporter essentiellement des savoirs. Des savoirs solides et profonds, mis en perspective, donnent des armes capitales pour la pensée. D’autres cours, tout en s’appuyant sur des savoirs, peuvent essentiellement interroger la littérature ou les textes en eux-mêmes, et cette interrogation sur le sens ouvre de vastes champs de pensée. Le but d’un cours de littérature doit être de révéler son importance, sa capacité, les armes secrètes, comme dit Cortazar, qu’elle contient et que nous pouvons incorporer pour vivre en humains animés et voyants plutôt qu’en mécaniques aux passions aveugles. Car ce n’est pas la technologie qui nous prend notre âme, c’est le manque de poésie, de pensée, de littérature vivante. La seule machine que nous ayons à combattre est la machine-en-nous. Y compris la machine à penser, aux rouages tout faits, qui tourne absurdement, comme passe-temps de vies où l’être ne s’atteint jamais.
* « Mallarmé, quelle ordure ! » m’exclamai-je il y a quelques années en un cri du cœur qui n’était évidemment pas à prendre à la lettre. Voir l’excellent cours de Bertrand Marchal sur Mallarmé et les fins de la littérature, la semaine dernière au Collège de France, ici en vidéo.
* Voir ma note sur l’enseignement de la littérature comme génocide de la littérature, ici.
*