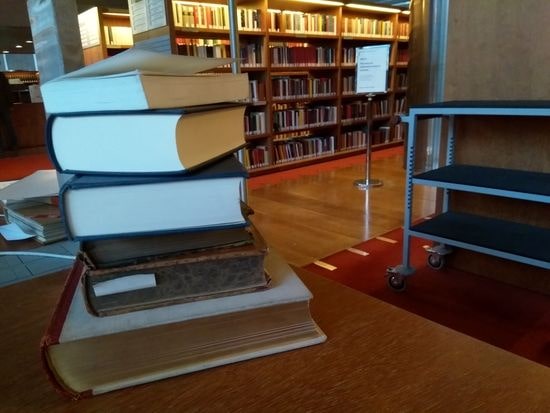 Aujourd’hui à ma table au rez-de-forêt de la BnF. Quelle merveille de pouvoir se faire apporter n’importe quel livre quand on a soudain envie, au cours du travail, de le consulter. Je m’y rends sur Turquoise, ma monture (mon vélo) et y passe des journées entières.
Aujourd’hui à ma table au rez-de-forêt de la BnF. Quelle merveille de pouvoir se faire apporter n’importe quel livre quand on a soudain envie, au cours du travail, de le consulter. Je m’y rends sur Turquoise, ma monture (mon vélo) et y passe des journées entières.
*
Voici des passages de la très belle préface du grand Armel Guerne à sa traduction de Moby Dick – j’ai photographié la page, je la recopie ici, avec une pensée pour les chercheurs d’avant notre technologie, comme Marcel Schwob par exemple, qui devaient recopier à la main toutes les pages qu’ils voulaient conserver des livres consultés à la bibliothèque. N’importe, quand on aime, on ne compte pas son temps.
*
« Laissons là la littérature. Expliquer l’homme par l’œuvre ou l’œuvre par l’homme, dès qu’il ne s’agit plus d’un simple littérateur, n’offre pas le plus petit semblant d’intérêt s’il s’agit de pénétrer l’un ou l’autre. L’homme et l’œuvre vivent ensemble, pour les mêmes raisons, sous les mêmes astres, et ils sont l’un et l’autre de sanglants et douloureux miroirs où se reflète différemment la même chose. La vie, comme l’œuvre, d’un authentique poète (non pas un « créateur », ainsi qu’on se plaît à dire, mais un « obéissant », un perpétuel conquérant spirituel à son corps défendant) est quelque chose sans loisir, un combat de tous les instants, un inimaginable duel à mort, sans repos de nuit, sans répit de jour, que ne comprennent absolument pas ceux qui ont du temps à perdre ici-bas – c’est-à-dire presque tous les hommes – ni et surtout ses plus proches témoins. Car les faits ne sont rien, je le répète, rien que des occasions apparemment visibles entre toutes les occasions manifestement invisibles et d’autant plus invitantes, d’autant plus importantes ; ce qui compte, ce sont les signes et le dessin que dessinent ces signes dans l’ordre où ils se sont présentés, lesquels restent toujours encore à découvrir, à inventer. »
Puis, à propos des folles aventures en mer et dans le monde du jeune Melville, qui, notons-le, ont précédé son œuvre comme celles de Rimbaud ont succédé à son œuvre, Guerne écrit :
« Latitudes, horizons, mondes et univers, terres et cieux – humanités prodigieuses… Comme à tous ceux qui ne traînent pas lamentablement derrière leur propre vie, mais qui portent en eux ce feu dévorant et sacré, on est frappé ici de la rapidité fabuleuse, du nombre et de la profondeur inimaginables de ces « expériences ». L’esprit est prompt, on ne le dira jamais assez. Le génie, de même. Et l’on fera mieux de ne pas trop prendre Herman Melville pour un voyageur. Ce voyage, il l’a habité à peu près comme un météore. Il y a mis autant de temps qu’il en a fallu à Rimbaud pour visiter le paysage de son génie. »
*

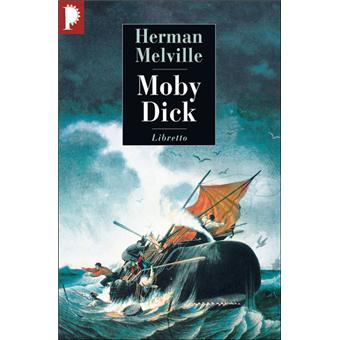
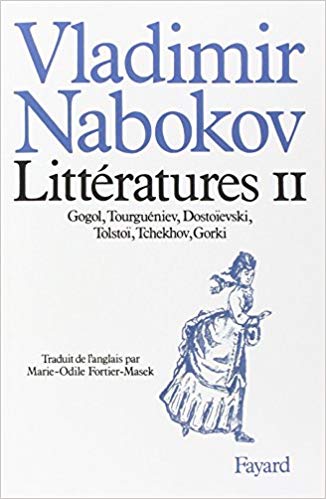



 Écoutant George Steiner parler de la présence d’Héraclite chez René Char et notamment dans Fureur et mystère, je songe que le serpent de son poème « À la santé du serpent », que je perçois comme foudre et pythie-python delphique héraclitéennes, peut aussi évoquer le serpent de la santé, celui qui figure en double sur le caducée d’Hermès. Il se peut évidemment que Char ait aussi pensé pour son titre au serpent biblique, mais,
Écoutant George Steiner parler de la présence d’Héraclite chez René Char et notamment dans Fureur et mystère, je songe que le serpent de son poème « À la santé du serpent », que je perçois comme foudre et pythie-python delphique héraclitéennes, peut aussi évoquer le serpent de la santé, celui qui figure en double sur le caducée d’Hermès. Il se peut évidemment que Char ait aussi pensé pour son titre au serpent biblique, mais, 
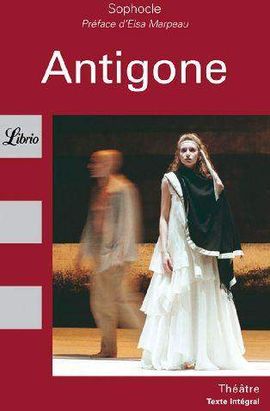 Interroger la déesse Minerve à propos d’Antigone est bienvenu, dans la mesure où Minerve-Athéna est la déesse de l’intelligence, de la pensée (avec son attribut, la chouette aux grands yeux) et une déesse éminemment politique, comme déesse de la stratégie militaire, des sciences, des techniques et des arts (avec son autre attribut, l’olivier, symbole de force, d’immortalité, de victoire). Lectrice récurrente tout à la fois d’Antigone, sur laquelle j’ai donné
Interroger la déesse Minerve à propos d’Antigone est bienvenu, dans la mesure où Minerve-Athéna est la déesse de l’intelligence, de la pensée (avec son attribut, la chouette aux grands yeux) et une déesse éminemment politique, comme déesse de la stratégie militaire, des sciences, des techniques et des arts (avec son autre attribut, l’olivier, symbole de force, d’immortalité, de victoire). Lectrice récurrente tout à la fois d’Antigone, sur laquelle j’ai donné 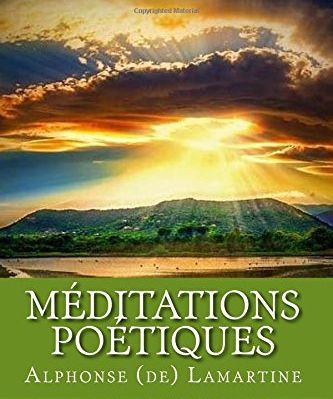


 Sur l’une des plages de Chora Sfakion, j’ai marché et marché dans l’eau, le ressac
Sur l’une des plages de Chora Sfakion, j’ai marché et marché dans l’eau, le ressac Le village, vu d’une autre des ses plages
Le village, vu d’une autre des ses plages Le port
Le port
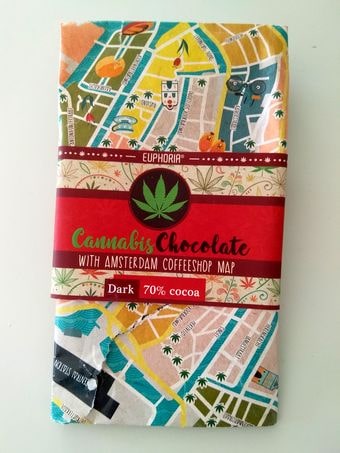 J’ai mangé tout le chocolat au cannabis acheté à La Canée. Chocolat sans THC, juste pour le plaisir de savoir qu’on profite des bienfaits du cannabis – le cannabis thérapeutique est autorisé en Grèce :-)
J’ai mangé tout le chocolat au cannabis acheté à La Canée. Chocolat sans THC, juste pour le plaisir de savoir qu’on profite des bienfaits du cannabis – le cannabis thérapeutique est autorisé en Grèce :-) En chemin vers la plage d’Ilingas, cet oratoire dédié à une jeune femme médecin morte. À l’intérieur, des lampes à huile brûlent doucement.
En chemin vers la plage d’Ilingas, cet oratoire dédié à une jeune femme médecin morte. À l’intérieur, des lampes à huile brûlent doucement.
 Et voici le poème de Cavafy, traduit plus haut, écrit à la main sur le muret. Tellement beau !
Et voici le poème de Cavafy, traduit plus haut, écrit à la main sur le muret. Tellement beau ! Sur la plage j’ai ramassé neuf beaux galets et j’en ai fait deux
Sur la plage j’ai ramassé neuf beaux galets et j’en ai fait deux 
 En revenant j’ai encore admiré l’agilité des nombreuses chèvres et de leurs chevreaux dans les parois rocheuses
En revenant j’ai encore admiré l’agilité des nombreuses chèvres et de leurs chevreaux dans les parois rocheuses 
 Je complèterai prochainement cette note avec les photos que O a faites dans les montagnes, jusqu’à hauteur de la neige ! autour de Chora Sfakion
Je complèterai prochainement cette note avec les photos que O a faites dans les montagnes, jusqu’à hauteur de la neige ! autour de Chora Sfakion Ces jours-ci en Crète, photos Alina Reyes
Ces jours-ci en Crète, photos Alina Reyes