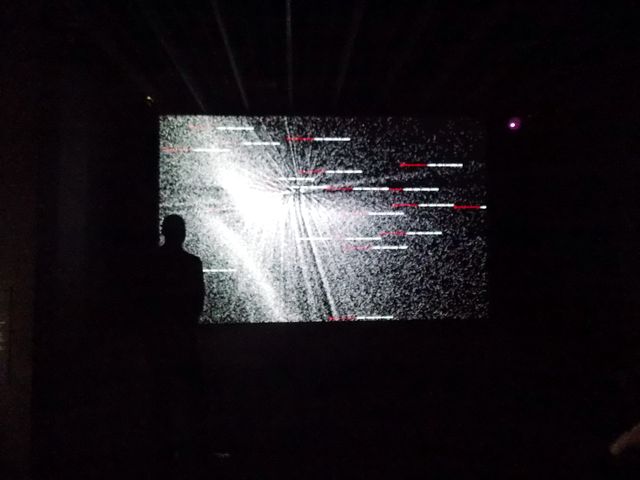*
« … ce sont les points de vue féconds qui sont, dans notre art, les plus puissants outils de découverte – ou plutôt, ce ne sont pas des outils, mais ce sont les yeux même du chercheur qui, passionnément, veut connaître la nature des choses mathématiques.
Ainsi, le point de vue fécond n’est autre que cet « œil » qui à la fois nous fait découvrir, et nous fait reconnaître l’unité dans la multiplicité de ce qui est découvert. Et cette unité est véritablement la vie même et le souffle qui relie et anime ces choses multiples.
Mais comme son nom même le suggère, un « point de vue » en lui-même reste parcellaire. Il nous révèle un des aspects d’un paysage ou d’un panorama, parmi une multiplicité d’autres également valables, également « réels ». C’est dans la mesure où se conjuguent les points de vue complémentaires d’une même réalité, où se multiplient nos « yeux », que le regard pénètre plus avant dans la connaissance des choses. Plus la réalité que nous désirons connaître est riche et complexe, et plus aussi il est important de disposer de plusieurs « yeux » pour l’appréhender dans toute son ampleur et dans toute sa finesse.
Et il arrive, parfois, qu’un faisceau de points de vue convergents sur un même et vaste paysage, par la vertu de cela en nous apte à saisir l’Un à travers le multiple, donne corps à une chose nouvelle ; à une chose qui dépasse chacune des perspectives partielles, de la même façon qu’un être vivant dépasse chacun de ses membres et de ses organes. Cette chose nouvelle, on peut l’appeler une vision. La vision unit les points de vue déjà connus qui l’incarnent, et elle nous en révèle d’autres jusque là ignorés, tout comme le point de vue fécond fait découvrir et appréhender comme partie d’un même Tout, une multiplicité de questions, de notions et d’énoncés nouveaux.
Pour le dire autrement : la vision est aux points de vue dont elle paraît issue et qu’elle unit, comme la claire et chaude lumière du jour est aux différentes composantes du spectre solaire. Une vision vaste et profonde est comme une source inépuisable, faite pour inspirer et pour éclairer le travail non seulement de celui en qui elle est née un jour et qui s’est fait son serviteur, mais celui de générations, fascinés peut-être (comme il le fut lui-même) par ces lointaines limites qu’elle nous fait entrevoir…

(…)
Il est pourtant des points de vue qui sont plus vastes que d’autres, et qui à eux seuls suscitent et englobent une multitude de points de vue partiels, dans une multitude de situations particulières différentes. Un tel point de vue peut être appelé aussi, à juste titre, une « grande idée ». Par la fécondité qui est sienne, une telle idée donne naissance à une grouillante progéniture, d’idées qui toutes héritent de sa fécondité, mais dont la plupart (sinon toutes) sont de portée moins vaste que l’idée-mère.
Quant à exprimer une grande idée, « la dire » donc, c’est là, le plus souvent, une chose presque aussi délicate que sa conception même et sa lente gestation dans celui qui l’a conçue – ou pour mieux dire, ce laborieux travail de gestation et de formation n’est autre justement que celui qui « exprime » l’idée : le travail qui consiste à la dégager patiemment, jour après jour, des voiles de brumes qui l’entourent à sa naissance, pour arriver peu à peu à lui donner forme tangible, en un tableau qui s’enrichit, s’affermit et s’affine au fil des semaines, des mois et des années. Nommer simplement l’idée, par quelque formule frappante, ou par des mots-clef plus ou moins techniques, peut être affaire de quelques lignes, voire de quelques pages – mais rares seront ceux qui, sans déjà bien la connaître, sauront entendre ce « nom » et y reconnaître un visage. Et quand l’idée est arrivée à s’imposer d’elle-même avec la force de l’évidence, pendant des générations, voire, pendant des millénaires… en pleine maturité, cent pages peut-être suffiront à l’exprimer, à la pleine satisfaction de l’ouvrier en qui elle était née – comme il se peut aussi que dix mille pages, longuement travaillées et pesées, n’y suffiront pas.
Et dans l’un comme l’autre cas, parmi ceux qui, pour la faire leur, ont pris connaissance du travail qui enfin présente l’idée en plein essor, telle une spacieuse futaie qui aurait poussé là sur une lande déserte – il y a fort à parier que nombreux seront ceux qui verront bien tous ces arbres vigoureux et sveltes et qui en auront l’usage (qui pour y grimper, qui pour en tirer poutres et planches, et tel autre encore pour faire flamber les feux dans sa cheminette…), mais rares seront ceux qui auront su voir la forêt…
Alexandre Grothendieck, Récoltes et semailles
Ce matin, dans une salle d’attente, j’ai lu Grothendieck sur mon téléphone, puis j’ai arpenté longuement les couloirs souterrains de l’hôpital ; cet après-midi je suis retournée avec un rare bonheur à l’Institut de Paléontologie Humaine. C’est un lieu saint, comme mon temple de tous les jours, le jardin des Plantes et son Museum, lieu de recherche et de science.
*

 à l’Institut de Paléontologie Humaine, puis dans la rue, photos Alina Reyes
à l’Institut de Paléontologie Humaine, puis dans la rue, photos Alina Reyes
*


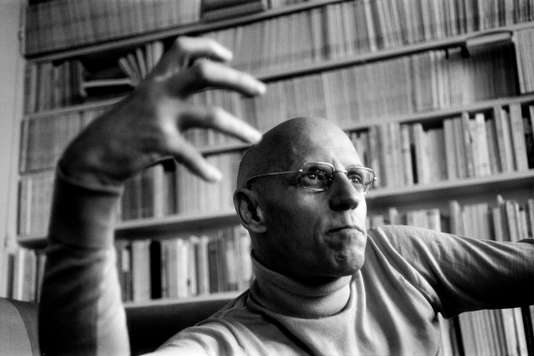










 ces jours-ci au jardin des Plantes à Paris, photos Alina Reyes
ces jours-ci au jardin des Plantes à Paris, photos Alina Reyes


 ces jours-ci à Paris, photos Alina Reyes
ces jours-ci à Paris, photos Alina Reyes


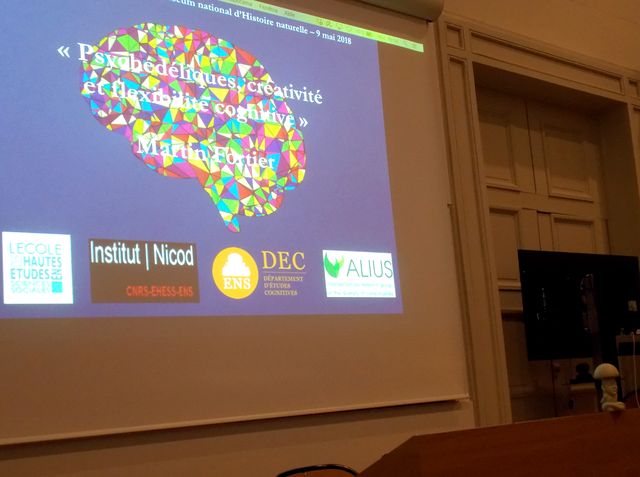

 aujourd’hui au Jardin des Plantes, photos Alina Reyes
aujourd’hui au Jardin des Plantes, photos Alina Reyes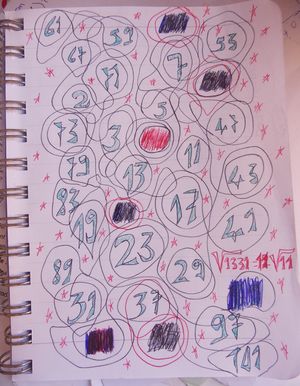
 Giorgio Agamben, en veste et pull sombres, cet après-midi à l’école supérieure de chimie, de 14 heures à 18 heures passées, photo Alina Reyes
Giorgio Agamben, en veste et pull sombres, cet après-midi à l’école supérieure de chimie, de 14 heures à 18 heures passées, photo Alina Reyes