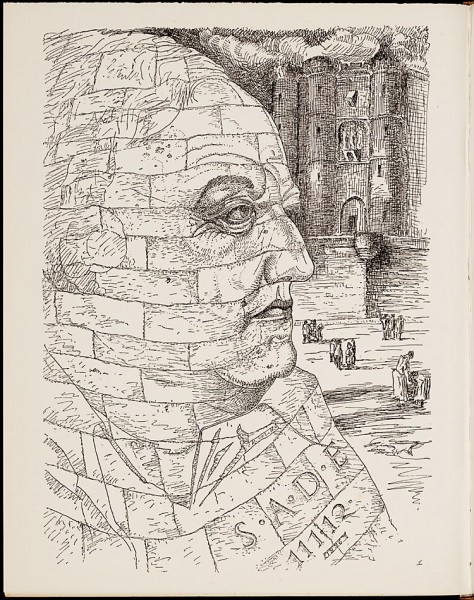ce midi, de l'entrée de Bayard, à Montrouge. Photo Alina Reyes
Un tireur à casque intégral tue des soldats maghrébins, des enfants et un professeur juifs, blesse un lycéen noir.
« Le nihilisme est bien plutôt, écrit Heidegger en commentant Le mot de Nietzsche « Dieu est mort », pensé en son essence, le mouvement fondamental de l’Histoire de l’Occident. Il manifeste une telle importance de profondeur que son déploiement ne saurait entraîner autre chose que des catastrophes mondiales. Le nihilisme est, dans l’histoire du monde, le mouvement qui précipite les peuples de la terre dans la sphère de puissance des Temps Modernes. »
« Dieu est mort ». La parole de Nietzsche, montre Heidegger, est intimement liée au mot valeur. Le nihilisme est selon lui un processus historique, interprété comme « la dévalorisation des valeurs jusqu’alors suprêmes. » Et la valeur est question de regard. Elle est « posée par une visée, par un regard sur ce avec quoi il faut compter. »
La dévalorisation des valeurs s’accompagne de « l’enthousiasme pour le développement d’une culture, ou pour l’expansion de la civilisation. » À l’heure où le catholicisme européen se jette dans la gueule de l’hydre culture-et-civilisation, au jour où l’anti-islamisme, l’antisémitisme et le racisme reprennent obscènement du poil de la bête, cette méditation des Chemins qui ne mènent nulle part devrait éveiller les consciences. « Il ne suffit pas de se réclamer de sa foi chrétienne ou d’une quelconque conviction métaphysique pour être en dehors du nihilisme », rappelle le philosophe, qui note aussi cette évidence qu’il faut pourtant sans cesse rappeler : « Une vie non chrétienne peut bien adhérer au christianisme et s’en servir comme facteur de puissance, de même que, inversement, une vie chrétienne n’a pas nécessairement besoin du christianisme. »
En constatant le processus nihiliste à l’oeuvre dans la civilisation occidentale, régie par des principes métaphysiques, Nietzsche a voulu retourner la métaphysique par le renversement de ses valeurs. « Seulement, commente Heidegger, tout retournement de ce genre n’aboutit qu’à se laisser envelopper, en s’aveuglant soi-même, dans les filets du Même devenu méconnaissable. »
Le danger de Niezstche, c’est d’être interprété par des imbéciles ou des brutes, ignares ou savants. Qui pensent pouvoir pallier la « mort de Dieu » par la volonté de puissance, comprise au sens vulgaire comme volonté d’accroître son pouvoir, sa domination je dirais « charnelle », au sens où saint Paul entendait ce mot, c’est-à-dire mondain, et plus que cela, lié aux bassesses de l’âme. Heidegger montre qu’il s’agit bien sûr en vérité de tout autre chose. D’un chemin.
« La volonté doit jeter son regard dans un champ de visée, c’est-à-dire ouvrir un pareil champ, pour qu’à partir de là des possibilités puissent seulement se montrer, qui à leur tour montrent la voie à un accroissement de puissance. La volonté doit ainsi poser la condition de son vouloir aller au-delà d’elle-même. »
Les valeurs sont pour Nietzsche les moyens et les conditions de ce chemin, cet aller au-delà. Et nous en venons au fait : « En son essence, la volonté de puissance est la volonté qui pose les valeurs. » La volonté de puissance, c’est la vie vivant, et selon Nietzsche, « Vivant : cela signifie déjà « estimer ». » Et estimer, c’est « fixer la valeur ». La volonté de puissance bien comprise, c’est-à-dire à mon sens la vie vivant, réinstaure les valeurs suprêmes au lieu où elles se dégradent et aboutissent au nihilisme. Tel est à mon sens le nietzschéisme valable et vivable. Tant qu’il demeure un aller au-delà, sans retomber dans son désespérant et pour le coup nihiliste « Éternel Retour du Même ».
Le coup final du nihilisme, montre Heidegger, est « que le Dieu tenu pour réel soit érigé en valeur suprême », c’est-à-dire qu’au lieu de penser l’être, on « se drape dans l’apparence d’une pensée qui estime l’être comme valeur ». « Une faible lumière commence à se faire », poursuit-il, « sur cette question que nous voulions déjà adresser à Nietzsche lorsque nous écoutions les paroles du Forcené : Comment est possible cette chose que des hommes soient capables de tuer Dieu ? »
« Ce dernier coup » est celui « par lequel l’être est abattu au rang d’une simple valeur. »… « cet assassinat qui tue à la racine », dit encore Heidegger. Car « la vérité de l’être même » n’est pas pensée, « la vérité de l’être fait défaut ».
« Les voyous publics ont aboli la pensée et mis à sa place le bavardage, ce bavardage qui flaire le nihilisme partout où il sent son bavardage en danger. Cet aveuglement de soi face au véritable nihilisme, cet aveuglement qui ne cesse jamais de prendre le dessus, tente ainsi de se disculper lui-même de son angoisse devant la pensée. Mais cette angoisse est l’angoisse de l’angoisse. »
Et je songe aux paroles de Walter Benjamin dans Expérience et pauvreté : « l’expérience a subi une chute de valeur. Et il semble que sa chute se poursuive vers une profondeur sans fond. (…) Car jamais démenti plus radical n’a été infligé aux expériences que celui de l’expérience stratégique par la guerre de positions, de l’expérience économique par l’inflation, de l’expérience corporelle par le combat mécanique, de l’expérience morale par les détenteurs du pouvoir. Une génération qui était encore allée à l’école en tramways tirés par des chevaux, s’est retrouvée à découvert dans un paysage où rien n’était épargné par le changement, si ce n’est les nuages et, au beau milieu de tout cela, dans un champ de forces traversé de flux destructeurs et d’explosions, l’infime et frêle corps humain. »
Amen je vous le dis, le corps du Christ, Être en puissance et en vérité, est à réinventer, redécouvrir, réexpérimenter – non dans l’éternel retour mortifère, nihiliste, assassin, mais dans l’aller, toujours au-delà.