 Dans un couloir de la bibliothèque des chercheurs, où je travaille avec grand bonheur en ce moment, dans l’une ou l’autre de ses salles, en rez-de jardin de la BnF
Dans un couloir de la bibliothèque des chercheurs, où je travaille avec grand bonheur en ce moment, dans l’une ou l’autre de ses salles, en rez-de jardin de la BnF
*
« En écho à Mallarmé, mais en des termes manifestement empruntés à la tradition gnostique et kabbalistique, Benjamin fonde sa métaphysique de la traduction sur le concept d’une « langue universelle ». La traduction est à la fois possible et impossible selon une opposition dialectique propre au raisonnement ésotérique. Cette antinomie est due au fait que toutes les langues connues ne sont que des fragments dont les racines, au sens étymologique et algébrique, n’existent et de se justifient qu’à travers die reine Sprache. Cette « pure langue » – à d’autres moments Benjamin s’y réfère comme au « logos », qui apporte un sens au discours mais ne se retrouve dans aucune langue parlée individuelle – est comme un ressort caché qui cherche à se détendre dans les canaux ensablés de nos parlers divers. Lors de la « fin messianique de leur histoire » (autre formule kabbalistique ou hassidique), les langues divisées rejoindront leur commune source de vie. Dans l’intervalle, la traduction se voit confier d’immenses responsabilités philosophiques, éthiques et magiques.
La traduction d’une langue A dans une langue B concrétise l’implication d’une troisième présence active. Elle révèle la physionomie de la « pure langue » qui a précédé et qui sous-tend les deux langues. Une traduction authentique dégage les contours vagues mais reconnaissables du dessin cohérent dont, après Babel, se sont détachés les fragments torturés du langage humain. Certains des psaumes traduits par Luther, la Troisième Pythique de Pindare refondue par Hölderlin imposent, grâce au caractère étrange de leur évocation, la réalité de l’Ur-Sprache où se fondent, en quelque sorte, allemand et hébreu ou allemand et grec classique. Qu’une telle fusion est possible, qu’elle est nécessaire, est rendu évident par le fait que les humains veulent dire les mêmes choses, que leur voix sourd des mêmes espoirs et des mêmes angoisses, bien que les mots prononcés soient différents. Ou pour parler autrement : une mauvaise traduction ne manque pas d’énoncés apparemment semblables, mais c’est le ciment du sens qui lui échappe. La philologie est amour du Logos avant d’être science des racines. Luther et Hölderlin rapprochent sensiblement l’allemand de son point de départ universel. Mais, pour mener à bien cette alchimie, une traduction doit garder, par rapport à la langue visée, une étrangeté vitale, un côté « autre ». Il n’y a pas grand-chose dans l’Antigone de Hölderlin qui soit « pareil » à l’allemand ordinaire ; un rideau de barbelés acérés sépare les Fables de La Fontaine que nous donne Marianne Moore de l’américain parlé. Le traducteur enrichit sa langue en laissant la langue-source s’y insinuer et la modifier. Mais il fait bien plus : il étire son propre parler en direction de l’absolu secret de la signification. »
George Steiner, La bénédiction de Babel, trad. de l’anglais par Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauzat
Ce texte éclaire ce que j’essaie de faire dans mes traductions. Bien entendu un tel travail serait peu apprécié des universitaires et des éditeurs, qui veulent des traductions conformes à la langue cible. Alors que le travail dont parlent Benjamin et Steiner est un travail de poète œuvrant dans la profondeur des langues, de la langue.

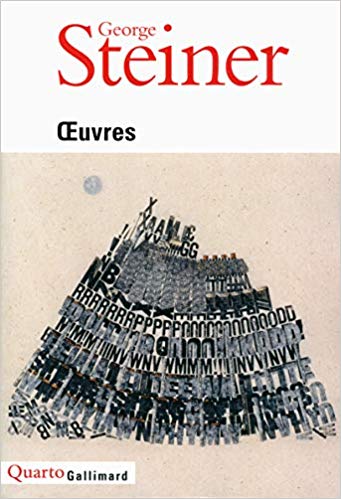





 aujourd’hui sous la pluie à Paris 5e, photos Alina Reyes
aujourd’hui sous la pluie à Paris 5e, photos Alina Reyes