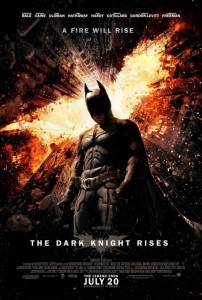Jardin des Plantes, photo Alina Reyes
Je m’assois sur le banc de bois du jardin alpin du Jardin des Plantes, sous le feuillage du vaste pendula. Une dame qui était assise à l’autre bout du banc se lève en laissant sur le siège un livre. Je l’appelle en le lui tendant. Elle se lance alors, debout devant moi, dans un long discours, que je ponctue essentiellement par des sourires, des hochements de tête et des mmh-mmh. Ce livre n’est pas à elle, me dit-elle, c’est un jeune homme qui l’a déposé là avant mon arrivée. Je me suis d’abord méfiée, dit-elle, à cause du titre, vous comprenez ? L’œil qui jouit. À cause de jouit, vous comprenez ? Elle le dit plusieurs fois, en ajoutant : mais non, c’est un livre très sérieux. Sur le cinéma. Tenez, ajoute-t-elle en lisant la quatrième de couverture, écrit par Jean-François Rauger, le responsable de la programmation de la Cinémathèque française, qui collabore régulièrement au journal Le Monde. Vous voyez ? Ils ont mis jouit parce que c’est ce qui intéresse les gens, vous comprenez ? Pour accrocher.
Elle est grande et un peu forte, vêtue d’un pantalon et d’un haut beiges, hantée et affable. Elle me dit qu’elle a plusieurs annuaires sur le cinéma chez elle, avec le nom des acteurs. À mesure qu’ils meurent, elle ajoute à leur notice la date de leur mort. Elle me raconte que son frère avait des photos de Marlon Brando prises sur un tournage dans les dunes du Touquet. Elle a oublié le nom du film, qui n’est pas connu, et celui de l’actrice. Je me souviens juste de Marlon Brando, dit-elle. Bien sûr, je comprends, dis-je. Elle me dit que son frère avait chez lui un tas de films et un grand projecteur de cette époque. Peut-être cela valait-il cher ? Maintenant il est mort et bah, c’est son autre frère qui s’est occupé de tout ça, sûrement il a tout jeté. Elle me dit qu’elle allait dans les festivals de cinéma, Deauville, Cannes (une fois, en 87), Cabourg… Elle me recommande ce dernier, car c’est un festival du film romantique. Avant de continuer son chemin, elle m’invite avec insistance à emporter le livre. Je le feuillette en essayant d’y trouver une phrase intéressante à citer. La voici, elle est de Guy Debord, à propos de Paris : « c’était une ville si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n’importe où ailleurs. »
Oui mais seuls les yeux de pauvres peuvent voir réellement la beauté, où qu’elle soit et n’importe où.
*