Dans son dernier livre Yann Moix raconte que son père l’obligea à manger ses excréments en public (d’après Marie-Claire, le magazine féminin qui, gobant tout, s’émerveille de la résilience de l’auteur, auquel elle avait déjà ouvert ses colonnes pour l’y faire vanter sa consommation en série de jeunes Asiatiques – alors qu’il s’était déclaré ailleurs « prédateur sexuel », traitant les femmes de « réceptacles à jouissance, d’orifices à contentement, de cargaisons qu’on pelote »). Eh bien l’y voici, en train de manger sa merde en public, et qui l’y contraint ? La vérité, qui finit toujours par se faire jour, y compris en utilisant ceux-là même qui veulent la cacher. Voilà que toute la merde de Yann Moix s’étale dans l’espace public, comme il ne croyait pas si bien dire, pour une fois (les gens, y compris l’immense majorité de ceux qui publient des livres, ignorent le pouvoir des mots).
Voilà que ses amis d’extrême-droite, pas si anciens puisqu’il les fréquentait encore au moins jusqu’en 2013 voire 2016 (où il est photographié en compagnie de Frédéric Chatillon, ex-membre du GUD, violemment antisémite, proche de Marine Le Pen), préfaçait en 2007 le livre antisémite de Blanrue publié par Soral, etc., ravis de lui faire payer sa duplicité – le cœur facho, le porte-monnaie dans la bien-pensance – ressortent les dossiers. Déballage en ligne et ailleurs (Dieudonné annonce qu’il va raconter à la presse les relations de Moix avec lui et la bande des antisémites mondains), la révélation se poursuit.
En fait personne n’est vraiment étonné : soit les gens savaient, soit ils ne savaient pas mais l’attitude sadique de Yann Moix chroniqueur avait suffi à leur faire comprendre quel genre de personne il était. Le plus grave est que le milieu de l’édition et des médias l’aient soutenu et continuent, à part L’Express qui a sorti les documents sur sa production négationniste, à essayer de minimiser l’affaire. Plus ou moins inconsciemment. Exactement comme l’Église l’a fait face aux affaires de pédophilie. Parce que c’est dans leur culture. L’extrême-droite et l’antisémitisme sont dans la culture des milieux de l’édition et des médias comme la pédophilie est dans celle de l’Église.
Considérons déjà tout simplement le soutien inconditionnel de BHL, Moix et d’autres à Israël : c’est un soutien à un régime d’extrême-droite. Rappelons que BHL rejoignit Sollers et Gluksmann à l’Internationale de la résistance, une officine créée en 1983 et financée par les services secrets américains, utilisée pour de sales besognes politiques en Amérique Latine, soutenant notamment les milices du dictateur d’extrême droite Somoza. Rappelons qu’Antoine Gallimard, héritier d’une maison d’édition qui se sauva en collaborant avec les nazis, veut maintenant rééditer les pamphlets antisémites de Céline. Sachons que Paul-Eric Blanrue, le grand ami antisémite et négationniste de Yann Moix, raconte que ce dernier lui affirma que Sollers, éditeur chez Gallimard, pourrait vouloir publier un portrait élogieux du négationniste Faurisson – comme quoi Moix n’a pas encore appris à connaître ceux à qui il fait allégeance : Sollers est beaucoup trop prudent, pour ne pas dire pleutre, pour exposer lui-même ses inavouables pensées ; il le fait faire par d’autres, dans des livres ou des articles (comme celui où Savigneau dit dans le Monde des Livres, à propos du livre que Zagdanski et moi avons écrit : « prends le fric et tire-toi », formule dans laquelle Zagdanski reconnut une insulte antisémite).
Moix n’est que la face cachée de ce milieu de l’en-même-temps à la Macron, dans lequel Macron ferait d’ailleurs figure d’enfant de chœur. En même temps humaniste et fasciste, ou plus exactement humaniste par façade, salopard dans l’esprit et les actes – qui plus est hypocritement, lâchement. Sa face cachée politique, mais aussi littéraire : ce milieu est aussi celui de la mauvaise littérature, fabriquée et vendue industriellement, comme ses auteurs vendus.
Voir aussi : « Yann Moix : une obsession antisémite qui vient de loin »
Attendons maintenant de voir comment vont se comporter les médias, s’ils vont continuer à promouvoir, via Yann Moix, cette infection mondaine.
*



 *
*

 *
*
 *
*
 *
*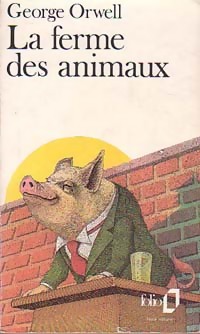

 *
* Ce matin à Paris, photos Alina Reyes
Ce matin à Paris, photos Alina Reyes