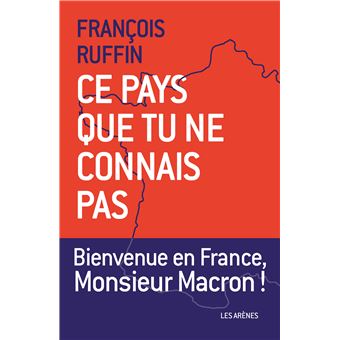 Ruffin vs Macron, c’est Dettinger vs la Police. Un humain vs l’incarnation d’un système. Puisqu’il a écrit son livre en s’adressant à Macron comme le boxeur s’est adressé aux forces de l’ordre, en homme, c’est dans ce rapport aussi que nous le lirons, par d’autres voies que la sienne, qu’il est inutile de répéter. Le christianisme de Ruffin vs celui de Macron, puisque, sans jamais être mentionné, il est souterrainement omniprésent dans l’existence de Ruffin comme dans la posture de Macron. L’art littéraire de Ruffin vs le néant littéraire de Macron, puisque la littérature est une préoccupation des deux hommes, le premier en faisant sans chercher à en faire, le second cherchant à en faire et s’en avérant incapable. Et le travail politique de Ruffin vs la manipulation politique de Macron illustrées par ces deux sortes d’implication ou côtoiement existentiels.
Ruffin vs Macron, c’est Dettinger vs la Police. Un humain vs l’incarnation d’un système. Puisqu’il a écrit son livre en s’adressant à Macron comme le boxeur s’est adressé aux forces de l’ordre, en homme, c’est dans ce rapport aussi que nous le lirons, par d’autres voies que la sienne, qu’il est inutile de répéter. Le christianisme de Ruffin vs celui de Macron, puisque, sans jamais être mentionné, il est souterrainement omniprésent dans l’existence de Ruffin comme dans la posture de Macron. L’art littéraire de Ruffin vs le néant littéraire de Macron, puisque la littérature est une préoccupation des deux hommes, le premier en faisant sans chercher à en faire, le second cherchant à en faire et s’en avérant incapable. Et le travail politique de Ruffin vs la manipulation politique de Macron illustrées par ces deux sortes d’implication ou côtoiement existentiels.
Le livre de Ruffin, Ce pays que tu ne connais pas (Les Arènes, 2019), est aussi vif, tendu, humain, bon à lire, que celui de Macron, Révolution (XO, 2016) est lourd, mou, insignifiant, illisible – le choix des éditeurs est en lui-même parlant : pour Ruffin l’éditeur de Denis Robert, pour Macron celui de Guillaume Musso. Comme on sait, Ruffin et Macron furent tous deux élèves, à deux ans d’écart, au lycée La Providence à Amiens. L’éducation religieuse qu’ils y ont reçue est peut-être le seul vrai point commun entre les deux hommes. Macron a surtout gardé du jésuitisme la brillance fourbe, Ruffin le caractère missionnaire. Sans mentionner cette formation, Ruffin l’incarne quand il oppose « le désir de s’élever » de Macron à son propre désir, « presque de descendre ». Macron désire être divinisé en dominant, Ruffin obtient son salut en descendant parmi le peuple : « Je me sauve par les autres ». Si Macron vient de se faire photographier un genou à terre devant une tente de SDF, n’était-ce pas, en réponse à Ruffin, pour se donner aussi le rôle d’un dieu qui s’abaisse, selon le dogme chrétien ? Encore une fois, Macron est dans la posture et l’imposture (puisqu’il a en fait réduit considérablement le budget consacré aux personnes sans abri), quand Ruffin, lui, est dans le réel, comme en témoignent son œuvre et les portraits sensibles d’humains qu’elle porte.
Du livre de Macron, que j’ai lu il y a peu, je n’ai rien trouvé à dire, tant il se résume à néant, dans sa forme comme dans son fond. Aucun style, aucune vie. Même les premières pages, où il évoque son enfance et sa proximité avec sa grand-mère, sont dénuées de toute chair, sentant à plein nez la pose, la volonté de singer les auteurs lyriques à la recherche de leur passé, cela sans parvenir un instant à faire vibrer la moindre corde, qu’en vérité il ne touche jamais, se contentant de simuler la chose. Le reste du livre est un exposé à prétention politique sans queue ni tête, boulgui-boulga d’ « en même temps » qui promet tout et son contraire et dont il n’est pas difficile de comprendre que rien de cette prétendue Révolution ne se tient ni ne sera tenu, sinon peut-être le pire, rôdant à chaque coin de phrase, comme celles-ci, qui par antiphrase ou directement empestent la tentation fasciste : « Je crois profondément dans la démocratie et la vitalité du rapport au peuple », et : « L’armée ne peut être qu’un ultime recours ».
Dans Ce pays que tu ne connais pas, Ruffin égrène les innombrables soutiens que Macron est allé chercher parmi les faiseurs d’argent à tout prix, « comme une prostituée » selon ses propres mots (oui, les mots de Macron parlant de lui-même), au cours des années pour se faire et arriver. Il raconte aussi un épisode où, instinctivement, il lui a sauvé la mise, lors de la rencontre sur un parking avec les Whirlpool. Dans la bousculade,
« La haine, autour, s’aiguisait. Comme un con, alors, comme un con comme un con, j’ai cherché un mégaphone, qu’on vous le porte, mais vous saviez pas le tenir, pas gueuler dedans, votre voix ne portait pas, les salariés s’énervaient : « Qu’il foute le camp ! Qu’il arrête son cirque ! » Avec Patrice, Patrice Sinoquet, on a gambergé vite fait, on a proposé ça : « Les Whirlpool, et Monsieur Macron, vous passez la barrière, et les journalistes vous restez ici ». Votre équipe a approuvé et ça s’est passé comme ça. Ça s’est calmé comme ça.
Vous mesurez le paradoxe ? Ce sont vos deux opposants les plus résolus qui, ce jour-là, peut-être, vous ont sauvé la mise. Moi, bon, mon CV, vous le connaissez. Mais Patrice Sinoquet, délégué CFDT, certes, mais militant frontiste aussi, un historique, tendance Jean-Marie. La vie est étrange, non ? Car nous vous avons bel et bien épargné, sinon la violence et les coups, le goudron et les plumes, du moins les cris, les crachats, les jets de canettes, les « Macron dégage ! » qui auraient plombé votre image, qui auraient signé le divorce, définitif, d’emblée, avant même le scrutin, entre vous et cette France en souffrance. »
Comme un con, oui. C’est ainsi que nous sommes trop souvent, face à ce genre de personnes. Face à tous les Macrons, avec leur morgue et leur fausseté qui incitent à la haine, mais aussi leur inaptitude totale. Inaptitude à la vie. Leur manque d’être. Et leur insatiable besoin de protection pour pouvoir se maintenir en ce monde. Comme des cons nous tombons dans la compassion. Parce que, contrairement à eux qui ne voient en autrui que des instruments pour leur propre satisfaction, nous sommes humains, nous participons de l’humaine condition – comme l’exprime, tout du long, le livre de François Ruffin, tout habité de l’humanité des personnes qu’il raconte, et de sa propre humanité, avec ses faiblesses et ses fiertés, exposées dans la vie comme dans l’écriture, sans protections. Et au fond, nous avons pitié de ce Macron qui ne peut survivre sans ses protections accumulées, sa femme, son garde du corps, ses milliardaires, ses chefs d’entreprise pollueurs et tueurs, ses ministres imbéciles, ses militants téléguidés par sms, ses médias achetés, sa police, son armée… Combien de temps, encore ?
Finalement la meilleure question que Ruffin pose à Macron dans ce livre est celle de son œuvre. Où est la grande œuvre que, plus jeune, Macron se vantait d’être en train d’écrire ? Elle n’est jamais venue au monde, ni sous la forme d’un livre ni sous une autre forme. Car en littérature comme en politique et dans la vie, Macron n’existe que dans l’illusion, en illusionnant les autres et en s’illusionnant lui-même. Ruffin a des livres, des films et un journal à son actif. De bons livres, de bons films, un bon journal. Il a des enfants, il a des combats, une vie d’homme libre, jamais inféodé, assumant sa fragilité sans pour autant avoir besoin de la protection de puissants. Et une activité politique fondée sur des relations et des actions concrètes avec les gens et en direction des gens. « Les intellectuels du futur agiront-ils en compagnons de route de nouveaux mouvements sociaux désireux de changer la réalité existante ? », se demandait Shlomo Sand dans La fin de l’intellectuel français ? Et : « Par quelle philosophie politique ces luttes seront-elles interprétées et accompagnées ? »
J’estime que Ruffin donne l’une des réponses possibles capitales à cette question. Son livre, très différent de la production habituelle des intellectuels avec son implication du « je », avec son ton libre, ses récits qui portent la réflexion et portent à la réflexion sans dogmatisme, son caractère habité franchement, sans tour de passe-passe, sans cet illusionnisme propre à tous les macronismes et aussi à tous les fascismes, tel un coup de poing dans un bouclier illustre une autre façon de penser : non pas au-dessus du peuple, en intellectuel surplombant (et envoyant les autres au casse-pipe), mais en travailleur intellectuel faisant son travail comme le fait un travailleur boulanger ou un travailleur ingénieur, honnêtement, courageusement, sans chercher à y gagner plus qu’un homme n’a à gagner : sa vie, et celle des gens qu’il aime. Or Ruffin aime les gens.
*


 Hier à Paris 5e et 13e, photos Alina Reyes
Hier à Paris 5e et 13e, photos Alina Reyes

 Ce matin au lever, photo Alina Reyes
Ce matin au lever, photo Alina Reyes



 Hier au jardin des Plantes, photos Alina Reyes
Hier au jardin des Plantes, photos Alina Reyes
 *
*

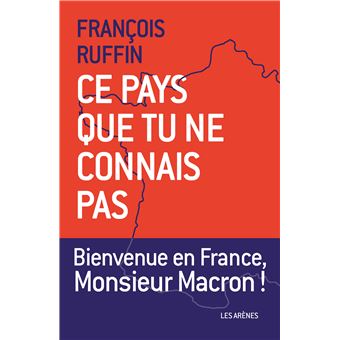 Ruffin vs Macron, c’est Dettinger vs la Police. Un humain vs l’incarnation d’un système. Puisqu’il a écrit son livre en s’adressant à Macron comme le boxeur s’est adressé aux forces de l’ordre, en homme, c’est dans ce rapport aussi que nous le lirons, par d’autres voies que la sienne, qu’il est inutile de répéter. Le christianisme de Ruffin vs celui de Macron, puisque, sans jamais être mentionné, il est souterrainement omniprésent dans l’existence de Ruffin comme dans la posture de Macron. L’art littéraire de Ruffin vs le néant littéraire de Macron, puisque la littérature est une préoccupation des deux hommes, le premier en faisant sans chercher à en faire, le second cherchant à en faire et s’en avérant incapable. Et le travail politique de Ruffin vs la manipulation politique de Macron illustrées par ces deux sortes d’implication ou côtoiement existentiels.
Ruffin vs Macron, c’est Dettinger vs la Police. Un humain vs l’incarnation d’un système. Puisqu’il a écrit son livre en s’adressant à Macron comme le boxeur s’est adressé aux forces de l’ordre, en homme, c’est dans ce rapport aussi que nous le lirons, par d’autres voies que la sienne, qu’il est inutile de répéter. Le christianisme de Ruffin vs celui de Macron, puisque, sans jamais être mentionné, il est souterrainement omniprésent dans l’existence de Ruffin comme dans la posture de Macron. L’art littéraire de Ruffin vs le néant littéraire de Macron, puisque la littérature est une préoccupation des deux hommes, le premier en faisant sans chercher à en faire, le second cherchant à en faire et s’en avérant incapable. Et le travail politique de Ruffin vs la manipulation politique de Macron illustrées par ces deux sortes d’implication ou côtoiement existentiels.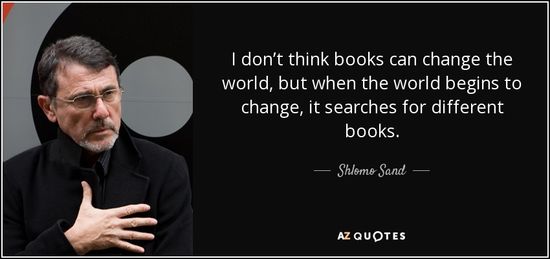
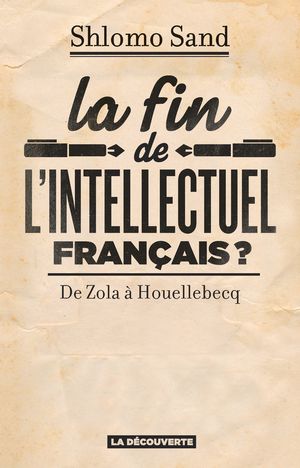 Sand montre que la figure de l’intellectuel français, intervenant dans la sphère publique et politique, tel que nous l’avons connue jusqu’à des temps récents, et telle qu’elle est en train de disparaître (notamment avec l’islamophobie, le décadentisme et le défaut de pensée colportés par Houellebecq, Charlie Hebdo d’avant l’attentat, Zemmour et Finkielkraut, auxquels il consacre la deuxième partie de son livre), est née de l’affaire Dreyfus, qui a permis de voir se positionner les intellectuels de l’époque face à l’antisémitisme d’alors – largement remplacé aujourd’hui par l’islamophobie. À le lire, on se dit que la révolte des Gilets jaunes maintenant fonctionne également comme révélateur d’une ligne de fracture entre conformistes bourgeois et penseurs résistants.
Sand montre que la figure de l’intellectuel français, intervenant dans la sphère publique et politique, tel que nous l’avons connue jusqu’à des temps récents, et telle qu’elle est en train de disparaître (notamment avec l’islamophobie, le décadentisme et le défaut de pensée colportés par Houellebecq, Charlie Hebdo d’avant l’attentat, Zemmour et Finkielkraut, auxquels il consacre la deuxième partie de son livre), est née de l’affaire Dreyfus, qui a permis de voir se positionner les intellectuels de l’époque face à l’antisémitisme d’alors – largement remplacé aujourd’hui par l’islamophobie. À le lire, on se dit que la révolte des Gilets jaunes maintenant fonctionne également comme révélateur d’une ligne de fracture entre conformistes bourgeois et penseurs résistants.














 Hier à Paris 5e et 13e, photos Alina Reyes
Hier à Paris 5e et 13e, photos Alina Reyes