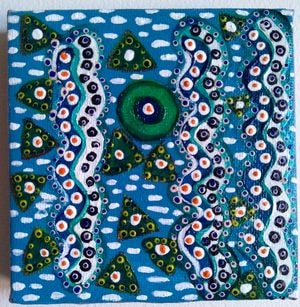M’apprêtant à partir de nouveau sous d’autres cieux, je propose, en attendant de prochaines nouvelles, ce texte sur le langage extrait de ma thèse de Littérature comparée.
*
Pour pouvoir théoriser, c’est-à-dire donner à contempler, selon l’étymologie grecque du terme, pour pouvoir dresser une poétique, c’est-à-dire dévisager, envisager le destin de la poésie tel qu’il s’est exprimé jusqu’à présent, il nous faut d’abord nous interroger sur la nature du langage. « Le langage est créé comme un flocon de neige, selon les lois de la nature », dit Noam Chomsky, qui ajoute dans la même conférence :
Le langage ne serait pas du son porteur de sens, mais plutôt du sens exprimé par une certaine forme d’externalisation – cela peut être du son mais il y a plusieurs modalités d’externalisation.1
Considérant que le trait, et par extension l’écriture, font partie de ces modalités d’externalisation, nous dirons que la nature de l’écriture, c’est d’écrire la nature – et que la nature du trait tracé par l’humain c’est d’externaliser l’humain, que la nature de l’écriture humaine, c’est d’externaliser les traits de l’esprit humain. Ces pistes du langage comme externalisation et création sont aussi celles que prend le mathématicien Alexandre Grothendieck dans son essai La Clef des songes :
On ne connaît le goût d’un aliment, tel le lait, que pour y avoir goûté, et d’aucune autre façon. Même celui qui le connaît ne saurait l’exprimer d’une autre façon que par une tautologie : “le goût du lait”. En fait, l’expérience charnelle et la connaissance charnelle qu’elle impartit précède le langage, lequel s’enracine en elles.
Il semblerait par contre que toute connaissance puisse être exprimée, et qu’il n’y ait connaissance qui ne s’exprime. Mais ce n’est qu’exceptionnellement que l’expression se fait au moyen de la parole. Souvent, l’expression la plus adéquate (voire la seule) de la connaissance qui se forme et s’approfondit par un travail créateur, se trouve dans l’œuvre créée. Par exemple, pendant qu’un peintre peint un paysage, une nature morte ou un portrait, et par l’effet de son travail et en symbiose avec lui, s’approfondit et s’affine sa connaissance de ce qui est peint. Cette connaissance, ni lui ni même Dieu en personne qui y participe pleinement ne pourrait la “formuler” en paroles. Seule l’œuvre créée peut exprimer pleinement cette connaissance, sans la déformer ou la transformer. Et c’est seulement par la création de cette œuvre que celle-ci pouvait apparaître et s’approfondir et devenir ce qu’elle est, dans sa singularité totale, dans son unicité.2
En somme, le langage, verbal ou plus souvent encore non verbal, serait à la fois postérieur à l’expérience du créé et en lui-même expérience créatrice de connaissance, comme selon Humboldt « les langues sont moins des moyens de représenter la vérité déjà connue que de découvrir la vérité encore inconnue ».3 Le langage est finalement moins une représentation, une imitation ou une traduction, qu’une présentation, une externalisation, une exposition en soi de ce qui est. Selon Walter Benjamin,
le langage de la nature doit être comparé à un secret mot d’ordre que chaque sentinelle transmet dans son propre langage, mais le contenu du mot d’ordre est le langage de la sentinelle même.4
Chez les Aborigènes, « chaque ancêtre ouvrit la bouche et cria : « JE SUIS ! », rapporte Bruce Chatwin5. Jean-Marc Ferry évoque des « grammaires profondes non linguistiques » en rapport avec « la complexion du monde vécu ».6 Le terme « complexion » renvoie au champ sémantique du corps, de même que « la bouche » des ancêtres totémiques (animaux fabuleux) d’Australie, ou « l’organisme » qu’est pour Humboldt le langage7, ou encore l’engendrement, l’enfantement évoqué par Nietzsche : « De sa propre substance, la mélodie engendre le poème, et sans cesse elle recommence. »8 Nous sommes là dans l’intuition que l’art et la langue sont tout à la fois des extensions de la nature, de notre corps, et eux-mêmes nature et corps.
Comme chez les Aborigènes, la nature du langage profond (j’appellerai ainsi la fonction poétique, le langage source), langage venu des profondeurs de l’être, chez les Achuar et dans les traditions nombreuses étudiées par Philippe Descola, n’est pas séparée de l’être. Et l’être s’entend dans une très large acception, dont rendent compte des cosmologies qui, écrit-il,
ont pour caractéristique commune de ne pas opérer de distinctions ontologiques tranchées entre les humains d’une part, et bon nombre d’espèces animales et végétales, d’autre part.9
Si cette vue de l’esprit semble très éloignée de la pensée moderne, la pensée post-moderne s’en rapproche, dans des courants comme l’antispécisme mais aussi à travers différentes recherches scientifiques qui désapproprient l’humanisme de ses « propres de l’homme » en reconnaissant à nombre d’espèces des pratiques de langage, de fabrication d’outils, de mémoire, de culture, voire même de rites, voire aussi le rire. Par ailleurs, remarque Noam Chomsky, « beaucoup de biologistes pensent qu’il n’y a qu’un seul animal dans le monde, y compris la végétation. »10 Les Contemplations de Victor Hugo présentent déjà un puissant exemple d’intuition de l’unité du vivant. Tout parle, y montre le poète, qui affirme aussi avec force la nature vivante du langage. « Ô nature, alphabet des grandes lettres d’ombre ! »11 Et : « Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. »12
Réciproquement, dans l’esprit du poète, le vivant est écriture. John Berger, parlant de l’une de ses esquisses, écrit :
C’est ce que j’appelle un texte : une rose blanche du jardin (…) Est-il possible de lire les apparences naturelles comme des textes ?13
La nature du langage profond ressortit à celle de la nature, comme processus dans lequel le locuteur, l’acte illocutoire et le discours, le sens, ne sont pas séparés mais engagés dans un même mouvement de transformation, de dépassement des formes. Dans la nature, écrit Hegel,
Le bourgeon disparaît dans l’éclosion de la floraison, et l’on pourrait dire qu’il est réfuté par celle-ci, de la même façon que le fruit dénonce la floraison comme fausse existence de la plante, et vient s’installer, au titre de la vérité de celle-ci, à la place de la fleur.14
Et : « Le vrai est le devenir de lui-même. »15
Selon Humboldt,
le langage, considéré dans sa nature réelle, est une chose en permanence et à tout moment transitoire. En lui-même ce n’est pas un produit (ergon) mais une activité (énergie).16
S’il n’y a pas de séparation ontologique entre l’être et le langage, sa vérité est moins dans le bourgeon, la fleur ou le fruit, que dans le bourgeonnement, l’éclosion, la fructification.
Et quand les éléments naturels se transposent en éléments mythiques, il se produit que comme dans l’art brut ou naïf, dans les constructions d’un Facteur Cheval ou les décors d’un Georges Méliès, dit Claude Lévi-Strauss,
dans cette incessante reconstruction à l’aide des mêmes matériaux, ce sont toujours d’anciennes fins qui sont appelées à jouer le rôle de moyens : les signifiés se changent en signifiants, et inversement.17
C’est dans ce travail, dans ce jeu, dans ce miroir qui se traverse, dans cette poétique, through the looking-glass dirait Lewis Carroll, que l’être se cherche et se trouve18.
1 Noam CHOMSKY, « Qu’est-ce que le langage, et en quoi est-ce important ? », conférence donnée le 25-7-2013 à l’Université de Genève, youtube.com
2 Alexandre GROTHENDIECK, La Clef des songes, manuscrit non publié sur papier à ce jour, http://matematicas.unex.es/~navarro/res/clefsonges.pdf, p. 179 du manuscrit (p. 185 du PDF), en note ***
3 Éliane ESCOUBAS, « La Bildung et le “sens de la langue” : Wilhem von Humboldt », Littérature, année 1992, volume 86n numéro 2, p. 60 ; persee.fr
4 Rédigé à Munich en novembre 1916 sous forme de lettre à Gershom Scholem, inédit du vivant de l’auteur : Walter BENJAMIN, « Sur le langage en général et sur le langage humain », in Œuvres I, traduit de l’allemand par Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais n° 372, 2000, p. 165
5 Bruce CHATWIN, The Songlines, Londres, Jonathan Cape, 1987. Traduit de l’anglais par Jacques Chabert : Le Chant des pistes, Paris, Grasset, 1990 ; Le Livre de Poche, 2007, p. 108
6 Jean-Marc FERRY, Les grammaires de l’intelligence, Paris, Éditions du Cerf, 2004, p. 15
7 In Éliane ESCOUBAS, « La Bildung… », art.cit.
8 Friedrich NIETZSCHE, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872. Traduit de l’allemand par Jean Marnold et Jacques Morland : L’Origine de la Tragédie dans la musique, Paris, Mercure de France, 1906, § 6, p. 61, wikisource.org. Autre traduction, par Philippe Lacoue-Labarthe : « La mélodie enfante, et à vrai dire ne cesse d’enfanter la poésie », in La Naissance de la tragédie, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 1986, p. 48
9 Philippe DESCOLA, Par delà nature…, op.cit., p. 27
10 Noam CHOMSKY, « Qu’est-ce que le langage… », conférence citée
11 Victor HUGO, « À propos d’Horace », Les Contemplations, Livre premier, XIII, Paris, Pagnerre et Michel Lévy, 1856 ; Paris, Nelson Éditeur, 1911, p. 52, wikisource.org
12 Ibid., « Suite », Livre premier, VIII, p. 36
13 John BERGER, lettre à son fils, lue dans le documentaire de Cordelia Dvorák John Berger ou la mémoire du regard, Arte, 2016
14 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, System der Wissenschaft. Erster Theil : Die Phänomenologie des Geistes, Bamberg/Würzburg, Goebhardt, 1807 ; trad. de l’allemand par Jean-Pierre Lefebvre : Phénoménologie de l’esprit, Paris, Flammarion, coll. Bibliothèque philosophique (Aubier), 1991, p. 28
15 Ibid., p. 38
16 In Éliane ESCOUBAS, « La Bildung… », art.cit.
17 Claude LÉVI-STRAUSS, La Pensée sauvage, Paris, Librairie Plon, 1962 ; in Œuvres, éd. de Vincent Debaene, Frédéric Keck, Marie Mauzé et Martin Rueff, préf. de Vincent Debaene, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, n°543, 2008, p. 577
18 Lewis CARROLL, Through the Looking-Glass, Londres, Macmilan,1871


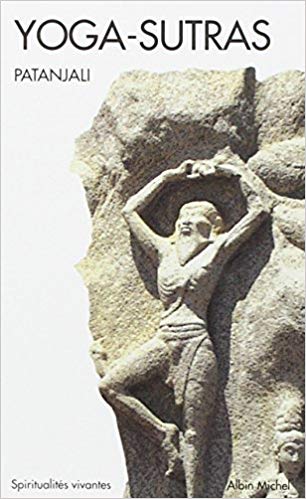
 vue sur le dôme du Panthéon, aujourd’hui à Paris, photo Alina Reyes
vue sur le dôme du Panthéon, aujourd’hui à Paris, photo Alina Reyes


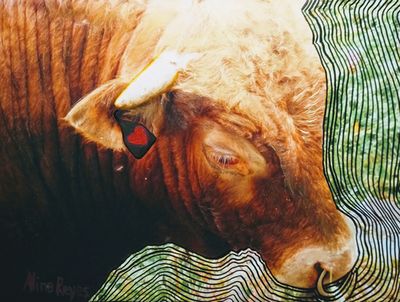
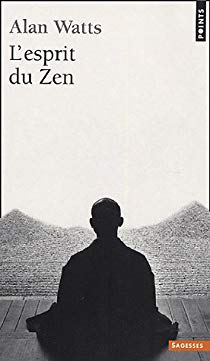 « Le Zen n’essaie pas d’être intelligible, c’est-à-dire capable d’être compris par l’intellect. Sa méthode consiste à surprendre, déconcerter, stimuler, dérouter et épuiser l’intellect jusqu’au moment où nous prendrons conscience que l’intellection n’est que réflexion sur quelque chose ; de même qu’à exaspérer, irriter et épuiser les facultés émotionnelles jusqu’au moment où nous prendrons conscience que l’émotion se résume en une sensation « de » quelque chose. Ainsi, lorsque l’adepte se trouvera devant une impasse intellectuelle et émotionnelle, le Zen lui permettra de jeter un pont entre un contact indirect et conceptuel avec la vérité et un contact direct. À cet effet, il fait appel à une faculté supérieure de l’esprit connue sous le nom d’intuition ou Buddhi ou encore « Œil de l’Esprit ». En somme, l’objet du Zen consiste à diriger notre attention sur la réalité même et non sur nos réactions intellectuelles et émotionnelles à cette réalité – la réalité étant cette chose en perpétuel changement et devenir, cette notion indéfinissable connue sous le nom de « vie », dont le cours ne s’interrompt pas un seul instant afin de nous permettre de l’adapter selon notre convenance à un système rigide de fichiers et d’idées.
« Le Zen n’essaie pas d’être intelligible, c’est-à-dire capable d’être compris par l’intellect. Sa méthode consiste à surprendre, déconcerter, stimuler, dérouter et épuiser l’intellect jusqu’au moment où nous prendrons conscience que l’intellection n’est que réflexion sur quelque chose ; de même qu’à exaspérer, irriter et épuiser les facultés émotionnelles jusqu’au moment où nous prendrons conscience que l’émotion se résume en une sensation « de » quelque chose. Ainsi, lorsque l’adepte se trouvera devant une impasse intellectuelle et émotionnelle, le Zen lui permettra de jeter un pont entre un contact indirect et conceptuel avec la vérité et un contact direct. À cet effet, il fait appel à une faculté supérieure de l’esprit connue sous le nom d’intuition ou Buddhi ou encore « Œil de l’Esprit ». En somme, l’objet du Zen consiste à diriger notre attention sur la réalité même et non sur nos réactions intellectuelles et émotionnelles à cette réalité – la réalité étant cette chose en perpétuel changement et devenir, cette notion indéfinissable connue sous le nom de « vie », dont le cours ne s’interrompt pas un seul instant afin de nous permettre de l’adapter selon notre convenance à un système rigide de fichiers et d’idées.
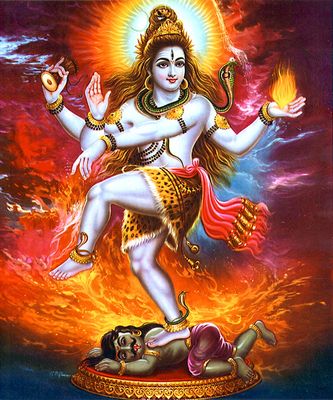 Le fantastique film de
Le fantastique film de