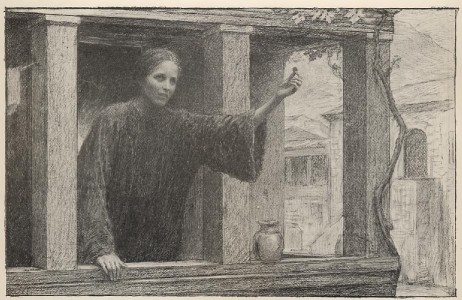Hildegarde de Bingen, Liber divinorum operum
« Dans la rotondité de la tête humaine, c’est la rotondité du firmament que l’on retrouve. Les dimensions justes et rigoureuses du firmament correspondent aux mêmes dimensions de la tête de l’homme. Celle-ci a donc ses mesures exactes, comme le firmament, qui répond lui aussi à des mesures rigoureuses, afin de pouvoir accomplir une révolution parfaite, afin qu’aucune partie n’outrepasse injustement la mesure d’une autre. C’est que Dieu a façonné l’homme sur le modèle du firmament et il a conforté son énergie par des forces élémentaires. Ces forces, il les a aussi confortées à l’intérieur de l’homme, afin que ce dernier les aspirât et les expirât, de même que le soleil, qui illumine le monde, émet ses rayons pour ensuite les faire revenir à lui. La rotondité et l’harmonie de la tête de l’homme signifient donc que l’âme suit dans les péchés la volonté de la chair, avant de se renouveler dans les soupirs qui la portent vers la justice (…)»
Hildegarde de Bingen, citée par Jean-Claude Schmitt dans Quand la lune nourrissait le temps avec du lait. Le temps du cosmos et des images chez Hildegarde de Bingen
*
Et voici Séquence de l’Esprit saint, l’un des poèmes cités par Régine Pernoud dans sa biographie (au Livre de Poche) du prochain docteur de l’Église :
Ô feu de l’Esprit protecteur
Vie de la vie de toute créature
Tu es saint, vivifiant toute forme.
Tu es saint
Toi qui oins les blessés en péril
Tu es saint
Toi qui essuies les blessures puantes.
Ô toi qui insuffles la sainteté
Et le feu de l’amour
Ô goût de la douceur dans la poitrine
Infusion des coeurs
Dans la bonne odeur des vertus.
Ô source très pure
En laquelle est contemplé
Ce que Dieu attire les étrangers
Et recherche les âmes perdues.
Ô cuirasse de vie et espoir de protection
De tous les membres
Ô ceinture d’honnêteté
Sauve les bienheureux.
Garde ceux
Qui furent emprisonnés par l’ennemi
Et délie les enchaînés que ta force divine veut sauver.
Ô chemin des plus courageux
Qui as tout pénétré
Dans les hauteurs et sur la terre
Et dans tous les abîmes
Tu les réunis et les rassembles tous.
De toi s’écoulent des nuages
L’éther vole
Les pierres prennent humidité
Les eaux coulent en ruisseaux
Et la terre exsude viridité.
Tu induis toujours les doctes
Par inspiration de sagesse
Et les rends joyeux.
Que louange soit donc à toi
Qui résonnes de louange
Et joie de vie,
Espoir et honneur des plus vifs
Donnant des récompenses de lumière.
*
écouter sa céleste musique :
*