Ajout du 2 août 2017 : j’actualise cette note avec ce lien vers une autre de mes notes où je pose la question d’une éventuelle discrimination religieuse au concours (pour cet oral sur Montaigne et un autre sur Char).
Voici, avant évocation de la polémique qui a suivi, la retranscription exacte, avec introduction, conclusion et quelques passages rédigés, des notes que j’ai prises (servant à soutenir la parole) pendant les 6 heures de préparation de l’épreuve phare à l’oral de l’agrégation de Lettres modernes. Il m’a été demandé une étude littéraire (l’épreuve un peu vague qui donne lieu aux plus mauvaises notes), j’en donne le résultat et je le commente après la retranscription.
Montaigne est au programme de l’agrégation de Lettres classiques pour l’année 2018.
*
« Fais que ma vieillesse ne soit ni honteuse ni privée de ma lyre ». Horace, Odes. C’est la dernière citation des Essais de Montaigne, et son Livre III se termine sur elle. Le texte de six pages que nous allons étudier se situe dans la deuxième moitié des quarante pages du chapitre 12 de ce livre. Le chapitre précédent (11, « Des boiteux »), se terminait sur le constat que « Les uns tiennent en l’ignorance, cette même extrémité, que les autres tiennent en la science. » Notre chapitre s’ouvre sur cet autre constat : « Quasi toutes les opinions que nous avons, sont prises par autorité et à crédit. » Tandis que le chapitre suivant (13, « De l’expérience »), pose d’emblée que « Il n’est désir plus naturel que le désir de connaissance. » C’est bien dans le cadre de ces trois constats que se situe notre passage, lui-même témoin de la logique à la fois souple, imagée et rigoureuse, à l’œuvre dans le livre de Montaigne. Le texte constitue en effet un cheminement impeccable de la vie de l’homme à la vie du discours. Dans un premier temps, de « Nous n’aurons pas faute » à « se craindre des Dieux », Montaigne donne le plaidoyer de Socrate lors de son procès, qu’il paraphrase de l’Apologie de Socrate de Platon : il s’agit de donner en exemple son attitude face à la mort. Dans un deuxième temps, de « Voilà pas un plaidoyer » à « l’art n’y peut joindre », Montaigne commente ce plaidoyer et commente la justesse de Socrate. Et dans un troisième temps, de « Or nos facultés » à « l’honneur de l’allégation », Montaigne continuant pourrait-on dire à chevaucher la même logique, passe en douceur à une autre vitesse, une autre allure, embraye de la dimension de la vie de l’homme à celle de la vie du discours, pour établir la supériorité de « l’invention » sur « l’allégation ».
Ce passage constituant en lui-même une leçon d’une parfaite élégance, nous essaierons tout simplement de chevaucher à sa suite pour étudier la façon dont Montaigne nous indique comment se conduire face à la mort et face aux lieux communs, et comment « parler et vivre » sont liés.
Dans un premier temps, nous allons donc suivre Montaigne dans sa retranscription du discours de Socrate face à ses juges, en y distinguant trois thèmes : a) le pari de Socrate ; b) les obligations de la vie ; c) le choix d’une éthique.
Dans un deuxième temps, nous regarderons comment l’auteur des Essais commente ce qu’il appelle le plaidoyer de Socrate : a) en faisant l’éloge de la simplicité de Socrate ; en rapportant les effets de sa justesse, notamment sur les Athéniens ; c) en justifiant le choix du penseur grec par des considérations sur la mort.
Dans un troisième temps, nous serons attentifs à la leçon finale tirée par Montaigne dans le troisième mouvement de sa démonstration : a) par le passage du « il » de Socrate au « nous » et au « je » ; b) par des observations sur la pratique de la citation ; c) en témoignant de sa recherche du dépassement de la citation par l’invention et la réinvention.
…
I Le discours de Socrate
a) le pari de Socrate
Celui qui va parler dans ce passage, Socrate, est introduit brièvement comme l’un de ces bons maîtres dont un « nous » qui désigne à la fois l’auteur et ses lecteurs ne manqueront pas pour apprendre à philosopher, c’est-à-dire, pour paraphraser Montaigne, à mourir et à vivre. L’un de ces « interprètes de la simplicité naturelle », celle des paysans et autres représentants de la « vérité naïve » qu’il a vantés dans les lignes précédentes. Il est remarquable que le discours de Socrate dans un moment aussi essentiel, aussi décisif, puisqu’il se trouve, rappelle-t-il, « devant les juges qui délibèrent de sa vie », ne soit séparé de la parole propre de Montaigne par aucun signe de ponctuation (hormis le point qui sépare deux phrases habituellement du même locuteur), de typographie, de présentation, ni par quelque incise comme « dit-il ». D’une phrase à l’autre, le je n’est pas le même et c’est une façon d’inviter le lecteur à faire sien, comme Montaigne, le je de Socrate, à entrer en empathie de pensée avec lui. En somme, il nous met en selle par un acte de pensée bondissant, après nous avoir mis le pied à l’étrier par sa brève introduction. Un acte de pensée paradoxale, propre à réveiller le lecteur – comme les juges. « J’ai peur, messieurs, si je vous prie de ne me faire mourir, que je m’enferre en la délation de mes accusateurs. » Autrement dit, si Socrate demande qu’on lui laisse la vie, il fera le jeu de ses accusateurs. On l’accuse de remplacer les anciens dieux par d’autres et de corrompre la jeunesse. Lui veut montrer au contraire qu’il ne souhaite pas être au-dessus des lois de la cité, qu’il s’y conforme, n’ayant pas, contrairement à ce qu’on l’accuse de prétendre, « quelque connaissance plus cachée, des choses qui sont au-dessus et au-dessous de nous. »
Au contraire, ne sachant pas, il se place devant la perspective de la mort dans une sorte de pari : puisque nul ne peut savoir « ni quelle est, ni quel il fait en l’autre monde », il ne voit que deux possibilités : soit la mort est indifférente, si c’est un anéantissement, un repos éternel ; soit, si elle permet de rejoindre de « grands personnages trépassés »et d’être débarrassé des « juges iniques et corrompus » (jolie pique à ceux qui lui font face), elle est alors enviable. Un pari simple et sans calcul, où l’on est au moins non-perdant.
b) Les obligations de la vie
Elles sont de plusieurs ordres. Sociales : ne pas offenser son prochain, ne pas désobéir au supérieur, soit Dieu soit homme. Familiales : ne pas peiner ses amis et parents, ne pas abandonner ses enfants. Et la responsabilité envers ses concitoyens, que lui-même exerce en enseignant jeunes et vieux, et au nom de laquelle il demande aux juges d’être justes : « je dis bien que pour votre conscience vous ferez mieux de m’élargir. »
c) le choix d’une éthique
Ayant montré sa bonne foi, Socrate plaide pour le choix d’une éthique. Tant pour ses juges auxquels il conseille non sans humour d’ordonner « que je sois nourri, attendu ma pauvreté, au Prytanée aux dépens publics, ce que souvent je vous ai vus à moindre raison octroyer à d’autres. » Et pour lui-même, qui ne doit pourtant pas les supplier, invoquer leur pitié. Car, dit-il, « je ferais honte à notre ville, en l’âge que je suis et en telle réputation de sagesse que m’en voici en prévention, de m’aller démettre à si lâches contenances. » Ce qui, ajoute-t-il, déshonorerait les autres Athéniens, y compris ses juges auxquels il ne veut pas faire tort en les détournant des seules « raisons pures et solides de la justice ». Tout ceci est savoureux [et j’ai expliqué oralement l’humour et l’ironie du discours]
II Le commentaire du plaidoyer de Socrate
a) l’éloge de la simplicité
Un nouveau paradoxe ouvre cette deuxième partie du texte, et c’est une façon de relancer l’intérêt tout en s’inscrivant dans la continuité des remarques antérieures à l’évocation du discours de Socrate et à sa retranscription. Un plaidoyer, juge Montaigne, « quant et quant naïf et bas, d’une hauteur inimaginable. » Un jugement en forme d’antithèse où le plus bas, c’est-à-dire le plus terre à terre, le plus simple, conduit au plus haut : partant du réel, des choses de la cité et de la famille, Socrate aboutit aux considérations éthiques les plus élevées, qui se traduisent par son refus de se compromettre et de compromettre autrui, fût-ce pour sauver sa vie. Socrate désire un juste dénouement, mais par de justes voies. La fin ne justifie pas les moyens. Et cela, il le dit à sa propre façon, non en empruntant un discours tout fait comme par exemple celui de Lysias. Socrate, avec sa « riche et puissante nature », ne saurait « se parer du fard des figures et feintes d’une oraison apprise. »
b) effets de la justesse de Socrate
Par la sincérité et la justesse de son discours, Socrate a mis les Athéniens de son côté. Après le verdict des juges, celui du peuple [là j’ai évoqué à l’oral l’épisode ironique des juges allant se pendre]. C’est ensuite Montaigne lui-même qui se place face au jugement du lecteur et plaide pour l’exemple qu’il a choisi dans la vie et la parole de Socrate. Ainsi voyons-nous le texte engendrer le texte, la défense du choix de Socrate engendrant celle du choix de Montaigne en une merveilleuse progression naturelle, une dialectique discrète entre l’auteur et le lecteur comme entre les différents personnages, notamment les Athéniens, quelque chose d’une dialectique et d’une maïeutique socratique à la mode de Montaigne qui fait avancer la pensée avec une simplicité et une hauteur dignes de celles dont il fait l’éloge chez d’autres.
c) les considérations sur la mort
À ceux qui considéreraient que l’exemple de Socrate est trop élevé pour pouvoir être suivi par le commun des mortels, Montaigne répond par un nouveau paradoxe, ou du moins en retournant le paradoxe. Ce n’est plus seulement que la simplicité engendre l’élevé, c’est que l’élevé est en réalité ce qu’il y a de plus naturel. Montaigne invite le lecteur à l’observation, plutôt qu’à la répétition d’opinions toutes faites. « Nous avons naturellement crainte de la douleur : mais non de la mort, à cause d’elle-même : c’est une partie de notre être, non moins essentielle que le vivre. »
D’une part la mort en elle-même n’est rien, d’autre part elle est utile à la vie, comme « passage à mille autres vies. » Et nous nous souvenons du titre de ce chapitre : « De la physionomie ». Physio, c’est la nature, phusis. Physionomie, discours sur la nature. Et quand Montaigne parle de cette « république universelle » où la mort sert de « naissance », nous nous souvenons que sa pensée est nourrie de philosophie antique et que cette philosophie nourrit aussi son époque, ce temps d’humanisme que nous avons appelé plus tard Renaissance.
III Du lieu commun à la pensée
a) le passage du « il » au « nous » et au « je »
« Or nos facultés ne sont pas ainsi dressées », objecte Montaigne au début de la troisième partie de sa démonstration. S’ensuit une série de verbes au présent ayant « nous » pour sujets. Montaigne implique le lecteur et l’invite à se regarder face à ses juges et à la mort. Et aussitôt après, il s’implique aussi lui-même. D’abord indirectement : « quelqu’un pourrait dire de moi que je… », puis en répliquant directement à ce quelqu’un : « Certes je… Mais je…. » Comme à son habitude, et comme pour annoncer le titre du chapitre suivant, Montaigne appuie sa pensée sur l’expérience, sur son expérience. Il témoigne de lui-même et c’est sa façon de toucher, comme Socrate, le bas pour atteindre le haut. Faisant ainsi de ses Essais des objets de pensée vivants, habité par la vie dont témoigne un style fluide, une expression enlevée, aussi simple que possible pour exprimer des vérités complexes, révéler sous la couche de crasse de l’opinion (cf juges « pollués ») le visage du réel.
b) la pratique de la citation
Le terme lieu commun a pris aujourd’hui un sens péjoratif. Mais au temps de Montaigne, comme il le raconte, le lieu commun était prôné comme source de savoir [j’en parlais ici en me souvenant d’un cours de Roger Chartier que j’avais suivi au Collège de France où il évoquait ce sujet]. On s’enchantait de redécouvrir les classiques de l’Antiquité, fût-ce seulement à travers quelques citations qu’on appelait lieux communs par référence à leur caractère universel. Des gens confectionnaient des albums de lieux communs (« ces pâtissages », dit Montaigne) comme au siècle dernier ils auraient collectionné des porte-clés. Montaigne lui-même pratique beaucoup la citation, « sans peine et sans suffisance, ayant mille volumes de livres, autour de moi, en ce lieu où j’écris ». Mais il y a manière et manière de le faire, dit en substance Montaigne [la manière intelligente et la manière stupide, ai-je complété à l’oral d’après son texte]
c) le dépassement de la citation par l’invention
Montaigne s’oppose à ces collectionneurs de porte-clés-à-penser en revenant au « nous » : « nous autres naturalistes ». De nouveau nous revenons au titre du chapitre, Montaigne ne perd pas de vue sa position et sa destination. Le nous qu’il convoque n’est plus exactement celui des lecteurs mais celui de tous ceux qui avec lui (dont peuvent faire partie des lecteurs) sont adeptes de la nature et suivent son fonctionnement comme nous-même, lecteurs, suivons le texte de Montaigne. Et ce que dit le texte par ce « nous autres naturalistes », c’est qu’il nous faut comprendre la logique d’une pensée qui, des considérations sur la mort comme outil de naissance e d’augmentation, passe à celle de la citation comme outil de réinvention, à la lecture comme outil d’invention. Et comment des considérations sur l’éthique face à des questions de vie et de mort, on passe à une éthique de la création, de l’écriture, de la pensée. Dans les deux cas, il est question d’ « honneur ».
…
Nous nous sommes laissés guider par Montaigne comme une file de cavaliers cheminant dans la forêt derrière un « bon régent », dont la bonne assiette à cheval et la familiarité bienveillante et assurée avec les montures de la pensée sont aptes à nous proposer une bonne et pleine promenade et une heureuse arrivée à destination. Empruntant nous aussi un chemin, parmi d’autres, du lieu commun, nous pourrions songer à Parménide disant avoir été emporté au lieu de son désir de connaissance par des juments, tandis que des jeunes filles montraient la direction. En passant par le je de Socrate puis par le il désignant Socrate, et enfin le nous des lecteurs et le je de l’auteur, Montaigne nous a conduits des régions des apparences (les lieux communs, la pensée toute faite, l’opinion) à celles de l’être (la pensée réelle) dans sa singularité et son universalité.
« Si j’eusse voulu parler par science, j’eusse parlé plus tôt », écrit-il juste après notre passage, arguant que jeune, il était plus proche de ses études et avait plus de mémoire pour faire étalage de sa science, si telle avait été son ambition. Or, sans nier l’importance du savoir et de la pensée d’autrui, que lui-même utilise abondamment, ce n’est pas cette science en elle-même que veut transmettre Montaigne, mais bien plutôt celle qui consiste à savoir lire et à savoir réfléchir ses lectures, non en miroir servile qui transforme un texte, une citation, une pensée, en image figée, voire en idole intouchable mais en fait muette, lettre morte – mais en les réfléchissant dans le mouvement de l’esprit qui, pour embrayer un autre lieu commun, celui du fleuve d’Héraclite, transforme et réinvente continuellement tout.
Au chapitre précédent, « Des boiteux », Montaigne souhaitait des êtres humains « qu’ils eussent plutôt gardé la forme d’apprentis à soixante ans, que de représenter les docteurs à dix ans. » Car vouloir être savant à dix ans c’est être vieux, tandis que se vouloir et se savoir apprenti à soixante ans, c’est rendre hommage à la jeunesse perpétuellement reconduite et avançante de l’esprit. Telle est la physio-nomie, le discours, le nom de la nature, selon un auteur qui en suit le meilleur.
*
À la suite de mon exposé, le président du jury (tous les jurys devant lesquels je suis passée au concours étaient présidés par un homme, entourés de femmes qui avaient bien moins la parole) m’a demandé si l’histoire des juges qui se pendaient ne me rappelait rien. Bien entendu j’ai dit qu’on pouvait y voir une référence à Judas (et je l’avais évidemment vue, ayant longuement travaillé sur la Bible, ce dont je n’ai rien dit). Mais il a voulu à tout prix me faire dire (comme on le dit ordinairement, et comme le dit une note dans l’édition) que Montaigne nous présentait un Socrate christique. J’ai donné mes arguments pour récuser cette lecture, mais cela a semblé lui déplaire fortement. (J’ajoute ici : Le discours de Socrate via Montaigne est si paraphrasé de celui que rapporte Platon : Platon présentait-il un Socrate christique ? Aberration. Montaigne manie là l’humour et l’ironie comme Socrate l’a fait lui-même, avec connotation politique – rien de tel dans l’évangile chrétien). Socrate est une figure de l’humanisme, lui ai-je dit, il n’est pas question d’un sacrifice « pour racheter le péché du monde ». Il a insisté, cela a duré un petit moment, au cours duquel il a semblé vouloir me faire dire aussi que Socrate dans ce texte, c’était Montaigne – ce qui est faux, le discours est de très près paraphrasé de celui que rapporte Platon, qui en fut le témoin direct et fidèle (d’ailleurs un peu plus loin dans le chapitre Montaigne se démarque clairement de Socrate ; certes comme tout auteur et tout lecteur il peut se retrouver plus ou moins dans telle ou telle parole d’autrui, mais cela n’enlève pas toute altérité dans le texte). Une professeure, quant à elle, a semblé croire que j’imaginais qu’il y avait des guillemets ailleurs dans les Essais, puisque j’avais noté qu’il n’y en avait pas pour encadrer le discours de Socrate. J’étais sidérée qu’on puisse penser que je n’avais pas remarqué la ponctuation et la présentation du texte tout au long du livre. Faut-il vraiment préciser de telles évidences ? Et maintenant je me demande si le jury a vraiment suivi et compris le déroulement de ma lecture. En tout cas cette leçon a été notée 4/20 (et il s’agit de l’épreuve qui a le plus lourd coefficient dans le concours, coefficient 13). Pourquoi une note si basse ? Ai-je été sanctionnée pour avoir présenté puis défendu une lecture bien personnelle du texte, bien personnelle mais très sensée (j’attends qu’on me démontre qu’il y a quelque part un faux sens ou un contresens dans ma lecture) ? Ai-je été sanctionnée pour avoir, femme face à un président homme, soutenu une pensée de ma propre autorité ? Quoi d’autre ? Quoi que ce soit de personnel a-t-il le droit de s’immiscer dans un concours, et dans un tel concours ? Les notes que j’ai eues à l’écrit puis à l’oral tendent en tout cas à indiquer qu’une pensée et un style bien affirmés ne sont pas bienvenus au milieu des exercices formatés livrés par des candidats auxquels on a davantage inculqué des règles d’analyse, de composition et d’expression, qu’on ne les a encouragés à l’ouverture et à la profondeur de l’esprit.
*


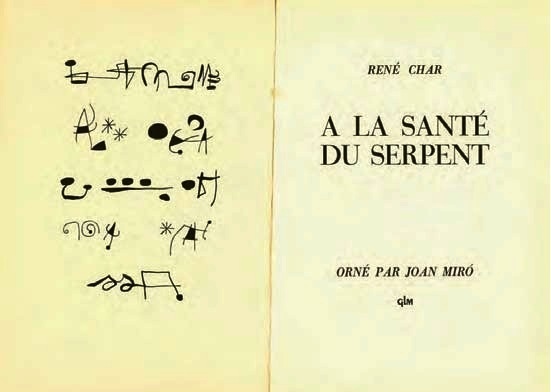


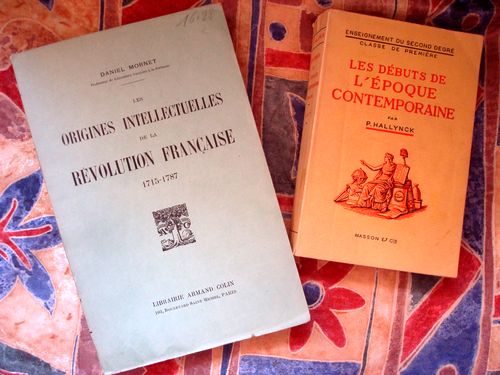 *
*

 ces jours-ci dans les rues de Paris, photos Alina Reyes
ces jours-ci dans les rues de Paris, photos Alina Reyes






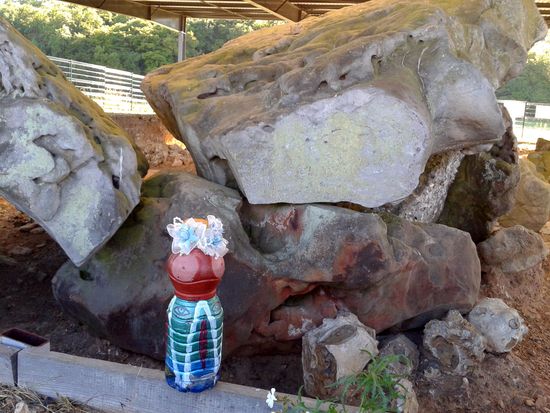

















 une image pour illustrer l’accord de Paris sur le climat, rejeté par Trump : « Fluctuat nec mergitur » ; ces jours-ci à Paris, photo Alina Reyes
une image pour illustrer l’accord de Paris sur le climat, rejeté par Trump : « Fluctuat nec mergitur » ; ces jours-ci à Paris, photo Alina Reyes