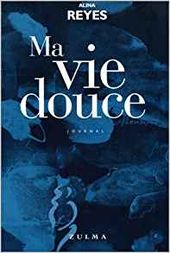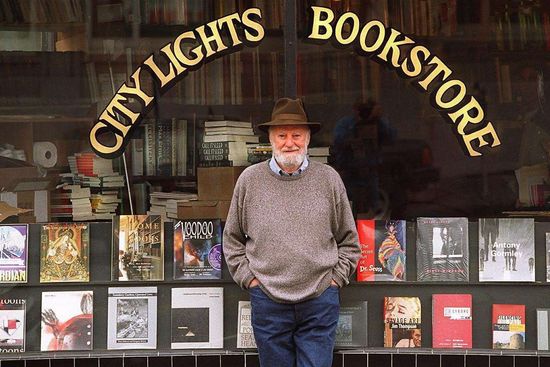
Lawrence Ferlinghetti, photo John O’Hara / The Chronicle
Lawrence Ferlinghetti est mort ce lundi 22 février, à l’âge de cent un ans (à un mois de ses cent deux ans). En l’apprenant cette nuit, j’ai aussitôt pensé à la City Lights Bookstore, la librairie de la Beat generation qu’il a fondée et où je suis bien sûr allée quand j’étais à San Francisco, il y a trente ans. Et surtout à son poème Autobiography, que j’avais traduit un peu après, un été à Barèges, juste comme ça, ainsi que d’autres poèmes de ses comparses de l’époque, comme Corso. Il se trouve que par exception, alors que j’ai perdu quasiment tous mes manuscrits, il me reste quelques feuilles écrites à la main de ces traductions, dont celle-ci. Je l’ai revue et complétée, car il ne me reste pas tout le texte, la voici. Je n’ai pu la confronter à d’autres traductions en français, j’espère n’avoir pas fait de faux sens mais la langue en elle-même est assez simple, ça devrait aller.
J’aime le rythme de ce poème de 1958, qui rappelle La Prose du Transsibérien de Cendrars (1913), voire Howl de Ginsberg (1956), ou le rouleau de Sur la route de Kerouac (1957). J’ai retranscrit les majuscules en français, là où d’habitude on n’en met pas, pour être plus proche de l’esprit du texte en américain. Je me suis demandé pourquoi il disait que les billets de dollars ne portaient pas l’inscription In God we trust – et découvert qu’en fait ils l’ont portée peu après l’écriture du poème.
*
Je mène une vie tranquille
chaque jour sur Mike’s Place
à regarder les champions
de l’Académie de billard Dante
et les accros du flipper français.
Je mène une vie tranquille
sur Lower East Broadway.
Je suis un Américain.
Je fus un garçon américain.
J’ai lu l’American Boy Magazine
et je suis devenu boyscout
en banlieue.
Je me prenais pour Tom Sawyer
pêchant l’écrevisse dans la Bronx River
et imaginant le Mississipi.
J’ai eu une batte de baseball
et un vélo American Flyer.
J’ai livré le Woman’s Home Companion
à cinq heures de l’après-midi
ou le Herald Trib
à cinq heures du matin.
J’entends encore le bruit sourd du papier qui cogne
sur des porches perdus.
J’ai eu une enfance malheureuse.
J’ai vu la terre de Lindbergh.
J’ai regardé à la maison
et je n’ai pas vu d’ange.
Je me suis fait prendre en train de voler des crayons
au Five and Ten Cent Store
le même mois où j’ai fait Eagle Scout.
J’ai coupé des arbres pour le CCC
et je me suis assis dessus.
J’ai débarqué en Normandie
dans une barque qui s’est renversée.
J’ai vu les armées éduquées
sur la plage à Douvres.
J’ai vu des pilotes égyptiens dans des nuages violets
des commerçants roulant leur store
à midi
salade de pommes de terre et pissenlits
aux pique-niques anarchistes.
Je lis « Lorna Doone »
et une vie de Hans Most
terreur de l’industriel
une bombe sur son bureau à tout moment.
J’ai vu la parade des éboueurs
à la Parade du Jour de Colomb
derrière les désinvoltes
pétants trompettistes.
Je n’ai pas fait de longue retraite
dans un cloître
ni aux Tuileries
mais je pense toujours
à y aller.
J’ai vu la parade des éboueurs
quand il neigeait.
J’ai mangé des hotdogs dans des terrains de baseball.
J’ai su le discours de Gettysburg
et le discours de Ginsberg.
Je me plais ici
et je ne retournerai pas
d’où je viens.
J’ai aussi cavalé sur des wagons wagons wagons
J’ai voyagé parmi des inconnus.
J’ai été en Asie
sur l’Arche avec Noé.
J’étais en Inde
quand Rome fut bâtie.
J’ai été dans la Crèche
avec un Âne.
J’ai vu le Distributeur Éternel
d’une Colline Blanche
dans le sud de San Francisco
et la Femme Qui Rit à Loona Park
à l’extérieur de la Fun House
sous une pluie torrentielle
qui riait encore.
J’ai entendu le bruit des festivités
dans la nuit.
J’ai erré solitaire
comme une foule.
Je mène une vie tranquille
à l’extérieur de Mike’s Place chaque jour
à regarder le monde marcher
dans ses étranges chaussures.
Un jour j’ai commencé
à faire le tour du monde
mais j’ai échoué à Brooklyn.
Ce Pont était trop pour moi.
Je me suis engagé dans le silence
l’exil et la ruse.
J’ai volé trop près du soleil
et mes ailes de cire sont tombées.
Je cherche mon Vieil Homme
que je n’ai jamais connu.
Je cherche le Chef Perdu
avec qui j’ai volé.
Les jeunes hommes devraient être des explorateurs.
Mais Mère ne m’a jamais dit
qu’il y aurait de telles scènes.
Entrailles-lasses
je repose
j’ai voyagé.
J’ai vu la ville idiote.
J’ai vu le fatras de la masse.
J’ai entendu pleurer Kid Ory.
J’ai entendu prêcher un trombone.
J’ai entendu Debussy
tendu à travers une feuille.
J’ai dormi dans cent îles
où les livres étaient des arbres.
J’ai entendu les oiseaux
qui sonnent comme des cloches.
J’ai porté des pantalons de flanelle grise
et j’ai marché sur la plage de l’enfer.
J’ai habité dans cent villes
où les arbres étaient des livres.
Quels métros quels taxis quels cafés !
Quelles femmes aux poitrines aveugles
membres perdus parmi les gratte-ciel !
J’ai vu les statues des héros
aux carrefours.
Danton pleurant à l’entrée d’un métro
Colomb à Barcelone
pointant vers l’Ouest sur les Ramblas
vers l’American Express
Lincoln dans sa chaise de pierre
Et un grand Visage de Pierre
dans le Dakota du Nord.
Je sais que Colomb
n’a pas découvert l’Amérique.
J’ai entendu cent Ezra Pound domestiqués.
Ils devraient tous être libérés.
Ça fait longtemps que j’étais berger.
Je mène une vie tranquille
chaque jour sur Mike’s Place
à lire les annonces classées.
J’ai lu le Reader’s Digest
d’un bout à l’autre
et remarqué l’identification profonde
des États-Unis à la Terre Promise
où sur chaque pièce est marqué
In God We Trust
mais pas sur les billets de dollars,
qui sont les dieux en eux-mêmes.
Chaque jour je lis les petites annonces
à la recherche d’une pierre une feuille
une porte introuvable.
J’entends chanter l’Amérique
dans les Pages Jaunes.
On ne croirait jamais
que l’âme a ses fureurs.
Chaque jour je lis les journaux
et j’entends l’humanité bancale
dans la triste pléthore d’imprimé.
Je vois où l’étang de Walden a été vidé
pour faire un parc de loisirs.
Je vois qu’ils sont en train de faire à Melville
manger sa baleine.
Je vois qu’une nouvelle guerre arrive
mais je ne serai pas là pour la combattre.
J’ai lu ce qui est écrit
sur le mur des cabinets.
J’ai aidé Kilroy à l’écrire.
J’ai défilé dans la Cinquième Avenue
soufflant dans un clairon au milieu d’un peloton compact
mais je me suis dépêché de rentrer à la Casbah
chercher mon chien.
Je vois une similitude
entre les chiens et moi.
Les chiens sont les véritables observateurs
par monts et par vaux dans le monde
à travers le pays de Molloy.
J’ai descendu à pied des ruelles
trop étroites pour des Chrysler.
J’ai vu cent chariots à lait sans chevaux
dans un terrain vague à Astoria.
Ben Shahn ne les a jamais peints
mais ils sont là
de travers à Astoria.
J’ai entendu l’obbligato du ferrailleur.
J’ai roulé sur des autoroutes
et j’ai cru aux promesses des panneaux de signalisation
Traversé les Jersey Flats
et vu les Cités de la Plaine
Je me suis vautré dans la nature sauvage de Westchester
avec ses bandes errantes d’autochtones
dans des breaks.
Je les ai vus.
Je suis l’homme.
J’étais là.
J’ai souffert
un peu.
Je suis un Américain.
J’ai un passeport.
Je n’ai pas souffert en public.
Et je suis trop jeune pour mourir.
Je suis un self-made man.
Et j’ai des projets d’avenir.
Je suis en lice
pour un super job.
Je vais peut-être déménager
à Detroit.
Je ne suis que temporairement
vendeur de cravates.
Je suis un bon gars.
Je suis un livre ouvert
pour mon boss.
Je suis un total mystère
pour mes plus proches amis.
Je mène une vie tranquille
chaque jour sur Mike’s Place
à contempler mon nombril.
Je fais partie de la longue folie du corps.
J’ai erré dans divers bois de la nuit.
Je me suis penché aux portes saoules.
J’ai écrit des histoires folles
sans ponctuation.
Je suis l’homme.
J’étais là.
J’ai souffert
un peu.
Je me suis assis sur une chaise instable.
Je suis une larme du soleil.
Je suis une colline
où courent les poètes.
J’ai inventé l’alphabet
après avoir observé le vol des grues
qui font des lettres avec leurs pattes.
Je suis un lac sous la plaine.
Je suis un mot
dans un arbre.
Je suis une colline de poésie.
Je suis un raid
sur l’inarticulé.
J’ai rêvé
que toutes mes dents tombaient
mais ma langue vivait
pour raconter l’histoire.
Car je suis un alambic
de poésie.
Je suis une banque de chant.
Je suis un pianiste
dans un casino abandonné
sur une esplanade en bord de mer
dans un brouillard dense
continuant à jouer.
Je vois une similitude
entre la Femme Qui Rit et
moi-même.
J’ai entendu le son de l’été
dans la pluie.
J’ai vu des filles sur des promenades
avoir des sensations compliquées.
Je comprends leurs hésitations.
Je suis un cueilleur de fruits.
J’ai vu comment les baisers
causent de l’euphorie.
J’ai risqué l’enchantement.
J’ai vu la Vierge
dans un pommier à Chartres
et Sainte Jeanne brûler
au Bella Union.
J’ai vu des girafes dans les Jim la jungle
leur cou comme l’amour
enroulé autour des circonstances de fer
du monde.
J’ai vu la Vénus Aphrodite
sans bras dans son couloir à courant d’air.
J’ai entendu une sirène chanter
au One Fifth Avenue.
J’ai vu la Déesse Blanche danser
dans la rue des Beaux-Arts
le 14 juillet
et la Belle Dame Sans Merci
se curer le nez au Chumley’s.
Elle ne parlait pas anglais
Elle avait des cheveux jaunes
et une voix rauque.
Je mène une vie tranquille
chaque jour sur Mike’s Place
à regarder les joueurs de billard de poche
faire la scène du minestrone
louper les macaronis
et j’ai lu quelque part
le Sens de l’Existence
déjà oublié
où exactement.
Mais je suis l’homme
Et je serai là.
Et je peux faire que les lèvres
de ceux qui sont endormis
parlent.
Et je peux fabriquer mes carnets
dans des brassées d’herbe.
Et je peux écrire ma propre
éponyme épitaphe
intimant aux cavaliers
de passer.
*
Le texte en américain est ici




 C’est un phénomène extrêmement exaltant que de voir apparaître dans un texte des dimensions jusque là insoupçonnées. Comme, en exerçant ses yeux à converger et à diverger, on voit apparaître des profondeurs, des effets, des volumes, des formes, des thèmes cachés dans un stéréogramme. C’est ce qui m’arrive, avec de plus en plus de force, à mesure que je traduis l’Odyssée (tous les textes ne se prêtent pas aussi bien à l’exercice, seulement les grands textes poétiques riches en dimensions, et bien sûr seulement dans leur langue originelle). Cela demande du temps, même si les révélations finissent par arriver soudainement, beaucoup d’attention, et ensuite de l’abandon à ce qui est apparu, pour mieux le goûter, et ce faisant mieux le savoir, l’analyser, mettre en perspective la nouvelle perspective. Cela demande aussi des outils sophistiqués : de l’expérience, et de l’étude. Étude de certains travaux savants qui, même s’ils n’ont pas abouti en eux-mêmes à une exégèse révolutionnaire, en donnent les moyens à qui sait se servir des outils qu’ils constituent.
C’est un phénomène extrêmement exaltant que de voir apparaître dans un texte des dimensions jusque là insoupçonnées. Comme, en exerçant ses yeux à converger et à diverger, on voit apparaître des profondeurs, des effets, des volumes, des formes, des thèmes cachés dans un stéréogramme. C’est ce qui m’arrive, avec de plus en plus de force, à mesure que je traduis l’Odyssée (tous les textes ne se prêtent pas aussi bien à l’exercice, seulement les grands textes poétiques riches en dimensions, et bien sûr seulement dans leur langue originelle). Cela demande du temps, même si les révélations finissent par arriver soudainement, beaucoup d’attention, et ensuite de l’abandon à ce qui est apparu, pour mieux le goûter, et ce faisant mieux le savoir, l’analyser, mettre en perspective la nouvelle perspective. Cela demande aussi des outils sophistiqués : de l’expérience, et de l’étude. Étude de certains travaux savants qui, même s’ils n’ont pas abouti en eux-mêmes à une exégèse révolutionnaire, en donnent les moyens à qui sait se servir des outils qu’ils constituent.