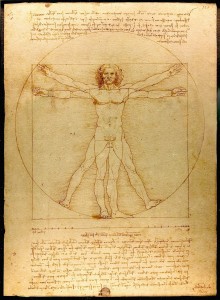en Turquie. Photo Alina Reyes
« Le Christ « agrandi » et renouvelé de Quinet, c’est « ce Dieu qui se réveille dans les cœurs ». » (t.2, p. 227) La voie de Bro, avec sa hache de glace qui « réveille » les cœurs, n’est-elle pas une expression post-moderne de cette pensée, ce joachimisme égaré dont nous poursuivons l’exploration ? « Sous un autre langage, écrit Lubac, la pensée de Quinet n’est pas autre ici que celle de Michelet. » Et de citer l’Ahasverus de Quinet, où l’Éternité déclare :
« Au Père et au Fils j’ai creusé de ma main une fosse dans une étoile glacée qui roule sans compagne et sans lumière… » (p.232)
Lubac rappelle en note qu’il y a là un souvenir du Discours du Christ mort, de Jean-Paul. J’en donne ce passage, qui notamment par la mention du froissement, résonne aussi avec le livre de Sorokine :
« Alors je vis se lever pour s’enlacer autour de l’univers, le serpent gigantesque de l’éternité. Je vis le cercle se former et se doubler autour du grand Tout. Puis il se plia mille fois autour de la nature, et froissa tous les mondes les uns contre les autres ; et pulvérisant tout, il réduisit bientôt le temple de l’universalité, à n’être plus que l’église d’un cimetière. Tout était étroit, sombre et triste. — Se levant avec lenteur, le marteau d’une cloche immense allait sonner la dernière heure du temps, et la destruction de l’univers… quand je m’éveillai. »
Autre est la pensée d’Adam Mickiewicz, collègue au Collège de France et ami de Michelet et Quinet. « Ce qu’il attend, nous dit Lubac, c’est une « nouvelle explosion du Verbe de Jésus-Christ ». Edmond Fondille le faisait observer dès 1862 : « On a affecté, disait-il, de confondre Mickiewicz avec MM. Michelet et Quinet, … le maître catholique et napoléonien avec les deux professeurs voltairiens et révolutionnaires. La vérité est qu’il n’y eut rien de commun en esprit entre eux » ; alors que ceux-ci parlaient en adversaires de plus en plus virulents de l’Église et de toute foi dogmatique, celui-là « n’a pas un seul moment déserté la croyance dans laquelle il est né ». » (p.237) Et Lubac cite Ladislas, le fils du poète, pour lequel Michelet et Quinet « cherchaient toujours davantage dans la raison humaine les lumières que Mickiewicz ne demanda jamais qu’à l’inspiration chrétienne ». (p.238) Puis Daniel Halévy écrivant, toujours à propos de Mickiewicz :
« … Cette grandeur étrange est manifeste dans les leçons qu’il prononce de 1840 à 1844. On n’y trouve pas trace de cette rhétorique, de cette déclamation – donc de cette insincérité – qui gâtent les écrits de Quinet et de Michelet. Quinet et Michelet prétendaient parler d’inspiration, improviser ; ce n’était pas vrai ; mais Mickievicz, dont ils prenaient exemple, improvisait véritablement. Ses leçons… nous donnent sa parole même, libre, simple et puissante. La littérature de 1848 est gâtée par le faux et l’emphase. En lui, rien de tel… Les fleurs d’un merveilleux folklore se mêlaient sur ses lèvres au feu du messianisme. La puissance slave de souffrir, d’espérer, de transformer la souffrance en espérance, vivait en lui… Les improvisations de Mickiewicz ont la qualité mystérieuse, pressante, des Ballades. C’est une fantaisie, un feu, une beauté : on lit, on est saisi… » (p.246)
« Plus fondamentale, poursuit Lubac, est sa conception même de l’art. « Malheur, dit-il, aux poètes s’ils se bornaient seulement à parler ! C’est alors que la Poésie leur jetterait cette guirlande de fleurs mortes dont ils seraient condamnés à s’amuser pendant toute leur vie. » Il fait partager à son compatriote Krasinski son mépris pour cette pure littérature « qui brille quelque temps comme le ver luisant sur l’herbe de mai, puis s’éteint pour toujours ». Analysant l’œuvre de Pouchkine, il reproche au poète russe d’avoir subi d’abord l’influence des idées reçues dans l’occident, d’après lesquelles le poète est un artiste qui doit chercher seulement la perfection de son œuvre, ce qui est « déifier l’art » ; il le loue d’avoir ensuite reconnu – même s’il n’eut pas le courage de se maintenir à cette hauteur – que pour chanter dignement il faut subir une transformation intérieure et devenir « prophète ». » (p.247)
« Si le messianisme de Mickievicz est « d’abord le sentiment d’une intervention constante des puissances surnaturelles dans ce monde terrestre », Édouard Krakovski se dit tenté de croire qu’un tel sentiment lui vient d’abord « de la conscience qu’il a d’être en certains instants un véritable illuminé » ; avançant en âge, le poète discerne dans ce don « un avertissement de Dieu, un ordre obscur auquel il doit se soumettre et dont il doit déchiffrer complètement le sens ». Ce n’était pas orgueil, mas « sentiment très noble d’une sorte de responsabilité à accepter devant le malheur de sa patrie…, sentiment que le sacrifice est le suprême moyen dont nous disposons pour conformer notre monde visible aux desseins du monde invisible qui le régit… » Il est clair en effet qu’il généralise son cas lorsqu’il dit dans sa leçon du 15 janvier 1843 : « Ce qui commence dans la littérature des derniers temps, c’est cet appel au génie, à l’inspiration, ce que nous avons appelé le messianisme ». « (p.250)
Oui, il vient encore, le temps de la parole libre, ouverte, inspirée, la parole écrite mais aussi orale, spontanée, vivante ! Je la sens pousser en moi, si grand est son désir ! Tout vient et viendra à son heure, j’ai confiance et foi absolument et je vous donne pour finir ce chapitre ces quelques vers d’Adam Mickiewicz :
La glace insensible se crève,
L’ombre des préjugés n’est plus :
Matin de liberté, salut !
Où le soleil sauveur se lève !