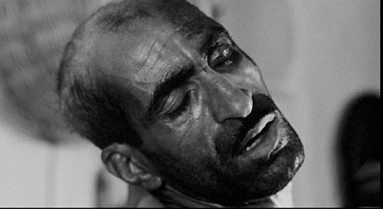au cirque de Troumouse, photo Alina Reyes
au cirque de Troumouse, photo Alina Reyes
*
« Enter Time. » Cette didascalie de Shakespeare ouvrant une scène du Conte d’hiver pourrait illustrer le seul fait, pour un lecteur, d’ouvrir un livre. Entrer dans le sujet, c’est ouvrir une porte et y trouver le Temps dressé derrière, prêt à entrer, tellement plus grand que nous, sur la scène de notre petite vie. Temps de la lecture, du cheminement qu’elle implique, et temps déployé par l’écriture, dépassant l’étroite durée de l’existence humaine. Le titre du livre de Claire de Obaldia L’esprit de l’essai. De Montaigne à Borges, indique à la fois le passage dans le monde de l’esprit et par le trajet d’un auteur à un autre, le trajet dans le temps. L’éclatant caractère d’unicité des essais de Borges comme de ceux de Montaigne donne une indication sur l’origine de sa réflexion lorsqu’elle écrit : « Le mot même d’“essai” déroute l’horizon d’attente du lecteur. Bien qu’il soit lié à l’autorité et à l’authenticité d’un auteur qui parle en son propre nom, il ne l’en désinvestit pas moins de toute responsabilité à l’égard d’un texte qui n’est après tout qu’une “mise à l’essai” et n’est pas sans renvoyer, en un sens, au “comme si” de la fiction. » Si l’essai est en effet une « mise à l’essai », c’est d’abord de lui-même : en tant qu’essai, forme littéraire. La question : qu’est-ce qu’un essai ? résume la remarque de Claire de Obaldia. Pour la poser, elle se poste d’emblée devant la porte ouverte du temps et scrute son « horizon d’attente ». Que ce dernier soit, selon son terme, dérouté, indique qu’elle ne le voit pas, ou qu’elle ne le voit que confusément, du fait que l’auteur de l’essai ne lui paraît pas s’engager dans une voie claire où il serait loisible au lecteur de le suivre assuré, comme les grimpeurs suivent le premier de cordée sur une voie d’escalade qui peut être difficile ou très difficile mais dont le but est connu ; but auquel on parvient par une technique également conue et balisée. Or le but de l’essayiste est inconnu, et sa méthode, libre. Aussi la question se reformule-t-elle plus précisément ainsi : qu’est-ce qu’un essai, et peut-on s’y fier ? L’essayiste grimpe à mains nues et le lecteur, comme l’auteur peut-être, ignore son but. Tel est bien le sentiment que donne la lecture des ouvrages de Lawrence Durrell, Albert Camus et Zbigniew Herbert, respectivement intitulés L’ombre infinie de César, Noces suivi de L’Été, et Le labyrinthe au bord de la mer. S’ils sont des mises à l’essai de leurs auteurs, cela signifie-t-il pour autant, comme le laisse entendre Claire de Obaldia, que leur responsabilité n’y est pas pleinement engagée ? Nous nous essaierons à interroger ces textes en fonction des remarques de cette citation. Dans un premier temps il s’agira de mesurer quel peut être l’investissement des auteurs dans ces essais dont nous regarderons le caractère authentique, puis le caractère fictionnel, et enfin le caractère hybride. Dans un deuxième temps, nous tâcherons de comprendre l’engagement particulier des auteurs, d’abord en nous penchant sur les titres de leurs ouvrages, puis en y décelant les marques d’une pensée poétique, pour voir en dernier lieu que celle-ci porte une volonté d’engagement total de l’être contre la morbidité de son temps. Le dernier temps de notre réflexion portera, toujours à travers les œuvres de nos trois auteurs mais en élargissant le champ sur les questions de l’irresponsabilité ou de la responsabilité de l’auteur d’un essai, et de « l’horizon d’attente du lecteur ».
Dans chacun des essais de notre corpus, l’auteur parle en son nom. Il dit je, il se met en scène dans son discours, il affirme la singularité de sa façon de voir par la singularité de sa façon d’être. Parfois de manière explicite, plus souvent selon les voies de l’implicite communes à la fiction et à la poésie. Lawrence Durrell par exemple image son entrée dans le sujet par l’évocation de son arrivée en Provence par la route, donnant l’impression d’un passage dans un autre monde à travers le tunnel de verdure que constituent les alignements d’arbres qui la bordent. La traversée de la Méditerranée jusqu’en Grèce dite par Zbigniew Herbert a un rôle similaire. Albert Camus évoque une semblable traversée, mais en creux : jeune homme, il rêvait et projetait de refaire le voyage d’Ulysse, mais la guerre l’en a empêché, l’envoyant dans une tout autre direction, l’ « enfer ». Le caractère authentique de l’écriture des trois essayistes est fondé sur le récit d’une expérience. Et singulièrement, d’une expérience de déplacement. À travers laquelle le lecteur peut éprouver, sans que cela soit explicité, qu’il s’agit aussi et d’abord d’un déplacement mental. Ainsi donc Claire de Obaldia a raison : l’essai « déroute ». Mais ce sont eux-mêmes que les auteurs de ces trois ouvrages ont cherché à dérouter. Zbigniew Herbert a quitté la Pologne et son enfermement, il est parti sur les traces de l’Antiquité grecque, crétoise, étrusque, romaine, de Grèce en Angleterre. Albert Camus n’a pu marcher sur les pas d’Ulysse, mais ce projet demeure vivant par la façon dont il a été avorté par la guerre, et par d’autres déplacements, retours en Algérie et voyage en Italie qui peuvent être considérés comme des retours d’Ulysse au bercail après la guerre de Troie. Quant à Lawrence Durrell, après avoir quitté le paradis indien de son enfance, il s’est dérouté du retour au pays d’origine, l’Angleterre, pour la Provence. Ces livres ne cachent pas qu’ils sont ceux d’auteurs gravement marqués par l’histoire de leur siècle, et leurs épreuves, à l’arrière-fond de leur quête, leur confèrent plus encore qu’une authenticité : la profondeur de la vérité vécue non seulement en esprit, mais aussi au cœur du réel et réellement.
Si l’histoire a un rôle fondamental dans ces trois essais, elle l’y tient de différentes façons. Camus évoque des souvenirs. Parfois au passé, parfois au présent, ou par un passé évoquant un passé qui vient juste d’avoir lieu. Le ton peut être celui du journal d’un promeneur, ou bien, plus brièvement, celui d’un mémorialiste. Ce qu’il raconte se présente en tout cas comme véridique, de même que les récits que fait Zbigniew Herbert de ses voyage, ou de ses souvenirs d’enfant, élève d’un professeur de latin qui l’initie au monde antique. La véracité des récits de Lawrence Durrell est beaucoup plus douteuse. Les deux amis qui accompagnent l’écriture de son livre sont si typés qu’ils ressemblent à des personnages de roman ou même de théâtre quelque peu beckettien. À l’évidence, de même que pour le récit de son existence, Durrell part du réel mais le transforme, ou du moins en fait ressortir les traits, non comme un dessinateur naturaliste mais comme un peintre. Ses tournesols sont plus proches de ceux de Van Gogh que de ceux d’un botaniste. Et quand il aborde le domaine de la sorcellerie, il se fait lui-même sorcier en racontant l’histoire à dormir debout d’une femme enterrée. La fiction est bel et bien présente au cœur de son essai, et sa démarche complètement à l’opposé de celle de bigniew herbert, chercheur scrupuleux qui étaie son essai de précisions scientifiques, cherchant la vérité par la voie des archives de l’histoire et la confrontation avec la réalité des traces qu’elle a laissées.
La démarche de l’historien est aussi celle de Lawrence Durrell, mais sa relecture de l’histoire de la Provence depuis César voisine, beaucoup plus que chez Herbert, avec le registre romanesque de l’histoire individuelle vécue dans le présent par le narrateur. Le lien entre passé et présent tient essentiellement, dans Le Labyrinthe au bord de la mer, dans l’exposé des impressions et des pensées que suscitent en l’auteur sa confrontation avec les textes historiques et avec les œuvres d’art témoins de l’Antiquité, de la vérité qu’il recherche. On rencontre dans son livre très peu de personnages du présent, mais quand il parle du palais de Cnossos, il pousse l’investigation jusqu’à la connaissance d’Evans, son inventeur. La réalité d’une personne dans son humanité lui est ainsi aussi riche en enseignements, quoique de façon tout autre, que l’interrogation des mythes antiques. Ainsi en va-t-il aussi pour Albert Camus, qui éclaire l’histoire, le passé et le présent, par le mythe de Sisyphe, dont il fait le prototype de l’humaniste toujours de nouveau condamné et pourtant toujours de nouveau absolument nécessaire, et peut évoquer dans un même texte à la fois la figure du Minotaure et celles de lutteurs sur un ring, qu’il est allé voir à Oran et dont il raconte le combat. Ainsi chacun de ces trois auteurs illustre-t-il et construit-il une pensée à travers ce genre hybride qu’est l’essai, convoquant aussi bien les démarches du romancier que celles de l’historien et du philosophe. Mais après tout les historiens du courant de la micro-histoire, comme Carlo Ginzburg, ou des penseurs comme Nietzsche ou Bachelard, ont montré d’une part que l’histoire était nécessairement proche de la littérature, et d’autre part que la pensée pouvait se développer par des poétiques autres que celles de la philosophie classique, dialectique, conceptuelle et tendant à se débarrasser des affects.
L’hybridité du genre se lit à même le titre de ces trois essais, d’emblée évocateurs de leur poétique particulière. L’ombre infinie de César, Noces, L’Été, Le Labyrinthe au bord de la mer. Autant de titres splendides qui, malgré leur poésie, voire leur caractère romanesque, ne pourraient convenir tout à fait à un roman ou à un poème. Du moins telle peut être l’impression du lecteur une fois qu’il a lu ces livres. Oui, par exemple Noces pourrait être le titre d’un poème ou d’un recueil de poésies, ou encore L’ombre infinie de César pourrait être le titre d’un roman. Mais ces trois essais ont si bien fait leurs leurs titres poétiques ou romanesques qu’ils semblent ne plus pouvoir appartenir pleinement qu’à eux-mêmes. Ces essais sont, comme ceux de Borges et comme tout grand essai, des exemplaires absolument uniques de ce genre dont Montaigne a glorifié le nom et la forme. Ces titres posent un sujet, et laissent transparaître la présence de l’auteur dans son sujet. Montaigne avait intitulé ses essais non pas les Essais, mais les Essais de Montaigne. L’auteur lui-même était dans son titre. Et dans « l’ombre infinie de César », nous savons que se trouve et vit Durrell, de même que nous avons connaissance de l’errance éclairée de Zbigniew Herbert dans « le labyrinthe au bord de la mer », et que, comme il l’a exposé, Albert Camus a participé aux « noces » et reste habité par « l’été ». Le titre de ces essais est le lieu même de l’habitation de leurs auteurs respectifs. Ils manifestent au lecteur leur présence réelle, qui n’a pu s’incarner avec une telle force que parce que les hommes qui les ont écrits l’ont fait en recourant librement à toutes sortes de ressources de genres littéraires. C’est la raison pour laquelle, ou l’une des raisons pour lesquelles, le genre dont se rapprochent le plus ces essais, chacun selon son génie propre, est la poésie.
Dix-neuf poèmes ponctuent L’ombre infinie de César. Poèmes énigmatiques qui participent de l’ombre discrète du texte, de cette obscurité cachée dans l’ « éblouissement », mot employé par Durrell comme par Camus pour dire l’effet de la lumière méditerranéenne sur l’esprit. Chez ces deux auteurs les oxymores associant lumière et noirceur sont fréquents, et la vision de Zbigniew Herbert de la mer comme profondeur nocturne sous une surface en miroir en est proche. Les contrastes violents de la lumière dans les paysages du sud correspondent à une vision exacerbée de l’homme face à son destin, disent ou induisent le rapport de la mort et de la vie. Lawrence Durrell peint le tableau (peut-être imaginaire) d’un village traversé, minuscule, en hiver, avec ses toitsde neige : à l’entrée une maison d’où l’on a sorti une table nappée de blanc et portant pain et vin ; à la sortie une maison semblable devant laquelle on a sorti une table nappée de noir où reposent un cahier et un stylo. Noces ou communion d’un côté, deuil ou écriture de l’autre ? L’auteur n’en dit rien. Il se contente de présenter l’image, et de la laisser parler, de laisser libre cours aux mille interprétations, pensées, sentiments, qu’elle peut susciter. C’est là une méthode poétique. S’il y a du lyrisme dans la voix de ces essayistes qui disent je, ce n’est pas de ce lyrisme que Camus dénonce et rejette comme trop égocentrique. L’exil est une ascèse et ces exilés du vingtième siècle ne cherchent pas une consolation dans l’exaltation du moi mais, après les horreurs de l’histoire, dans le dépassement de l’ego. Un oxymore, une antithèse en mot ou en image peut y suffire.
Paradoxalement, c’est en laissant l’être se dissoudre dans la lumière (ou dans le vent, comme Camus, ou dans le quotidien, comme Durrell, ou dans la description minutieuse, comme Herbert) que ce essayistes disent leur être, le communiquent. Le monde de leur temps, avec les ravages énormes qu’y produit l’individualisation forcenée, les révolte. Qu’ils le disent ou qu’ils le laissent entendre, à cette morbidité du siècle ils opposent la littérature ; ils opposent la pensée et la poésie mêlées dans leurs essais au monde de la spécialisation et de la séparation. Ils reproposent des noces, en fait, pour reprendre le titre de Camus. Noces avec les hommes d’il y a plusieurs millénaires, avec lesquels Zbigniew Herbert dit vouloir faire le pont dans le temps, noces avec la nature si vivante chez Camus, noces avec l’autre pour l’étranger qu’est Durrell en Provence. Noces qui ne peuvent réparer le présent ni le passé mais ouvrent l’avenir, et pour cela requièrent le concours du corps et de l’esprit, leur engagement simultané : ce dont ils témoignent à travers la forme de l’essai, qui lui-même peut marier tous les genres et peindre le tableau d’un homme vivant dans toutes ses dimensions.
La lutte et l’affirmation d’Albert Camus, la quête compassionnelle de Zbigniew Herbert, l’acte de grâce de Lawrence Durrell envers son pays d’adoption, ne semblent pas des marques de désinvestissement de la responsabilité de ces auteurs envers leurs textes, bien au contraire. La remarque de Claire de Obaldia s’entend dans le cadre de la vision habituelle de l’esprit scientifique. Si l’essai est une expression personnelle, pense-t-on, il n’est donc pas un travail scientifique. S’il est dispensé d’apporter des preuves, alors le lecteur est dispensé d’adhérer à ce qu’il dit. Si, de plus, il n’est pas vraiment une œuvre mais un essai d’œuvre en même temps qu’un essai de soi par l’auteur, s’il tient de la tentative ou même de l’ébauche, alors en effet l’auteur n’a pas à assumer totalement la parole qu’il y donne. Ls cobayes n’ont pas à reprocher à l’industrie pharmaceutique le fait que certains de ses essais soient non concluants. Le trait est grossi, mais tel est le statut généralement accordé à l’essai, comparé notamment au travail scientifique de la thèse. Et c’est ainsi que, comme le dit Claire de Obaldia, le mot même « déroute l’horizon d’attente du lecteur », placé dans la position qui ne saurait si on lui administre un remède efficace ou un placebo, voire un produit dangereux. or la littérature et la pharmacie ne sont pas exactement comparables.
Il n’est pas déraisonnable pour autant d’estimer que la littérature fait partie des médecines de l’humanité. L’essai en est une branche particulièrement expérimentale. Comme le dit Camus, on ne demande pas à un auteur de romans policiers d’avoir fait l’expérience de ce qu’il décrit, alors qu’on s’imagine toujours que l’auteur de littérature générale ne fait que se raconter, d’une façon ou d’une autre. Camus réfute vigoureusement ce lieu commun, mais c’est précisément en affirmant ainsi son expérience dans son essai qu’il réaffirme sans le dire l’authenticité de la parole portée par un essai, et l’autorité qu’elle acquiert de ce fait. Et comment pourrait-il y avoir à la fois authenticité et irresponsabilité ? L’autorité de l’auteur, acquise par une expérience soutenue de la vie et de la pensée, ne peut être qu’un engagement total. L’auteur qui s’essaie n’est pas un apprenti sorcier. Tout au long de leurs essais, nous voyons nos trois auteurs profondément impliqués dans leur quête d’une humanité vivable, d’un monde vivable pour l’homme. Le mur d’Hadrien dont parle si longuement Zbigniew Herbert est le mur mitoyen de la civilisation et de la barbarie. Tous trois sont des rescapés des horreurs de la civilisation basculée dans la barbarie : colonialisme, stalinisme, nazisme. Là sont les réelles déroutes auxquelles l’humanité s’expose. « Où croît le danger, vient aussi ce qui sauve », dit la parole du poète. Comme Hölderlin, les auteurs de ces trois essais se montrent tout entiers engagés dans la recherche de « ce qui sauve », de ce qui peut sauver ou contribuer à sauver l’humanité, et hautement conscients de leurs responsabilités.
En définitive, qu’est-ce qui, dans l’essai, peut inquiéter le lecteur ? Le fait de ne pas savoir ce qui l’attend, ou celui de ne pas saoir ce qu’il attend ? L’essai n’est pas le seul genre littéraire qui puisse le déstabiliser. Toute grande œuvre déroute. Mais l’incertitdude du genre même de l’essai ajoute à l’incertitude du lecteur. Sortir des sentiers battus ne peut-il conduire à la déroute totale, au désespoir ? Sans doute, mais l’essai n’est pas une entreprise de démolition. S’il détruit les fausses certitudes, c’est pour reconstruire sur un terrain nettoyé. La solution est sans doute de se défaire des lectures qui attendent quelque chose, qui ont un « horizon d’attente ». De s’accorder à la démarche de recherche de l’auteur, qui risque savamment sa vie. Il y a une science dans l’essai, et elle dépasse les sciences que nous connaissons. Un génie des mathématiques du vingtième siècle, Alexandre Grothendieck, a éprouvé la nécessité d’écrire un essai pour dire sa pensée dans une autre totalité. Il l’a intitulé La clef des songes. Les éditeurs ne l’ont pas publié parce que le plus souvent ils sont gouvernés par un « horizon d’attente » du lecteur. La littérature inclassable, comme l’est en définitive l’essai bien compris, nous sort de cette cage.
Les montagnes, où qu’elles soient sur terre, sont toujours la montagne. Tous les poètes sentent qu’ils sont en fait un même poète en action à travers le temps, les cultures, les civilisations. Nous avons essayé de montrer que l’essai tenait de la poésie. Montaigne terminait les siens par des vers d’Horace, priant de ne jamais manquer de sa cithare. Nous avons essayé de dire que les trois essais de notre corpus pouvaient se lire comme des poèmes – dans cet horizon d’attente, s’il en faut un. Mais en montagne l’horizon est sans cesse changeant. Et l’essentiel est, en marchant, en grimpant, d’être devenu, de devenir sans cesse de nouveau, montagnard, montagnarde.
*
Ceci est le texte de ma deuxième dissertation pour l’agrégation 2017. Quoique je me sois efforcée d’abâtardir mon écriture de contraintes académiques, béquilles malcommodes à l’albatros, le naturel a fini par y reprendre le dessus – et le naturel, la pensée, sont peu prisées des correcteurs : ma réflexion a été sanctionnée d’un 6/20.
*


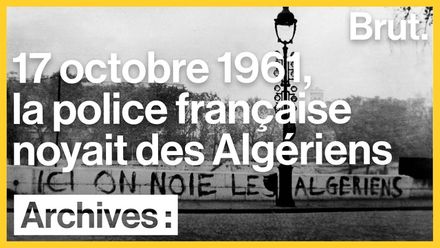

 au cirque de Troumouse, photo Alina Reyes
au cirque de Troumouse, photo Alina Reyes