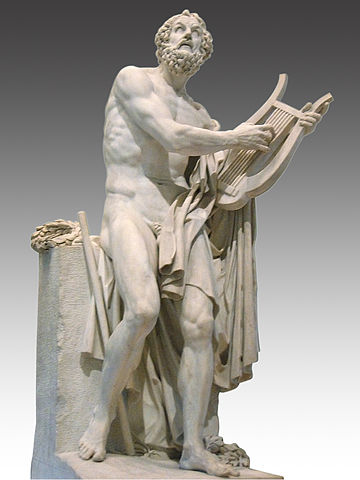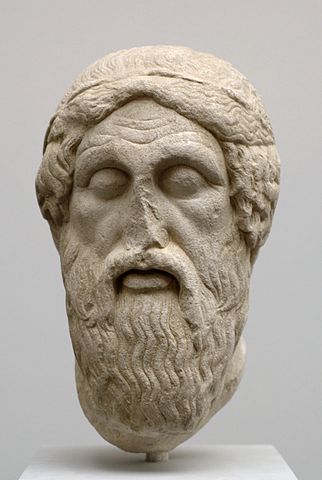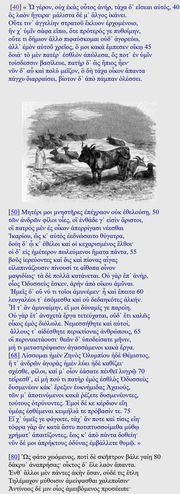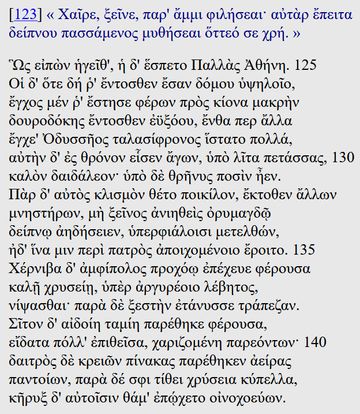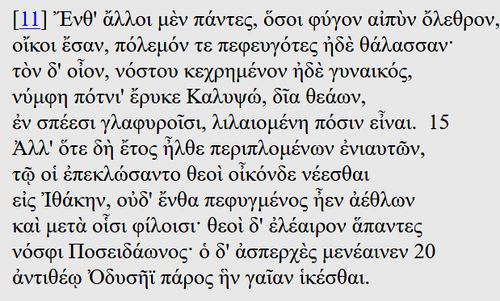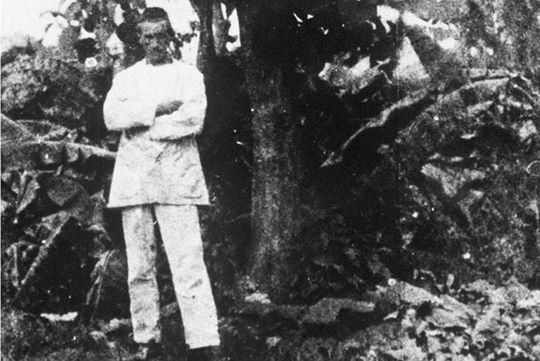Ou Rimbaud géographe. Ce texte fantastique dans sa description du réel, dans sa puissance évocatoire du visible, et, par le visible, de l’invisible, et avec son chapelet de noms étrangers, vaut à mes yeux tout autre poème de Rimbaud. Le voici, ce texte qu’il avait intitulé « Notice sur l’Ogadine », daté du 10 octobre 1883, et qui a été publié, daté du 10 décembre 1883, sous le titre Rapport sur l’Ogadine, par M. Arthur Rimbaud, agent de MM Mazeran, Viannay et Bardey, à Harar (Afrique orientale), dans les Comptes rendus de la Société de géographie de Paris de l’année 1884. Je le fais suivre du fragment retrouvé dans le manuscrit, fragment non publié par la Société de géographie et rétabli dans l’édition 2011 de La Pléiade.
Voici le texte en PDF : Arthur Rimbaud, Rapport sur l’Ogadine
Ou à lire directement ci-dessous
*
Voici les renseignements rapportés par notre première expédition dans l’Ogadine.
Ogadine est le nom d’une réunion de tribus somalies d’origine et de la contrée qu’elles occupent et qui se trouve délimitée généralement sur les cartes entre les tribus somalies des Habr-Gheradjis, Doulbohantes, Midjertines et Hawïa au nord, à l’est au sud. À l’ouest, l’Ogadine confine aux Gallas pasteurs Ennyas jusqu’au Wabi, et ensuite la rivière Wabi la sépare de la grande tribu Oromo des Oroussis.
Il y a deux routes du Harar à l’Ogadine : l’une par l’est de la ville, vers le Boursouque, et au sud du mont Condoudo par le War-Ali, comporte trois stations jusqu’aux frontières de l’Ogadine.
C’est la route qu’a prise notre agent, M. Sottiro, et la distance du Harar au point où il s’est arrêté dans le Rère-Hersi égale la distance du Harar à Biocabouba sur la route de Zeilah, soit environ 140 kilomètres. Cette route est la moins dangereuse et elle a de l’eau.
L’autre route se dirige au sud-est du Harar par le gué de la rivière du Hérer, le marché de Babili, les Wara-Heban, et ensuite les tribus pillardes Somali-Gallas de l’Hawïa.
Le nom de Hawïa semble désigner spécialement des tribus formées d’un mélange de Gallas et de Somalis, et il en existe une fraction au nord-ouest, en dessous du plateau du Harar, une deuxième au sud du Harar sur la route de l’Ogadine, et enfin une troisième très considérable au sud-est de l’Ogadine, vers le Sahel, les trois fractions étant donc absolument séparées et apparemment sans parenté.
Comme toutes les tribus somalies qui les environnent, les Ogadines sont entièrement nomades et leur contrée manque complètement de routes ou de marchés. Même de l’extérieur, il n’y a pas spécialement de routes y aboutissant, et les routes tracées sur les cartes, de l’Ogadine à Berberah, Mogdischo (Magadoxo) ou Braoua, doivent indiquer simplement la direction générale du trafic.
L’Ogadine est un plateau de steppes presque sans ondulations, incliné généralement au sud-est : sa hauteur doit être à peu près la moitié de celle (1800 mètres) du massif du Harar.
Son climat est donc plus chaud que celui du Harar. Elle aurait, paraît-il, deux saisons de pluies, l’une en octobre et l’autre en mars. Les pluies sont alors fréquentes, mais assez légères.
Les cours d’eau de l’Ogadine sont sans importance. On nous en compte quatre, descendant tous du massif de Harar : l’u, le Fafan, prend sa source dans le Condoudo, descend par le Boursouque (ou Barsoub), fait un coude dans toute l’Ogadine, et vient se jeter dans le Wabi au point nommé Faf, à mi-chemin de Mogdischo ; c’est le cours d’eau le plus apparent de l’Ogadine. Deux autres petites rivières sont : le Hérer, sortant également du Garo Condoudo, contournant le Babili et recevant à quatre jours sud du Harar, dans les Ennyas, le Gobeiley et le Moyo descendus des Alas, puis se jetant dans le Wabi en Ogadine, au pays de Nokob ; et la Dokhta, naissant dans le Warra Heban (Babili) et descendant au Wabi, probablement dans la direction du Herer.
Les fortes pluies du massif Harar et du Boursouque doivent occasionner dans l’Ogadine supérieure des descentes torrentielles passagères et de légères inondations qui, à leur apparition, appellent les goums pasteurs dans cette direction. Au temps de la sécheresse il y a, au contraire, un mouvement général de retour des tribus vers le Wabi.
L’aspect général de l’Ogadine est donc la steppe d’herbes hautes, avec des lacunes pierreuses ; ses arbres, du moins, dans la partie explorée par nos voyageurs, sont tous ceux des déserts somalis : mimosas, gommiers, etc. Cependant aux approches du Wabi, la population est sédentaire et agricole. Elle cultive d’ailleurs presque uniquement le dourah, et emploie même des esclaves orginaires des Aroussis et autres Gallas d’au delà du fleuve. Une fraction de la tribu des Malingours, dans l’Ogadine supérieure, plante aussi accidentellement du dourah, et il y a également de ci de là quelques villages de Cheikhaches cultivateurs.
Comme tous les pasteurs de ces contrées, les Ogadines sont toujours en guerre avec leurs voisins et entre eux-mêmes.
Les Ogadines ont des traditions assez longues de leurs origines. Nous avons seulement retenu qu’ils descendent tous primitivement de Rère Abdallah et Rère Ishay (Rère signifie : enfants, famille, maison ; en galla on dit Warra. Rère Abdallah eut la postérité de Rère-Hersi, et Rère Hammadèn : ce sont les deux principales familles de l’Ogadine supérieure.
Rère Ihsay engendra Rère Ali et Rère Aroun. Ces rères se subdivisent ensuite en innombrables familles secondaires. L’ensemble des tribus visitées par M. Sottiro est de la descendance Rère Hersi, et se nomment Malingours, Aïal, Oughas, Sementar, Magan. Les différentes divisions des Ogadines ont à leur tête des chefs nommés oughaz. L’oughaz de Malingour, notre ami Amar Hussein, est le plus puissant de l’Ogadine supérieure, et il paraît avoir au torité sur toutes les tribus entre l’Habr Gerhadji et le Wabi. Son père vint au Harar du temps de Raouf Pacha qui lui fit cadeau d’armes et de vêtements. Quant à Omar Hussein, il n’est jamais sorti de ses tribus où il est renommé comme guerrier et il se contente de respecter l’autorité égyptienne à distance.
D’ailleurs, les Egyptiens semblent regarder les Ogadines, ainsi du reste, que tous les Somalis et Dankalis, comme leurs sujets ou plutôt alliés naturels en qualité de Musulmans, et n’ont aucune idée d’invasion sur leurs territoires.
Les Ogadines, du moins ceux que nous avons vus, sont de haute taille, plus généralement rouges que noirs; ils gardent la tête nue et les cheveux courts, se drapent de robes assez propres, portent à l’épaule la sigada, à la hanche le sabre et la gourde des ablutions, à la main la canne, la grande et la petite lance, et marchent en sandales. Leur occupation journalière est d’aller s’accroupir en groupes sous les arbres à quelque distance du camp, et, les armes en main, de délibérer indéfiniment sur leurs divers intérêts de pasteurs. Hors de ces séances, et aussi de la patrouille à cheval pendant les abreuvages et des razzias chez leurs voisins, ils sont complètement inactifs. Aux enfants et aux femmes est laissé le soin des bestiaux, de la confection des ustensiles de ménage, du dressage des huttes, de la mise en route des caravanes. Ces ustensiles sont les vases à lait connus du Somal, et les nattes des chameaux qui, montées sur des bâtons, forment les maisons des gacias (villages) passagères.
Quelques forgerons errent par les tribus et fabriquent les fers de lances et poignards.
Les Ogadines ne connaissent aucun minerai chez eux.
Ils sont musulmans fanatiques. Chaque camp a son Iman qui chante la prière aux heures dues. Des wodads (lettrés) se trouvent dans chaque tribu ; ils connaissent le Coran et l’écriture arabe et sont poètes improvisateurs.
Les familles ogadines sont fort nombreuses. L’abban de M. Sottiro comptait soixante fils et petits-fils. Quand l’épouse d’un Ogadine enfante, celui-ci s’abstient de tout commerce avec elle jusqu’à ce que l’enfant soit capable de marcher seul. Naturellement il en épouse une ou plusieurs autres dans l’intervalle, mais toujours avec les mêmes réserves.
Leurs troupeaux consistent en bœufs à bosse, moutons à poil ras, chèvres, chevaux de race inférieure, chamelles laitières et enfin en autruches dont l’élevage est une coutume de tous les Ogadines. Chaque village possède quelques douzaines d’autruches qui paissent à part, sous la garde des enfants, se couchent même au coin du feu dans les huttes, et, mâles et femelles, les cuisses entravées, cheminent en caravane à la suite des chameaux dont elles atteignent presque la hauteur.
On les plume trois ou quatre fois par an, et chaque fois on en retire environ une demi-livre de plumes noires et une soixantaine de plumes blanches. Ces possesseurs d’autruches les tiennent en grand prix.
Les autruches sauvages sont nombreuses. Le chasseur, couvert d’une dépouille d’autruche femelle, perce de flèches le mâle qui s’approche.
Les plumes mortes ont moins de valeur que les plumes vivantes.
Les autruches apprivoisées ont été capturées en bas âge, les Ogadines ne laissant pas les autruches se reproduire en domesticité.
Les éléphants ne sont ni fort nombreux, ni de forte taille dans le centre de l’Ogadine. On les chasse cependant sur le Fafan, et leur vrai rendez-vous, l’endroit où ils vont mourir, est toute la rive du Wabi. Là ils sont chassés par les Dônes, peuplade Somalie mêlée de Gallas et de Souahélis, agriculteurs et établis sur le fleuve. Ils chassent à pied et tuent avec leurs énormes lances. Les Ogadines chassent à cheval ; tandis qu’une quinzaine de cavaliers occupant l’animal en front et sur les flancs, un chasseur éprouvé tranche, à coups de sabre, les jarrets de derrière de l’animal.
Ils se servent également de flèches empoisonnées. Ce poison nommé ouabay et employé dans tout le Somal, est formé des racines d’un arbuste pilées et bouillies. Nous vous en envoyons un fragment. Au dire des Somalis, le sol aux alentours de cet arbuste est toujours couvert de dépouilles de serpents, et tous les autres arbres se dessèchent autour de lui. Ce poison n’agit d’ailleurs qu’assez lentement, puisque les indigènes blessés par ces flèches (elles sont aussi armes de guerre) tranchent la partie atteinte et restent saufs.
Les bêtes féroces sont assez rares en Ogadine. Les indigènes parlent cependant de serpents, dont une espèce à cornes et dont le souffle même est mortel. Les bêtes sauvages les plus communes sont les gazelles, les antilopes, les girafes, les rhinocéros, dont la peau sert à la confection des boucliers. Le Wabi a tous les animaux des grands fleuves : éléphants, hippopotames, crocodiles, etc.
Il existe chez les Ogadines une race d’hommes regardée comme inférieure et assez nombreuse, les Mitganes (Tsiganes); ils semblent tout à fait appartenir à la race Somalie dont ils parlent la langue. Ils ne se marient qu’entre enx. Ce sont eux surtout qui s’occupent de la chasse des éléphants, des autruches, etc.
Ils sont répartis entre les tribus et en temps de guerre réquisitionnés comme espions et alliés. L’Ogadine mange l’éléphant, le chameau et l’autruche, et le Mitgan mange l’âne et les animaux morts, ce qui est un péché.
Les Mitganes existent et ont même des villages fort peuplés chez les Dankalis de l’Haouache, où ils sont renommés chasseurs.
Une coutume politique et une fête des Ogadines est la convocation des tribus d’un certain centre, chaque année, à jour fixe.
La justice est rendue en famille par les vieillards et en général par les oughaz.
*
Fragment retrouvé :
Les routes générales d’importation vers l’Ogadaine sont : au nord-est de Berbera, aux tribus de Melmil, par les Habb-Awal, au sudest de Mogdischo et Brawa par les Somalis de ces ports (mélangés d’Arabes, Gallas, et Souahélis) et les Habr Braouas.
Les marchandises d’importation pour l’Ogadaine sont les Sheetings de fabrique américaine et anglaise nommés Abouguédis et Wilayéti, quelques espèces de tobes rayés nommés Taouachis, Aïtabans, Kheïlis, Boredjis, et plusieurs espèces de cotonnade légère teinte en indigo, nommées Dibbâni, Mokhaoui, Bengali, Labatbooroud, etc. Ces dernières étoffes servant à envelopper les coiffures des femmes. Quelques perles et du tabac complètent la liste des denrées d’importation dans l’Ogadine. Les mêmes marchandises sont importées des ports de la côte de Berbera et de ceux de la mer des Indes.
La monnaie est entièrement inconnue dans toute l’Ogadine, et les transactions entre les indigènes ne sont que des échanges de bestiaux ; avec les étrangers elles se font par le moyen des marchandises ci-dessus énumérées.
L’Ogadine possède le sel en vastes plaines salées s’étendant près du Wabi en dessous d’Eimeh. Ce sel s’exporte même chez les Gallas et il en est venu quelquefois au Harar.
Les colporteurs de l’extérieur entrent dans l’Ogadine transportant leurs quelques marchandises à dos de chameau ou d’ânes ou même à leur épaule, et circulent ainsi de garia en garia guidés par leur abban qu’ils changent de tribu en tribu. Ce guide ou abban prend son salaire ou droit en marchandises du colporteur, et prend courtage du vendeur et de l’acheteur à la fois dans les opérations mercantiles qui se font devant lui. L’abban est toujours un homme assez recommandable et connu dans les deux tribus, il est votre garantie dans la tribu et la route et il répond également de vos faits et gestes dans la tribu. On peut changer une dizaine de fois d’abbans, avant le Wabi, et un abban spécial passe le Wabi en radeau avec le voyageur jusqu’à la Rive Aroussi. Hors de ce mode il est impossible de circuler dans l’Ogadine. Mais en choisissant bien ses abbans et en suivant leurs conseils et en marchant selon les coutumes politiques et religieuses et le caractère des indigènes, nous sommes convaincu qu’un Européen se présentant comme marchand et sans se presser, franchirait aisément en deux ou trois mois tout le continent de Harar à Brava par la route des Ogadines.
Les exportations de l’Ogadine sont les plumes et l’ivoire. Rère Baouadley au sud-est est le point le plus fréquenté pour les plumes, dont il sort une importante quantité par les ports du Golfe d’Aden comme par ceux de la mer des Indes.
L’ivoire débouche des Gallas Aroussis par Eimeh, point situé sur la rive gauche du Wabi. Tout le long du Wabi s’exportent aussi par l’Ogadaine une quantité d’esclaves Gallas pour le Sahel.
Une certaine quantité de peaux [de] boeufs arrivent également à Berbera de l’Ogadine.
À Galimaÿ, pays de Nokob, au confluent de la Dokhta et du Wabi, on vient chercher les peaux de chèvre et la myrrhe.
Les produits de l’Ogadine supérieure arrivent habituellement à la fin de l’année à Boulhar-Berbera.
Quelque café arrive peut-être aussi à Berbera des Aroussis par l’Ogadine. On nous dit même que les Ogadines riverains de Wabi ont quelques cultures de café.
Les Hararis vont chercher en Ogadine des bestiaux et de la graisse et y envoient quelques cotonnades, des chevaux entiers, des mulets,
etc. … Les douanes du Harar n’ont jamais reçu d’entrées de plumes de l’Ogadine. (Les Ogadines mêmes sont peu nombreux au Harar.)
*
L’édition originale du texte se trouve sur Gallica.fr
Le fragment dans La vie de La Pléiade.